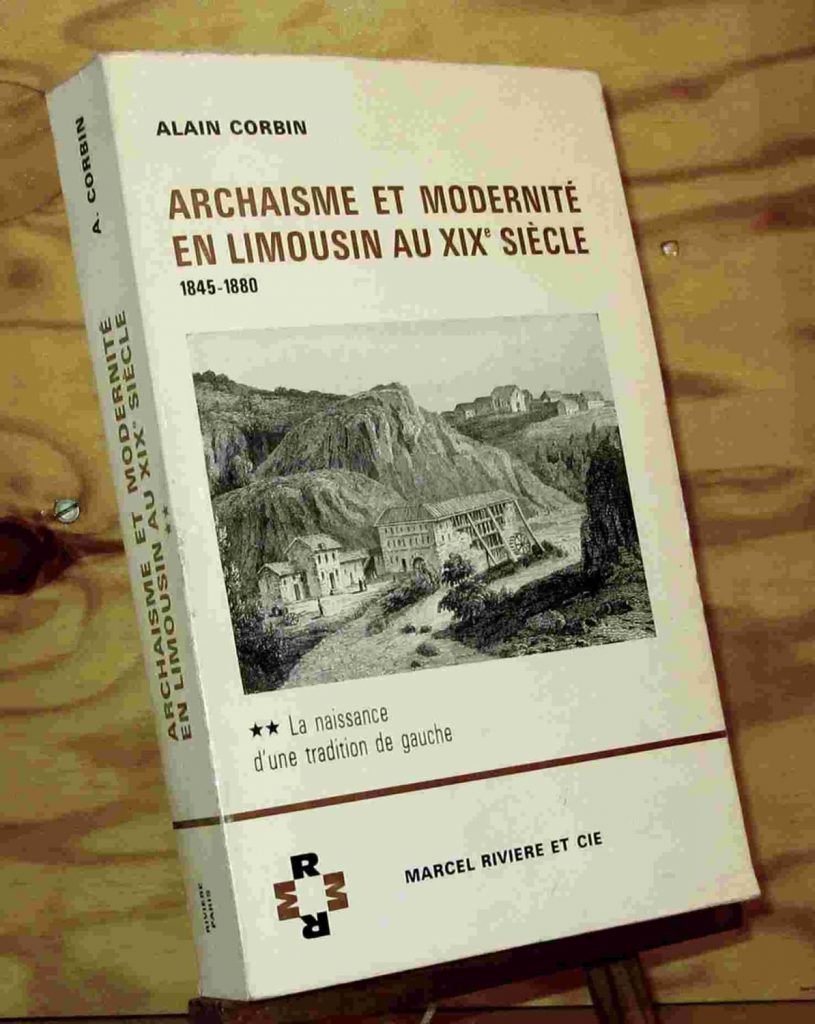Marathon des mots
13e festival international de littérature
Fin de la rencontre avec Omar Benlaala (Tu n’habiteras jamais Paris, Flammarion), Emmanuelle Pagano (Serez-vous des nôtres ?) et Martín Solares (Comment dessiner un roman). Humilité, travail de la langue et de l’histoire, traduction ; ils reviennent avec les étudiants du master création littéraire de Toulouse sur la phase de recherche et de réflexion qui accompagne l’écriture au travers d’anecdotes personnelles.
Rencontre avec Omar Benlaala, Emmanuelle Pagano et Martín Solares — 2de partie
Sommaire
1. L’humilité de l’écrivain
2. La dose de littérature quotidienne
3. Censure et écriture : être lu par ses parents
4. Écriture et souffrance – la pénibilité du métier
5. Écrire en français ou en espagnol : l’écriture du Mexique
6. Le travail avec les traducteurs
Entretien
Lola Jeannot — Emmanuelle Pagano, Omar Benlaala. L’humilité est palpable dans vos livres.
Vous racontez dans La Barbe, qu’après avoir passé dix ans à essayer d’attirer l’attention sur vous par la barbe et la tenue, Omaar Benlaala, vous avez finalement trouvé l’apaisement dans l’anonymat : redevenant invisible dans la foule. Quant à vous Emmanuelle Pagano, la façon de raconter votre famille dans Saufs Riverains est emprunte d’humilité ; vous liez cette histoire humaine à l’histoire du territoire, vous semblez être perpétuellement consciente que tout homme, aussi brillant qu’il puisse être, n’est qu’une petite unité dans un espace et dans un temps gigantesque. Votre roman commence d’ailleurs à moins un million et quatre-cent-milles années, date à laquelle vous faites débuter votre récit de l’histoire de ce paysage.
Ce lien entre la notion d’humilité et l’écrivain n’est pas évident : nous faisons nous même partie d’un master de création littéraire, on a le rêve de se faire publier un jour : c’est personnel, mais parfois je me demande ce qu’il y a d’humble à vouloir être lu par un grand nombre. D‘avoir cette prétention de penser que ce qu’on écrit vaut la peine d’être lu.
Emmanuel Pagano — On apprend très vite quand on est écrivain en France, et apparemment au Mexique aussi, qu’on ne va pas vivre de ça. Et que ça va être la galère. En plus c’est un métier exigeant, on est obligé de travailler tous les jours quasiment, au moins quelques minutes, surtout quand on est dans un roman. Les nouvelles c’est un peu différent, mais il faut toujours au moins noter quelques petites choses. On y est tous les matins et il faut s’y mettre constamment : c’est fastidieux. Laborieux. Pour des clopinettes.
Je le vois par le regard des autres. Mon compagnon me dit : « Je ne savais pas que c’était ça. » « Même aujourd’hui tu vas travailler ? On est dimanche. » « Mais il est 6 heures du matin ! » Pour gagner trois francs six sous.
Par rapport au livre dont vous parlez, il y a aussi une chose qui s’est produite : vu que je pars sur des temps immémoriaux, mon histoire fait toute petite à côté de tout ce qu’il s’est passé dans cette vallée depuis si longtemps, évidemment ça me remet à ma place. En voulant raconter cette histoire j’ai croisé des personnages qui étaient des personnes dont on ne peut être qu’admiratif. Notamment par exemple un facteur d’orgue, Dom Bedos. À cette occasion j’ai parlé de Toulouse, il est rentré dans la congrégation des bénédictins à la Daurade : du coup je décris ce moment où à 17 ans il prend l’habit. Non seulement il a fait évoluer la facture d’orgue, mais il a aussi fait évoluer la gnomonique, l’art de construire des cadrans solaires : il a écrit deux traités sur les deux sujets qui font encore référence aujourd’hui, et je vous parle du 18e siècle. À côté de l’œuvre et le travail de cet homme qui est considérable, comment ne pas être humble quand je parle un peu de mon travail dans ce livre ?
Ce n’est pas pour vous décourager, mais je crois qu’on est vite remis à notre place. Obtenir le succès qui nous permettrait de vivre de nos droits d’auteurs, on ne sait même pas si c’est souhaitable quand on voit les œuvres qui atteignent ce cas.
Heureusement, il y a des livres formidables qui ont beaucoup de lecteurs, mais c’est quand même rare par rapport à la plupart des livres qui ont beaucoup de succès. Je ne me sentirai pas fière d’avoir écrit ces livres. Il faut suffisamment d’orgueil pour écrire un texte que n’importe qui peut lire, et de courage peut-être : mais aussi il faut se dire que très peu de gens vont lire ce livre. Peut-être encore moins l’aimer. Mais ce n’est pas grave, on continue notre chemin.
Comme disait mon voisin (Omar Benlaala) : ça permet des rencontres, des échanges et surtout d’apprendre. Je suis tout à fait d’accord avec lui. J’ai fait de très longues études et j’ai appris beaucoup de choses, mais en écrivant j’en apprends encore plus. Finalement je continue. J’ai arrêté ma thèse en cours de route, pour des raisons compliquées. Mais je passe mon temps maintenant que j’écris à faire des recherches. À ma façon, à mon rythme, comme je veux. Toute la phase de recherche et d’interrogation, je me régale.
On n’apprend pas forcément plus à l’école par rapport au métier que l’on fait, qui peut être n’importe quel métier.
Omar Benlaala — Moi j’étais déjà humble, donc je n’ai pas ce problème ! (Rires) Je rejoins ce qui vient d’être dit. Quand on retourne à l’école, il faut il y aller humblement. On écoute les professeurs, on prend des notes, on est un élément dans la classe : c’est le sentiment que j’ai avec la littérature. C’est beaucoup plus grand que moi, ça me dépasse. Surtout quand je commence à faire des recherches.
Autant les deux premiers livres, le premier est sorti d’un trait : ce qu’il y a à l’intérieur, il fallait que ça sorte depuis longtemps. Le second je l’ai écrit très rapidement car il fallait réagir très rapidement : celui que j’écris maintenant me demande plus de recherches.
Je viens de lire la thèse d’Alain Corbin sur le Limousin : c’est assez compliqué, il y a des mots que je ne comprends pas, je dois sortir le dictionnaire. Cette humilité arrive forcément. On ne peut pas essayer de faire de la bonne littérature, si tant est qu’il y ait de la bonne ou de la mauvaise littérature, sans l’être un peu. Dans mon cas c’est ce qui se passe.
Pour revenir au personnage de Lucas, dans L’Effraction, Reda est un étudiant qui rencontre Édouard et qui veut de lui des informations pour compléter ses connaissances. Tu ne peux pas demander à quelqu’un de t’informer sans être d’abord humble, il y a déjà la question.
Le parcours que je raconte dans La Barbe, même si de nombreux journalistes étaient très excités parce qu’il est sorti après les attentats de janvier 2015 : et qu‘il y a un passage où, après avoir trainé dans la rue, fait un petit peu de prison, toutes ces choses-là, je me retrouve à la Mosquée avec un groupe de prêcheur et je me laisse pousser la barbe. Et je commence à parler avec eux, à prêcher les copains du quartier. Ce passage pour eux était vraiment très important, ils m‘en ont parlé ainsi : « Alors comment c’est, est-ce que vous êtes un repenti ou pas ? »
Non, non. Je n’ai rien fait de répréhensible, tout va bien.
Il y avait cette humilité-là qui est arrivée à ce moment, lié une fois de plus à la langue. Quand on est déscolarisé et qu’on se retrouve à ne plus avoir de conversations un peu plus construites, à ne plus lire, on perd énormément de vocabulaire, on perd de toutes ces choses qui font qu’on grandit, surtout quand on est adolescent. En arrivant à la mosquée j’ai rencontré un groupe de prêcheur et ce groupe parlait correctement. S’exprimait correctement. Avec des phrases, des métaphores. Il y avait une dimension historique aussi, puisque la première discussion que j’ai eue a été sur prénom : Je m’appelle Omar. Et on m’a refait la genèse de mon prénom. « Omar était un compagnon du Prophète, c’était quelqu’un de valeureux… », etc.
Je me suis retrouvé de l’adolescent orgueilleux qui avait fait de la prison à 18 ans, qui était une espèce de petit caïd, à rencontrer des gens qui étaient beaucoup plus fort que moi parce qu’ils maniaient la parole. Je trouve ça avec la littérature. Autant je pouvais être fier de moi avant de commencer à écrire un livre, et de penser que maintenant je sais m’exprimer, que ça va, je suis un adulte : autant quand vous ouvrez certains livres et que vous commencez vous-même à essayer d’en écrire : ça vous calme directement.
J’ai besoin de cette dose-là, et je le fais aussi pour ça. Pour me garder d’une certaine manière les pieds sur terre. Parfois l’égo fait qu’on peut vite avoir envie de s’envoler. Quand vous êtes face à votre page et que vous avez un projet d’écriture, surtout si c’est d’ordre historique, qu’il faut aller se renseigner, ne pas dire trop de bêtises, c’est encore plus humiliant dans le bon sens du terme. J’en ai besoin et je suis ravi d’avoir cette dose pour m’amener à cette étape.
Dimitri Thomas — Et vous Martín Solares ?
Martín Solares — Moi, c’est ce que je cherche : la dose de littérature quotidienne. J’ai vraiment besoin de ça. Les jours où je n’arrive pas à écrire, parce que je suis en train de voyager ou de faire une démarche administrative, Aarh ! Je suis de très mauvaise humeur ! Je suis comme une sorte d’alcoolique qui n’aurait pas bu… Au début de ma carrière, les nouvelles que j’ai publiées, je les ai publiées sous un pseudonyme. Parce que j’étais vraiment timide. Je ne voulais pas signer avec mon nom.
Ma petite amie de l’époque m’avait convaincu d’envoyer une nouvelle à un concours sous mon nom cette fois-ci… et j’ai gagné. J’étais horrifié !
« Qu’est-ce que je vais faire ??!! »
Personne ne savait que j’écrivais des nouvelles ! J’avais même l’intention de convaincre une amie à moi d’être là pour recevoir le prix à ma place ! (Rires) Ça n’a pas été nécessaire. Le maire de la ville qui remettait le prix littéraire est arrivé, très pressé, il m’a regardé et m’a dit :
« Vous venez pour le prix n’est-ce pas ?
….— Oui.
….— OK, venez ! » Et il s’est trompé… il m’a pris pour un membre du jury !
Il y avait trois prix, un pour le roman, la nouvelle et la poésie. Le maire me dit : « On est trop pressé, on doit faire ça rapidement. » Moi, timide : « Oui oui oui, OK d’accord. » Il me donne le premier diplôme : « Donne à cette personne le prix national de poésie. » Je le fais. Le lauréat était très content. Je lui donne son chèque : il était très content aussi.
Voilà que le maire me donne le prix national du roman : rebelote.
Quand le maire a dit : « Maintenant, il temps de remettre le prix national de la nouvelle », j’ai dit : « Accordez-moi quelques instants. » J’ai fait le tour de la table, je suis descendu de scène, et j’ai essayé de prendre le diplôme et le chèque.
Et là, le maire m’a dit : « Vous ne pouvez pas être membre du jury et gagner le prix ! »
J’ai passé cinq minutes à essayer de le convaincre que je n’étais pas du tout le membre du jury ! (qui se trouvait dans le public et n’y comprenait rien. Qu’est-ce que je faisais là ?) C’était l’un des moments les plus embarrassants de ma vie ! Digne de Groucho Marx ! Mais je me suis dit une chose : Pourquoi m’est-il arrivé ça la première fois où je me suis transformé en un écrivain public ? Au moment où je cesse d’être un écrivain secret, je commence avec une scène des frères Marx ou de Woody Allen !
Depuis, j’ai essayé de trouver cette dose, que je mets dans une sorte de bouteille chaque jour et que j’essaie de jeter à la mer. De temps en temps, je fais la rencontre d’un lecteur ou d’une lectrice qui a lu une nouvelle, un roman, un essai : et si ça passe, je me dis que c’est une de ces bouteilles qui vient de la mer. Et pour moi c’est un miracle.
Public — Quand vous écrivez est-ce que vous vous sentez censuré par le fait que vos parents vont vous lire ? Qu’est-ce que change le fait d’avoir des parents qui lisent vos livres ?
Omar Benlaala — C’est une excellente question, elle m’est centrale : mes parents ne lisent pas le livre, ils le déchiffrent.
Pour La Barbe ils ont mis environ six mois à le lire alors que vous voyez qu’il est très fin (101 pages, N.D.L.R.). Ils déchiffrent en fait, comme ils déchiffrent les stations de métro pour savoir plus ou moins où ils sont.
Quand L’Effraction est sorti, il y a un long chapitre sur la masturbation ou Reda explique que les premières violences sexuelles qu’il a connues sont celles qu’il a connues à travers la masturbation, où il le faisait le plus rapidement possible pour ne pas être trouvé par ses parents. On a fait la présentation dans une librairie à Paris, il y avait du monde, et puis il y avait ma mère et mon père : m’a mère a son petit fichu, vous savez c’est vraiment la maman Kabyle qui ne sort pratiquement jamais de chez elle sauf pour aller faire les courses. Et à un moment je parle de masturbation et je vois le visage de mes parents devenir blême. Après en les raccompagnant, elle m’a dit : « Oui c’était très bien. Mais la prochaine fois ne dit pas de gros mot. » (Rires)

Omar Benlaala, Negar Djavadi et Abdellah Taïa avant la rencontre France, identités multiples © par L’Œil de Gilles Vidal
C’est intéressant comme réaction qu’elle a : pour elle ce n’est pas un gros mot comme nous l’entendons. C’est un mot qui est trop gros pour elle. Déjà pour nous parfois en tant qu’adultes. « Masturbation » c’est un mot qu’on a du mal à placer dans une conversation : hier on en a parlé pendant la rencontre avec Abdellah Taïa (présent lors des petits déjeuners littéraires) et Négar Djavadi (France, identités multiples, au Centre Culturel Bellegarde) et des gens sont sortis de la salle. Parce qu’on parlait de masturbation et de sexualité, donc imaginez-vous pour elle : mais pas par pudeur. C’est ce que j’essaie d’expliquer dans L’Effraction, ce n’est pas une pudeur culturelle, c’est un problème de vocabulaire. Elle ne sait pas véritablement ce que cela englobe : mes parents n’ont peut-être jamais ouvert un dictionnaire de leur vie.
Autant le premier livre était un exercice autobiographique. Autant le second était vraiment un exercice autour du dialogue. Le troisième je les interroge et je vais essayer de garder leur oralité, autant que possible. Pas pour faire plus authentique, mais qu’ils puissent se lire. C’est leur témoignage et j’aimerais arriver à ça. Ce n’est pas du tout facile.
J’essaie de lui faire parler à Reda un langage un peu plus populaire. Pour eux, c’est un autre challenge : il va vraiment falloir que je garde leur intonation, leur façon de parler, leur tonalité, leurs silences aussi.
Mon objectif est qu’ils puissent lire leur histoire.
J’essaie moi-même maintenant de plus en plus de ne pas aller dans des envolées lyriques, des formules, des belles choses un peu littéraires, sinon ils ne pourront pas me lire. Tout mon travail c’est de garder cet équilibre-là. En tout cas pour le troisième. Le premier je me suis fait plaisir. Le troisième est un livre que j’aimerais partager avec eux.
Public — Peut-on écrire sans souffrance, sans se faire souffrir ? Quel est votre avis pour vous ?
Emmanuel Pagano — Pour ma part, je pense juste que ce n’est pas facile même si c’est quelque chose que l’on choisit. À part lorsqu’on se sent obligé d’écrire — quand on en fait le métier, c’est un choix. Je ne sais pas si c’est de la souffrance, mais il y a une espèce de pénibilité. Mais est-ce vraiment nécessaire de souffrir pour arriver à quelque chose ? Je n’irais pas jusque là.
Martín Solares — On est obligé de trouver un équilibre entre les sacrifices, la souffrance et la vie. Par exemple, avant de finir ce roman, j’ai fait beaucoup de sacrifices. J’ai sacrifié beaucoup de temps avec mes amis, je n’ai pas accepté beaucoup de voyages, ou d’aller à beaucoup de fêtes. Et je me disais souvent « Oh, j’aurais dû être à la fête de mon meilleur ami ce soir… » mais j’avais promis à l’éditeur de lui envoyer le livre, et ne l’ayant pas fini, je ne pouvais pas m‘y soustraire.
Mais une fois que ma fille et mes fils sont arrivés, j’ai commencé à comprendre qu’on doit trouver un équilibre. Je ne peux pas sacrifier leur enfance : c’est pour ça que je me lève très tôt. Une fois qu’ils sont réveillés, je vais jouer avec eux, je les emmène à l’école, avant de retourner chez moi afin d’écrire. Mais surtout je crois que vous pouvez faire toutes les expériences que vous voulez dans l’écriture : vous avez le droit de souffrir dans le processus, si vous y êtes obligé, mais vous n’êtes pas du tout obligé de publier la souffrance. Vous êtes obligé de transformer votre souffrance en plaisir.
Le roman c’est un laboratoire de la vie. Vous n’êtes pas obligé de publier toutes vos expériences, vous pouvez vous contenter de vos trouvailles.
Ce qu’on cherche, c’est une nouvelle façon de dire une phrase magique qui nous a accompagnés pendant des millions d’années ; on cherche une nouvelle façon de dire : Il était une fois. C’est ce que j’essaie de trouver tout le temps, une phrase après l’autre. J’essaie de provoquer une question dans la tête de mes lecteurs : « Et maintenant que va-t-il se passer ? »
Omar Benlaala — Personnellement, je n’ai pas l’impression de souffrir. Le cadre dans lequel j’écris, chez moi, je suis en sécurité. Je suis bien entouré, j’ai un ordinateur qui fonctionne, j’ai accès à des livres quand j’ai besoin de livres : ce n’est pas l’idée que je me fais de la souffrance en tout cas !
Dans La Barbe je raconte mon premier ou deuxième voyage avec mon groupe de copains quand on commence à prêcher, on va dans tous les pays musulmans. Et à un moment on va en Inde. Pour aller d’Inde au Bangladesh, vous passez par Calcutta : il y a dans une région un quartier (peut-être qu’il existe encore d’ailleurs, c’était au mi-temps des années 90) où se trouve une place où avec plein de morceaux de ferrailles. Et des gens passent leurs journées et leurs nuits, de l’enfant de 4-5 ans, au vieillard qui va mourir à la fin de la journée, ils y passent leur vie, à taper sur cette ferraille pour qu’elle soit la plus plate possible. Je suis resté 15 jours dans ce quartier à les observer. Quand ils sont exténués, ils rentrent dans leur sac en toile de jute, et ils dorment. Et à un moment on leur ramène un plat à base de riz. à mon avis ils font ça toute leur vie : je ne sais même pas s’ils imaginent qu’autre chose puisse exister. Là on peut parler de souffrance. Moi dans mon cas, même dans ma vie de tous les jours, je ne sais pas si j’ai un jour véritablement souffert. On est quand même des privilégiés.
On a parfois tendance à l’oublier, mais quand vous voyagez un petit peu, ne serait-ce que le matin même, vous allumez la télévision et voyez la situation de certaines personnes, je ne sais pas si je peux me permettre de dire qu’en écrivant un livre je souffre. C’est mon avis après. Même si ça fait romantique, si ça fait écrivain qui souffre, moi je ne souffre pas. Regardez mes mains, tout va bien quoi.

Martín Solares – No manden flores
Public — Par curiosité, monsieur Solares, écrivez-vous dans votre langue maternelle ou en français ? Vous parlez bien français.
Martín Solares — Je n’écris qu’en espagnol du golfe du Mexique. Je suis tout le temps en train d’écouter l’accent de ma ville natale, j’essaie de faire une chose différente, mais je continue à écrire avec la musique de ma terre natale. Mes deux romans sont comme des chansons, avec la musique qu’on a apprise dans la rue. Je voyage toujours avec de quoi prendre des notes, pour avoir des phrases, des mots que j’entends : des petites briques. J’essaie de faire mes romans avec ces briques qu’on peut trouver partout.
Parfois il y a deux ou trois mots que je collecte dans la rue et je sais que le roman va se bâtir autour. Pour moi c’est très important de lier le fantastique au réalisme. Au Mexique il y a une cascade de livres sur la violence ! Tous les journaux parlaient de ça, mais maintenant, il y a une censure très forte et ce n’est pas bon du tout. Quand vous manquez d’informations vous devenez paranoïaque tout le temps. Dans certaines régions de mon pays, c’est une chose presque criminelle, de cacher l’information. Parce que si vous entendez des rafales… vous voulez savoir ce qu’il se passe dans la rue. Si vous pouvez sortir ou pas. Et si les journaux interdisent d’écrire dessus, même sur Twitter, c’est une chose criminelle. Avec cette situation, en tant qu‘écrivains qui essaient de construire des romans littéraires, capables de vous faire rêver, on est obligé de se poser la question tout le temps. Ce n’est pas le miroir qui va refléter la violence, c’est autre chose. J’essaie de briser le miroir, de le manger, et une fois que je l’ai digéré, de faire le roman.
Mes amis qui écrivent des romans noirs au Mexique m’ont dit : « Tes romans sont très littéraires pour nous, qui écrivons des romans noirs. » Et les écrivains plus « littéraires » me disent : « Vos romans sont très peu littéraire pour nous, qui écrivons des romans “littéraires“. » Je suis quelque part dans un no man’s land. Le triangle des Bermudes littéraires ! Et pour l’instant il n’y a qu’un seul habitant et c’est moi. (Rires)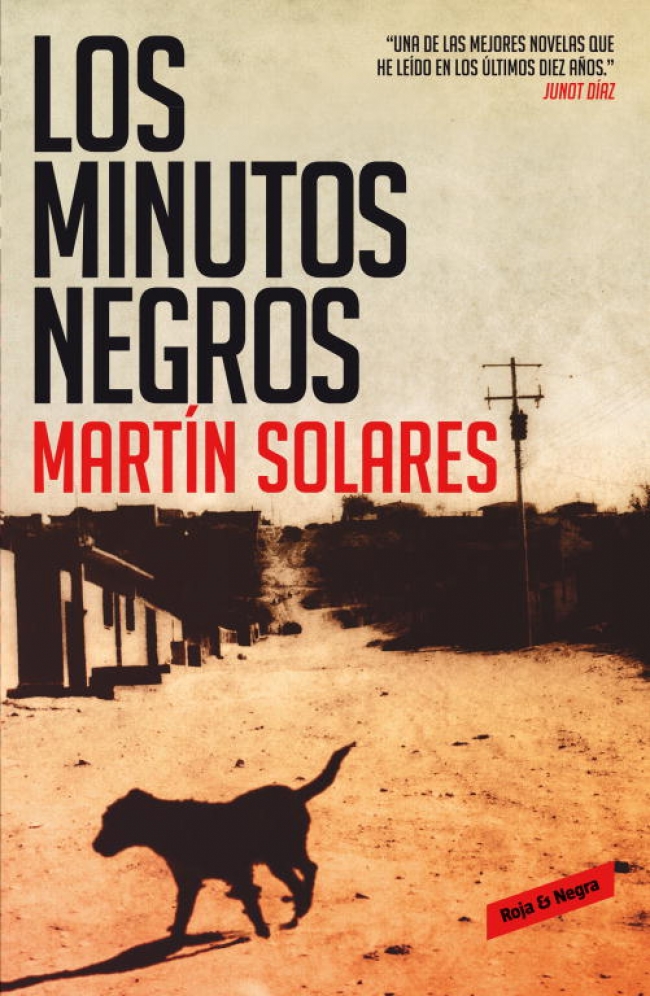
Public — Est-ce que vous laissez à vos traducteurs la liberté du choix de leurs mots ?
Martín Solares — J’ai travaillé étroitement avec Christilla Vassero et avec mes traducteurs anglais. Pour le Polonais, j’ai dû faire confiance à mon traducteur. Pareil pour le Russe et le Coréen. Un éditeur coréen m’a dit : on va faire publier ton roman ! J’étais très content ! Mais chaque fois que je pose la question à mon agent, il ne sait pas si le livre est sorti. « Comment est-ce que vous ne savez pas ? » je lui demande. Et il me répond : « C’est parce que le site est en Coréen… je n’arrive pas à savoir ! » (Rires)
Mon livre a déjà été publié en Corée… ou non. Mais pour moi c’est un grand honneur.
Toute mon enfance j’ai écouté des histoires avant de m’endormir. Des histoires fantastiques sur des géants, sur des morts, sur des princesses. J’essaie d’écrire une sorte de combinaison littéraire qui produise un effet magique. Je suis convaincu qu’avec les mots on est capable de créer une sorte de magie. Chaque fois qu’on dit : « il était une fois » quelque chose se passe.
« Je suis venu à Comala parce que j’ai appris que mon père, un certain Pedro Paramo, y vivait. » C’est le meilleur roman du Mexique, Perdro Paramo, de Juan Rulfo (Gallimard, collection L’imaginaire). Je crois en cette magie discrète, très simple. J’aimerais que mes narrateurs soient capables de faire un sort de magie discret, parce que les lecteurs le méritent.
le 24 juin 2017,
La Terrasse | Musée du Vieux Toulouse
Fin de la rencontre
Bibliographie
L’Effraction :
« Hédi et moi, j’ai bien vu qu’on n’était pas pareils. Pourquoi le nier, Jean-François ? Tout est fait pour pas se rencontrer. »
Omar Benlaala déplace les personnages qu’Édouard Louis a mis en scène dans son Histoire de la violence. Un autre regard, une autre voix : ceux d’un jeune Parisien d’origine kabyle. Ce dernier se livre au sociologue qui l’interroge après les événements de Cologne, dans le cadre d’une enquête sur la sexualité des Français « issus de l’immigration ». De confidence en confidence, il dévoile à cet homme ses frustrations, ses rêves, ses souvenirs, son secret – une histoire que l’Histoire a trouée : celle des fils et petits-fils d’une société déchirée par son passé colonial. La littérature se transforme ici en arme politique. Édifiant.

Omar Benlaala
L’Effraction ~ L’Aube
ISBN : 978-2-8159-1961-6
96 pages
Prix public 12 €
N’envoyez pas de fleurs :
Qui vient d’enlever la jeune Cristina, fille d’un riche couple ? Qui est son fiancé, qui l’accompagnait ? Un événement banal dans la région de La Eternidad, dans le golfe du Mexique. Carlos Trevio, un ancien policier, est chargé de l’enquête. Le consul américain Don Williams offre aussi ses services.
Récit impitoyable, désabusé, drôle, Martín Solares, dans la grande tradition du roman noir, convoque les témoins pour les faire parler et mentir. Police corrompue, services secrets partisans, meurtres, enlèvements, bandes rivales sont une allégorie du Mexique contemporain.

Martín Solares
N’envoyez pas de fleurs ~ Christian Bourgois éditeurs
ISBN : 978-2-267-03241-3
384 pages
Prix public 25 €
Saufs Riverains, Trilogie des rives II :
« Hédi et moi, j’ai bien vu qu’on n’était pas pareils. Pourquoi le nier, Jean-François ? Tout est fait pour pas se rencontrer. »
Omar Benlaala déplace les personnages qu’Édouard Louis a mis en scène dans son Histoire de la violence. Un autre regard, une autre voix : ceux d’un jeune Parisien d’origine kabyle. Ce dernier se livre au sociologue qui l’interroge après les événements de Cologne, dans le cadre d’une enquête sur la sexualité des Français « issus de l’immigration ». De confidence en confidence, il dévoile à cet homme ses frustrations, ses rêves, ses souvenirs, son secret – une histoire que l’Histoire a trouée : celle des fils et petits-fils d’une société déchirée par son passé colonial. La littérature se transforme ici en arme politique. Édifiant.
 Emmanuelle Pagano
Emmanuelle Pagano
Saufs Riverains, Prix du roman d’écologie 2018
Éditions P.O.L
ISBN : 978-2-8180-4148-2
400 pages
Prix public 19,5 €