Marathon des mots
13e festival international de littérature
La vie des autres
Blandine Rinkel (L’abandon des prétentions, Fayard) et Aura Xilonen (Gabacho, Liana Levi), continuent leur discussion sur leur rapport à la littérature attablées en Terrasse du Musée du Vieux Toulouse. Sans se revendiquer porte-parole des jeunes générations, elles transmettent leur volonté d’indépendance et de révolte et s’attardent plus en détail sur leur style littéraire et leur expérimentation de la langue.
Rencontre avec Aura Xilonen & Blandine Rinkel — 2de partie
Sommaire
1. Ouvrir des minorités
2. Catastrophe : La nuit est encore jeune
3. L’expérimentation des langues et la curiosité
4. Style de L’abandon des prétentions : les références
5. La traduction de Gabacho, Julia Chardavoine : co-autrice du livre
6. La Création de Liborio, boxeur mexicain

Entretien
Dimitri Thomas — Il y a chez toutes les deux une volonté d’indépendance et de révolte. La revendication d’une autonomie : est-ce que vous vous sentez le porte-parole d’une jeunesse plus libre ?
Aura Xilonen — Humm… Non ! (Rires) Je ne me considère pas comme le porte-parole d’une génération. C’est très difficile d’entrer dans l’esprit des personnes et savoir ce qu’elles pensent et ressentent. Je peux proposer à mes amis de lire mon livre et les menacer s’ils ne le lisent pas ! (Rires) Mais c’est la seule chose que je peux faire ! Personne n’est porte-parole. Au Mexique il y a 120 millions de personnes, ce serait trop difficile d’avoir une pensée qui résume toutes les pensées de la population. Il y a des personnes qui utilisent leurs voix dans la rue pour exprimer ce qu’ils ressentent, il y a des personnes qui n’utilisent rien. Et je pense que ça a une connotation plus politique, car c’est le gouvernement qui décide et nous sommes en quelque sorte ce troupeau de moutons qui suit la base d’un politicien, qui dit parfois des bêtises. Cela entraine une violence entre nous, on s’insulte, on se dispute.
Je suis d’accord avec ce qu’a dit Blandine et sa position sur le sujet : quand socialement, par exemple, on est reconnu pour les vêtements qu’on porte, plus que pour la personne qu’on est. Ce sont des choses qui sont aussi présentes dans mon pays… Donc je ne peux pas être le porte parole de ma génération : c’est trop compliqué. Chaque personne est très différente.
Par contre si mon bouquin aide un peu à améliorer la situation dans mon pays, si au moins une personne trouve un message d’espoir dans mon livre : comme respecter le migrant qui vient d’autres pays d’Amérique Centrale, ouvrir les portes de sa maison pour les accueillir d’une façon aimable, je serai ravi de mon apport pour la société.
Blandine Rinkel — Non, non plus. Je ne crois pas beaucoup à la jeunesse. Il n’y a peut-être pas autant de jeunes différents qu’il y a d’individus, mais il y a quand même des jeunesses qui n’ont rien à voir. Personnellement, il y a des gens qui ont mon âge et avec qui je partage bien moins de choses qu’avec des gens qui ont 54 ans. Très précisément ! (Rires) Non, c’est un peu trop grand comme ambition, trop large. Mais néanmoins : ouvrir des portes, des possibles, des fenêtres : oui. La littérature, ou le fait d’écrire ou de faire de la musique, de parler d’une manière ou d’une autre, peut ouvrir des fenêtres : surtout quand on est jeune. On peut se dire « Tient mais en fait, on est pas obligé de vivre comme ceux qui ont vécu avant nous. » Mais aussi comme on le souhaite.
On n’est pas obligé de mener la vie dont on fait le plus de publicité dans les médias.
Et les médias sont liés à la politique. On n’est pas obligé d’avoir une vie majoritaire. Il me semble que la littérature ouvre des minorités possibles. Elle ouvre des chemins de vie minoritaires et ça j’y crois. J’y crois beaucoup.
À la rentrée, en septembre, on fait paraitre un livre, avec Catastrophe, un groupe artistique dans lequel on a tous moins de 30 ans. C’est justement sur comment réinventer un nouveau monde, puisqu’on sent bien que quelque chose s’écrase. Le monde des générations précédentes semble ne plus fonctionner. Et comment en réinventer : ou en tout cas, accepter que ça tremble ? Et profiter de la crise pour apprendre à danser.
Le livre appelle : La Nuit est encore jeune, (Catastrophe | Fayard) et je pense que ça répond un peu à cette question par « Non, mais oui. » Nous ne sommes pas le porte parole d’une génération : mais on essaie tout de même d’esquisser des possibles. et d’amener d’autres gens avec nous, qui potentiellement s’y reconnaitraient. Mais sans prétendre parler pour ceux qui ne s’y reconnaissent pas.
Robin Fillon — Parlez-nous un peu du manifeste du groupe Catastrophe. Il y a cette phrase, par exemple : « Au lycée, on nous avertit d’emblée que l’Histoire était finie. On nous expliqua que Dieu, le Roman et la Peinture étaient morts. Sur les murs de la capitale, on nous apprit que l’Amour l’était aussi. Nous n’en connaissions pas le visage que déjà, nous n’avions plus le droit d’y croire. » [1]
Blandine Rinkel — Ce n’est pas une revendication, je n’aime pas trop les revendications. (Rires) C’est juste quelque chose qui est dit et dans lequel, j’espère, certains peuvent se reconnaitre. Même le mot manifeste. On est habitué, quand plusieurs personnes écrivent un texte ensemble, d’appeler ça un manifeste. Mais dans l’idée de manifeste, il y a quelque chose d’un peu prosélyte. Je ne crois pas qu’on le soit… Je préfère ce qui est chuchoté à ce qui est revendiqué à force de poings.
Ça fait écho à L’abandon des prétentions, on a le droit de mener une vie qu’on invente sans être dans un combat constant. On peut défendre une vie sans obliger les autres à la vivre. Ou défendre une manière de voir sans obliger les autres à voir de la même manière.
Sinon, oui : puisque tout est fini alors tout est permis, c’est le titre choisi pour l’article par Libération, ce n’était pas le titre initial. Néanmoins je peux l’expliquer : c’est l’idée (et je vais parler à titre personnel parce que je suis seule) qu’on a l’impression d’avoir grandi avec un horizon bouché. Dans les discours qu’on nous répétait, c’était ce qui en ressortait. Très concrètement, à la fin de mon livre d’histoire quand j’étais adolescente, la dernière image c’était celle de La fin de l’histoire et le dernier homme, le livre de Fukuyama.

Le professeur finissait par dire, Voilà, à la fin de tout ce qu’on a vu, il y a la fin de l’histoire. Il faut refermer le livre. Ça donne une impression un peu étrange de se dire « on est à la fin de l’histoire. » Le roman est mort, parce que le roman est mort, quand même, selon les théoriciens : il y a toujours des romans, mais bon, visiblement ils n’ont pas été informés, ils ont ressuscité. L’amour est mort, à Paris on voyait ça très souvent sur tous les murs. Pleins de petites choses, comme ça, qui donnaient l’impression que quelque chose, voire tout, était arrivé à son terme. Et pourtant il allait falloir vivre. Continuer.
Et je crois que c’est une chance qu’une certaine manière de voir le monde, qu’une certaine société, qu’une certaine histoire soit en effet morte, à la fin ou en train de finir. On le voit bien par exemple avec la démocratie, c’est en train de trembler alors qu’on pensait que ça allait être éternel. On voit bien que c’est en train un peu sinon de mourir sinon de devoir se réinventer, parce que les gens ne vont plus voter, ou alors ne sont plus représentés quand ils votent. Je crois que c’est une chance : c’est justement un moment de tremblement. Quand une vague s’achève, il y en a une autre qui commence derrière. Mon image est nulle ! (Rires) Le mot Catastrophe en Grec veut dire bouleversement. Il ne veut pas dire fin de tout ou mort de tous les êtres. Il faut apprendre à réentendre ce mot.
Quand je disais que ma mère était désespérée et que, paradoxalement, c’était ce désespoir-là qui lui donnait de la liberté, je crois qu’on a une génération — je dis une génération, mais il y en a plusieurs en réalité — qui ne sont pas enchantées : on est pas dans l’idée du progrès. L’idée du progrès est un peu morte. Mais paradoxalement, ce désenchantement nous rouvre des possibles et nous donne tout à réinventer, à tenter. À penser autrement. C’est ça qu’on défend, mais qu’on ne revendique pas.
Aura Xilonen — Est-ce que ton livre sera traduit, Blandine ? J’aimerais bien le lire en espagnol !
Blandine Rinkel — Non, pas pour l’instant (Rires) Mais je veux bien ! Ce n’est pas prévu encore.
Aura Xilonen — Comment est venue l’idée à ta mère d’accueillir les migrants ? Comment ça s’est passé d’ouvrir les portes ?
Blandine Rinkel — Alors elle n’ouvre pas les portes, en fait. Elle se promène dans les rues, elle s’ennuie et elle parle aux gens ! (Rires) Il se trouve que dans la petite ville dont je viens, les personnes les plus disponibles à la discussion ne sont en général pas Françaises. Je pense juste qu’ils n’ont pas d’emploi, il y a des retraités et il y a des étrangers ou des Français nouvelle génération. Et ma mère pratiquait les langues, donc c’est venu par les langues. Elle a appris l’arabe quand elle a été à la retraite, elle ne le parle pas très bien mais elle aime bien expérimenté son début de connaissances des langues dans les rues ! (Rires)
Et quand ça prend, quand quelqu’un lui répond, elle invite les gens à prendre des cafés et puis parfois on se rend compte après le café que la personne n’a nulle part où aller et du coup elle l’accueille chez elle. Elle n’est pas dans des associations, c’est beaucoup plus hasardeux et basé sur la curiosité plutôt que sur des bons sentiments. C’est de la curiosité pour les deux personnes et il se trouve que ça aboutit.
R. F. — Les références culturelles dans votre livre, Blandine Rinkel, parsèment totalement le récit. Elles font partie de votre style. Que ce soit les héroïnes de Rubens, avec La Vénus du Jugement de Paris, George de la Tour, Fragonard, Watteau Boucher, Jean-Baptiste Greuze, (rien qu’en peinture), ou le cinéma avec des acteurs, des réalisateurs, allant de Glenn O’Brien à Kristen Stewart, ainsi que la musique et bien sûr la littérature, votre style en déborde.
Vous vous servez notamment de « La longue fuite », de F. S. Fitzgerald pour illustrer le ressentit de Jeanine tandis qu’elle patiente en attendant Moussa. Ou bien encore, il y a ce passage décrivant Jeanine, qui aime la poésie des post-its : « Comme avant elle Gogol trouvait sublime la liste des vêtements du Tsar, le poète Viazemski les cartes des vins, Pasternak celle des indications des chemins de fer. »
Qu’elle importance ont-elles pour vous, ces références ?
Blandine Rinkel — C’est une bonne question ! Sans doute que j’ai un complexe d’infériorité du fait que je n’ai pas eu toute cette culture-là quand j’étais enfant. (Rires) C’est un peu trop démonstratif je pense. En me relisant et en vous écoutant je me dis, Quand même t’en fais un peu beaucoup ! (Rires) On n’est pas obligé d’avoir tous ces noms.
R. F. — Pourtant ça fonctionne à la lecture. Ces comparaisons des petites vies, pour citer Pierre Michon, et des vies plus connues et plus marquantes dans l’histoire fonctionnent très bien pour comprendre aussi, à plus petite échelle, les ressentis des personnages.
Blandine Rinkel — Oui ! Sans doute qu’il y a de ça aussi, ce qui m’intéresse, c’est que ça se mélange : les grands noms, la grande histoire, et le plus quotidien de nos vies, le plus trivial. Personnellement je prends beaucoup de plaisir quand les livres sont des jeux d’échos. Quand c’est une espèce de miroir à l’infini.
Un peu le vertige que vous avez dans certains halls d’entrée quand un miroir est face à un autre. Ça se reflète à n’en finir jamais. J’aime bien quand la littérature donne ce vertige à force de choses qui se répondent. Je pense qu’il y a de ça. Après il y a aussi quelque chose d’assez adolescent, dont j’espère me départir : il y a un peu une démonstration de Regardez je peux citer du Watteau ! J’en suis pas particulièrement fière ! (Rires) Il y a des deux, sans doute. Une écriture juste en mettrait un peu moins et donnerait un peu plus le vertige.
D. T. — Il y a un énorme travail de la langue dans Gabacho avec un vocabulaire recherché, des néologismes et beaucoup d’argot. Vous avez dit à vos traducteurs de retransmettre « le rythme et l’imaginaire de votre vocabulaire. » Comment fonctionnez-vous avec eux ? Faites-vous une supervision de la traduction ?
Aura Xilonen — J’ai beaucoup travaillé avec Julia (Chardavoine), la traductrice française (qui a remporté pour son travail sur Gabacho le Grand Prix de la traduction de la Ville d’Arles). Elle est incroyable et elle est douée d’une mémoire prodigieuse. Le fait d’avoir vécu au Mexique a été très important pour elle, elle a pu retransmettre le rythme de la langue et l’humour mexicain. J’ai beaucoup travaillé avec elle par mail, ainsi qu’avec trois autres traducteurs qui s’occupaient du livre dans d’autres langues.
Ils me posaient des questions et je faisais en sorte de leur répondre le plus rapidement possible. En sachant que nous étions dans différents pays avec des fuseaux horaires décalés, les échanges se déroulaient ainsi.
Comme Julia maîtrise aussi l’anglais et le russe, elle a pu partager avec les autres traducteurs. Il y a eu une grosse communication entre nous tous. Je pense que ça a permis une bonne traduction.
Avant tout, je leur ai expliqué qu’il n’était pas important de savoir le sens exact de chaque mot.
Car lorsque je rédigeais le livre, je trouvais des mots précis, qui me plaisaient, et que je pensais parfaits pour exprimer ce qu’ils représentaient. Et maintenant, cinq ans plus tard à la lecture, je ne me souviens pas pourquoi je les ai choisis ! (Rires) Donc quand j’ai eu l’occasion de partager avec les traducteurs, je leur ai demandé de favoriser leur lecture et leur imaginaire plutôt que de se calquer mot pour mot sur la mienne.
Pour ma part, j’ai rédigé le livre dans un contexte très mexicain. Mais ce n’est pas le cas pour eux ou les lecteurs étrangers : donc je leur ai demandé de transmettre les idées, quitte à changer légèrement la forme. Si je choisi à un moment dans le livre de mettre la couleur blanche, et que pour tel traducteur, il trouve que la signification de cette couleur, dans son pays, n’est pas la même : alors il peut choisir d’utiliser le rouge s’il pense que cela colle mieux. Peu importe. Ce qui compte pour moi, c’est qu’ils transmettent les idées et le message, le rythme et la forme de la langue avec leur propre langue.
C’est pour ça que je n’utilise pas le terme traducteur, je préfère utiliser le mot coauteur. Le travail de traducteur et mon travail.
On a cherché l’acceptation globale de mon histoire plus qu’une traduction précise.
Je leur ai permis de traduire le livre comme ils voulaient, le livre ne m’appartenait plus, il était à eux. La rédaction du livre, en espagnol, a été facile pour moi. Et je me suis rendu compte que sa traduction était difficile ! Il s’agit d’enjeux culturels, d’argot, et surtout, l’humour présent dans le livre est apparu comme étant le plus difficile à traduire. Les traducteurs me racontaient qu’ils trouvaient les réponses aux tournures de phrases et aux blagues qu’ils devaient réécrire pendant qu’ils étaient dans le bus, qu’ils marchaient ou bien pendant qu’ils parlaient avec des gens.
Pour citer un exemple j’utilise toujours le terme tête de cul dans mon livre, et un traducteur m’a dit « Ah ! Quand j’étais petit ma grand-mère utilisait toujours tel terme », et ce n’était pas la traduction littérale, mais c’était ça l’expression que je voulais transmettre. C’est comme ça que les traducteurs sont devenus des propriétaires de mon livre.
Discussion avec le Public
Public — Pour la création de Liborio, est-il inspiré de boxeurs réels comme Kid Pambelé, un boxeur colombien ?
Aura Xilonen — Pour la création de Liborio je ne me suis pas inspirée de boxeurs célèbres. Par contre, j’ai regardé beaucoup de vidéos de boxe sur internet, je me suis renseignée par rapport aux catégories. Je connais un boxeur « de rue » dans mon village, qui était un boxeur pauvre, qui faisait ça pour gagner sa vie et il ne récoltait que quelques pesos.
Il m’a montré des photos, les trophées qu’il avait gagnés, il m’a expliqué comment cela se passait et finalement, il a fini dans la misère.
Je ne sais pas pourquoi la boxe, dans mon pays, est un sport qui est vraiment lié avec ce milieu social défavorisé, ce sont des personnes pauvres qui trouvent le succès, et qui finissent à nouveau leur vie dans la pauvreté. Vu qu’ils n’ont jamais eu les ressources, une fois qu’ils en ont, ils dépensent l’argent pour acheter des voitures, diverses choses, et finissent par dilapider leur fortune.
C’est ce contexte qui m’a motivée et ce sont les rencontres que j’ai faites qui ont créé Liborio.
Public — Il y a une dimension assez universelle dans Gabacho, Liborio est un personnage qui a un côté un peu super-héroïque dans la puissance qu’il peut dégager avec ses poings par rapport au physique qu’il a. Il y a plein de gens qui n’ont pas beaucoup de moyens et finalement ça se retrouve dans la richesse de leur vocabulaire aussi.
Aura Xilonen — Le livre est une évolution complète du personnage, depuis la perspective physique jusqu’à la perspective intellectuelle et émotionnelle.
Pour l’évolution physique, il va devenir boxeur, avec un peu de technique, en s’entrainant. En ce qui concerne la partie émotionnelle il va découvrir l’amour et se rendre compte que ce n’est pas toujours rose, que c’est parfois difficile. Mais c’est surtout sur la langue qu’il y a une grande évolution. Il a appris la langue, enfant, dans la rue. Pour lui ce n’est pas important si les termes sont bien utilisés : il les a entendus donc il les utilise, peu importe s’il ne connait pas trop le sens. Liborio possède en plus une mémoire incroyable : comme la traductrice de mon livre ! Si pour lui le mot qu’il utilise a une bonne sonorité, il l’utilise. Ce n’est qu’après, quand il commence à travailler dans la librairie et qu’il commence à lire, qu’il se rend compte que le langage est plus grand et c’est comme ça qu’il commence à employer des termes plus raccords avec ce qu’il veut dire, même s’ils sont parfois plus compliqués.
Petite j’étais très curieuse en ce qui concerne la langue, si j’entendais un mot ou une expression que je ne comprenais pas, je le notais, après je rentrais à la maison et je demandais à ma mère ce que ça voulait dire. Et ma mère me donnait une liste de synonyme pour aller avec le mot ! (Rires) Et peu à peu j’ai construit un dictionnaire. Puis je me suis mise à jouer avec la langue, je changeais les préfixes, les suffises, et je me suis rendu compte qu’il était très facile en espagnol de créer des verbes ! Comme les enfants finalement qui essaient parfois de trouver un mot et en inventent un sans le savoir. C’était comme construire un bâtiment et rajouter des étages par-dessus. Quand j’ai commencé à rédiger Gabacho, je donnais mes parties à ma grand-mère pour qu’elle le lise et j’ai vu qu’elle s’amusait. Elle a commencé à rire. Et j’ai compris que je voulais suivre ce chemin. Utiliser l’humour pour transmettre mes idées. Ça c’est fait comme ça.
le 25 juin 2017,
La Terrasse | Musée du Vieux Toulouse
Fin de la rencontre
La rencontre a été animée par Dimitri Thomas et Robin Fillon et organisée dans le cadre du Mathon des mots en collaboration avec le master Création littéraire de Toulouse Jean Jaurès. Sergio Gomez a assuré la traduction de ce petit-déjeuner.
Résumé des œuvres
Gabacho :
Liborio n’a rien à perdre et peur de rien. Enfant des rues, il a fui son Mexique natal et traversé la frontière au péril de sa vie à la poursuite du rêve américain. Narrateur de sa propre histoire, il raconte ses galères de jeune clandestin qui croise sur sa route des gens parfois bienveillants et d’autres qui veulent sa peau. Dans la ville du sud des États-Unis où il s’est réfugié, il trouve un petit boulot dans une librairie hispanique, lit tout ce qui lui tombe sous la main, fantasme sur la jolie voisine et ne craint pas la bagarre…
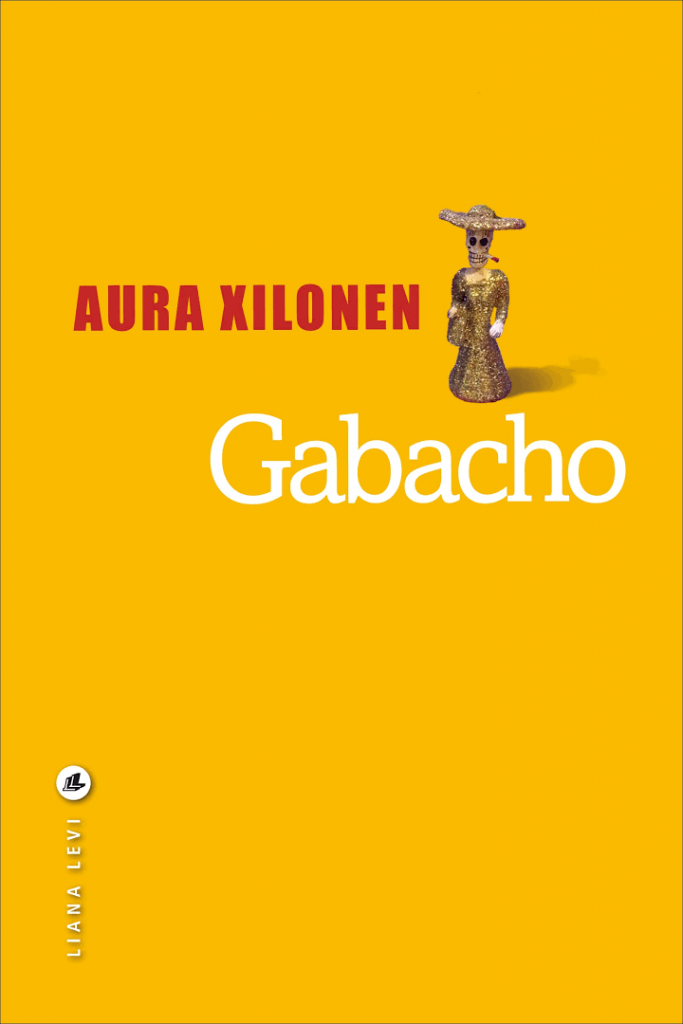
Récit aussi émouvant qu’hilarant, Gabacho raconte l’histoire d’un garçon qui tente de se faire une place à coups de poing et de mots. Un roman d’initiation mené tambour battant et porté par une écriture ébouriffante.
Aura Xilonen
Gabacho ~ Liana Levi
ISBN : 9791034900015
364 pages
Prix public 12,50 €
L’abandon des prétentions :
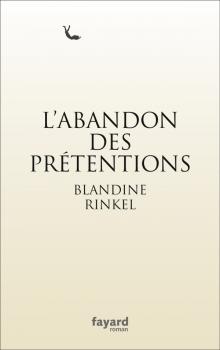
Blandine Rinkel
L’abandon des prétentions ~ Fayard
ISBN : 9782213701905
248 pages
Prix public 6,90 €
[1] « Puisque tout est fini, alors tout est permis », Libréation, Publié le 26 septembre 2016 http://www.liberation.fr/debats/2016/09/22/puisque-tout-est-fini-alors-tout-est-permis_1506625





