Marathon des mots
13e festival international de littérature
Petits déjeuners littéraires
La Terrasse du Marathon accueillait une conversation à bâtons rompus avec l’écrivain et cinéaste Abdellah Taïa, figure engagée de la scène littéraire franco-marocaine. La rencontre s’axait autour de son dernier roman, Celui qui est digne d’être aimé, paru aux Éditions du Seuil (2017), le public profitant de l’occasion pour discuter librement avec l’auteur grâce à la proximité instaurée dans ces petits-déjeuners littéraires.
Rencontre avec Abdellah Taïa — 1re partie
Sommaire
1. Abdellah Taïa : courte biographie
2. Celui qui est digne d’être aimé et Les lettres portugaises
3. Lettre à la mère : un portrait de femme
4. Œuvre et vie

Mais avant d’attaquer, voici un court résumé du roman :
Celui qui est digne d’être aimé :
À 40 ans, Ahmed, marocain vit à Paris. Il écrit à sa mère, morte cinq ans auparavant, pour régler ses comptes avec elle et lui raconter enfin sa vie d’homosexuel, et envoie une lettre de rupture à Emmanuel, l’homme qu’il a aimé passionnément et qui a changé son existence, pour le meilleur et pour le pire, en le ramenant en France. Par ailleurs, Ahmed reçoit des lettres de Vincent et de Lahbib.
Un roman épistolaire pour remonter le temps jusqu’aux origines du mal, et un livre sur le colonialisme français qui perdure dans la vie amoureuse d’un jeune Marocain homosexuel.
La rencontre a été animée par Dimitri Thomas et Robin Fillon, étudiants du master Création littéraire de Toulouse Jean Jaurès, à la Terrasse de l’Hôtel Dumay, au Musée du Vieux Toulouse.
Entretien
Dimitri Thomas — Abdellah Taïa, vous avez 43 ans, vous êtes né au Maroc, à Salé près de Rabat. Vous venez d’une famille modeste et vous avez appris le français à 18 ans.
Abdellah Taïa — Disons que je l’ai maîtrisé à 18 ans. Au Maroc, on nous apprend le français à partir de dix ans dans l’école publique. J’ai commencé à vraiment le maîtriser et bosser dessus à partir de 18 ans, mais j’avais quelques notions quand même.
D. T. — Vous arrivez à Paris à 26 ans, en 1999, après une maîtrise de littérature française à Rabat.
Oui, et un DEA aussi sur Marcel Proust. On m’a donné une bourse pour aller d’abord en Suisse faire un DES (à l’époque cela existait encore) en littérature française du 18e siècle. Je l’ai fait à Genève et ensuite je suis venu à Paris pour faire à nouveau un DEA à la Sorbonne sur la littérature du 18e siècle, c’est mon siècle préféré (en France et dans l’histoire de la France). La littérature libertine, les philosophes, l’invention de l’encyclopédie, la peinture, pleins de choses qui ont préparé la révolution. Et j’ai commencé une thèse de doctorat à La Sorbonne, que je n’ai pas terminée. Sur le peintre Fragonard, que j’adore. Fragonard et le roman libertin : comment l’idée libertine s’exprime dans la littérature et comment elle s’exprime dans la peinture.
J’adore la peinture, qui est pour moi essentielle. J’ai suivi un séminaire sur l’invention de la critique d’art par Diderot, les fameux salons. C’était toujours cette histoire du regard : qu’est-ce qu’on regarde, qu’est-ce que l’on voit, que l’on ne voit pas ? Les salons officiels, les salons des refusés.
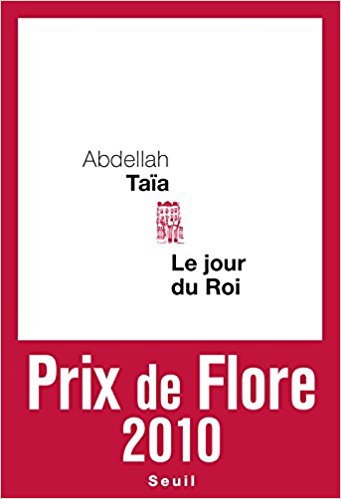
D. T. — Dans votre carrière d’écrivain vous avez publié plusieurs romans, notamment aux éditions du Seuil et vous recevez en 2010 le Prix de Flore pour Le Jour du Roi. Vous avez déjà une carrière assez riche.
Je ne sais pas si c’est une carrière ! (Rires) Mais c’est déjà pas mal de livres.
R. F. — Votre dernier roman Celui qui est digne d’être aimé est fortement influencé par Les lettres portugaises. Il s’agit d’un roman épistolaire, constitué de 5 lettres : une nonne tombe amoureuse d’un chevalier français qui l’abandonne.
Absolument, un chef-d’œuvre absolu de la littérature française amoureuse. Pour essayer de le séduire à nouveau, le manipuler, et essayer de retrouver son amour, qu’il revienne. Je ne sais pas si vous connaissez le livre, c’est un grand classique de la littérature française, mais visiblement méconnu. Alors qu’il est extraordinaire. Je vous ordonne de sortir d’ici et d’aller le lire ! C’est un livre qui fait 50 pages ! (Rires) Et c’est extraordinaire, vous allez être éblouis je vous l’assure. Il parle de l’amour… et comment, quand on est abandonné par quelqu’un qu’on aime, on essaie de le récupérer, de le séduire. C’est aussi très mystique.

Longtemps, on ne savait pas qui était l’auteur. Je crois qu’on l’a découvert il a 40 ou 50 ans. Il s’appelle (Gabriel de) Guilleragues. Mais le livre est rentré dans l’histoire comme un livre anonyme du 17e siècle.
R. F. — Celui qui est digne d’être aimé est très influencé par ces lettres. Ahmed écrit à sa mère, dans une lettre de colère où il lui exprime toute sa rancœur et lui parle de son homosexualité.
Il essaie de revenir sur cette histoire d’homosexualité en liant sa construction identitaire (pas l’homosexualité, sa construction identitaire), à l’influence de cette mère. Il ne lui dit pas « Je suis devenu homosexuel à cause de toi », mais juste comment dans son caractère à lui, il se rend compte qu’il a pris beaucoup de cette mère. Et la dureté de cette mère, plus exactement. Le côté impitoyable.
R. F. — Il y a trois autres lettres, une qu’il écrit à Emmanuel, un amant qui l’a beaucoup influencé puisque c’est lui qui lui a appris le français, et qui lui a fait découvrir les Lettres portugaises. Et deux autres lettres, qu’il reçoit, d’un amant passager, Vincent, et d’un ami d’enfance, Lahbib.
Il y a quatre lettres dans le roman. Pourquoi ce chiffre ? Pourquoi pas cinq ? Était-ce par modestie, pour ne pas rivaliser avec les Lettres portugaises ?
On ne peut pas rivaliser avec un classique ! (Rire) Ce n’est pas n’importe quel classique en plus. Au tout départ, je voulais qu’il y ait seulement deux lettres. Même pas quatre. Je voulais qu’il y ait la première lettre, adressée à la mère, mais après sa mort. C’est une lettre adressée à quelqu’un qui n’est plus là. À partir du moment où cette personne n’est plus là, le rapport à la vérité se modifie. On est plus courageux, on est moins dans la possibilité d’atténuer les mots et les sentiments.
Elle est morte, donc il voit ce qu’est la vérité. Ce qu’est sa vérité à lui, parce que justement elle est morte. La mort ici sert de révélateur, non seulement du lien qu’il avait avec sa mère, mais aussi sur lui-même. Il n’a plus personne dans la vie, il est seul, homosexuel : et tout d’un coup cette condition de vie et de vérité absolue lui est révélée encore une fois à l’âge de quarante ans. C’est quelque chose qui lui parait impossible à accepter. Ça le met dans une rage, dans une colère presque existentielle quand il se rend compte de sa condition en tant qu’être humain et comment il traverse la vie sur cette Terre et ce qui l’attend.
Au lieu d’essayer de mentir sur ce qu’a été sa mère. Souvent on a tendance, quand une personne meurt, à réécrire l’histoire de ces gens qui nous sont proches, en ne racontant pas des bobards, mais en les idéalisant parfois un peu. C’est comme si on n’avait rien appris de leur passage. Donc lui veut rester dans la colère.
La colère par rapport à sa condition d’homosexuel, même ici en France, et colère parce que cette mère n’est plus là : et c’est une chose inacceptable. D’ailleurs il lui dit : « Tu es partie et tu n’as pas le droit de partir, je ne te le pardonnerais jamais. » Pour lui une mère ne devrait pas mourir, c’est aussi simple que ça.
R. F. — Et en même temps le portrait de cette femme est très dur.
Elle est très dure mais en même temps, il lui parle sur un ton… il n’est plus question d’être dans la bienséance, de parler gentiment, de montrer qu’on est bien élevé, que l’autre ait une bonne image de vous : on n’en est plus là. On est dans un cadre qui dépasse les conventions sociales ou relève juste de l’ordre de la vérité de la vérité. Il est en colère, il lui parle en colère, il lui dit ses défauts à elle, mais en même temps ils ne sont pas que des défauts. Pour elle c’était une façon de survivre dans le milieu où ils vivaient, au Maroc, dans une famille très pauvre de neuf enfants, avec le mari qui ne veut pas se charger de tout ça. Donc c’était à elle de manipuler les gens, de manipuler le monde pour survivre et faire survivre toute cette famille. Or on ne survit pas seulement quand on a de bonnes intentions. La vie étant ce qu’elle est, quel que soit le bled où on vit. On est amené à réfléchir et ne pas être honnête tout le temps. C’est une histoire de survie.
Il ne va pas lui faire un procès moral, ce n’est pas ça. Comme lorsqu’un pauvre n’a rien a mangé et vole une brioche : on va luire dire « Quoi ? On ne t’a pas bien élevé. Toi le pauvre, tu voles. Regardez les pauvres ! Ils sont mal-éduqués. » On n’est pas du tout là-dedans.
Et puis la mort est quelque chose qu’on ne dénie pas.
La colère était le moyen le plus juste à la fois de faire l’autocritique de lui-même et de confronter cette mère. De toute façon elle n’a pas le choix : une femme, de manière générale, dans la société, dans la construction sociale, n’a pas d’autre choix que d’y aller. Il y a tellement de chose qui pèsent sur la femme, ce qu’elle doit faire ce qu’elle ne doit pas faire, comment elle doit se comporter, et en même temps on lui fait porter l’essentiel de la vie quotidienne par exemple ! Ce n’est pas l’homme qui se charge de ça. Mais en même temps, il faut qu’elle soit femme. Comment elle va s’en sortir ? Il ne s’agissait pas de la présenter comme une femme bien, féministe, tout ça. Je ne suis pas contre les féministes. Mais je peux pas faire une femme marocaine, pauvre, et la traiter selon des modèles qui ont cours ici, en occident. Et pourtant, même ici…
D. T. — Il y a beaucoup de similarité entre votre vie et vos œuvres, notamment dans ce dernier roman. Amhed a sept sœurs, un frère, vous venez d’une famille nombreuse aussi. Quelle part votre vie a-t-elle dans la fiction ?
La réponse à cette question est très simple ! (Rires) Je mets tout ce que je suis dans la littérature ! Pour moi, l’écriture est une sorte de don de soi, une générosité. Il faut donner quelque chose aux autres. Il y en a qui sont capables d’inventer des choses qui sont loin d’eux et d’arriver à développer tout ça, moi j’en serais incapable. Je n’ai pas ce talent-là. Le talent que j’ai pour l’instant dans l’écriture, c’est de trouver des choses qui me paraissent intenses, intéressantes, que je transforme. Mais la plupart du temps, c’est tiré d’une expérience de vie, qu’elle soit directe ou indirecte. De toute façon, même si c’est de la fiction, un écrivain a forcément une vision de la vie qu’il met dans ses livres. Même quand il parle de trois personnes. Cette vision de la vie, du monde, de la terre, du ciel, de l’amour et tout ça, n’est pas complètement étrangère à lui. C’est sa propre vision.
D’ailleurs on nous disait toujours quand on était à l’école, « Soyez-personnel ». Affirmez-vous, mais dans les dissertations, les commentaires composés… c’est inintéressant, c’est général. Il faut être personnel, parlez de votre vie ! (Rires)
le 23 juin 2017,
La Terrasse | Musée du Vieux Toulouse
Fin de la première partie
Lire la seconde partie de la rencontre avec : Abdellah Taïa — 2de partie (prochainement)
Celui qui est digne d’être aimé :
Ahmed, 40 ans, est marocain. Il vit à Paris. Il écrit à sa mère, morte cinq ans auparavant, pour régler ses comptes avec elle et lui raconter enfin sa vie d’homosexuel. Il envoie une lettre de rupture à Emmanuel, l’homme qu’il a aimé passionnément et qui a changé son existence, pour le meilleur et pour le pire, en le ramenant en France. Par ailleurs, Ahmed reçoit des lettres de Vincent et de Lahbib.
Un roman épistolaire pour remonter le temps jusqu’aux origines du mal. Un livre sur le colonialisme français qui perdure dans la vie amoureuse d’un jeune Marocain homosexuel.

Abdellah Taïa
Celui qui est digne d’être aimé ~ Seuil
ISBN : 9782021343076
144 pages
Prix public 15 €

