La France, de profile
Jean-Baptiste Del Amo (Règne animal, Gallimard), Cécile Coulon (Trois saisons dʼorage, Viviane Hamy) et Simon Johannin (Lʼété des charognes, Allia) approfondissent leurs visions de la France rurale, dans une rencontre organisée par le Marathon des mots et animée par Kerenn Elkaïm. (retrouvez la première partie ici)
Sur plusieurs générations, l’exploitation de la nature par l’activité humaine prend des formes de catastrophe naturelle entre les tragédies des hommes. Mais avant la suite de l’entretien, je vous propose un rapide résumé des œuvres.
Rencontre avec Cécile Coulon / Jean-Baptiste Del Amo/ Simon Johannin — 2de partie
Sommaire
1. Un portrait de la France rurale
2. L’exploitation de la nature
3. Les animaux dans les récits
4. Le désir et la violence
5. La famille
Résumé des œuvres
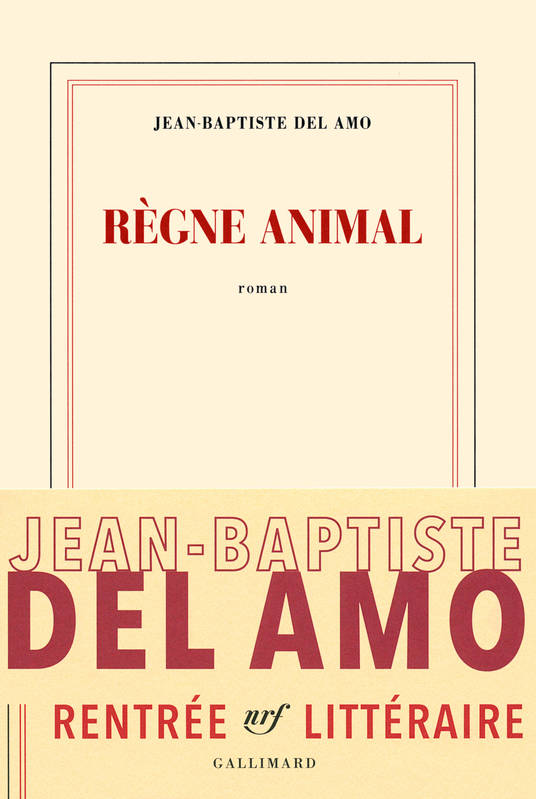 Règne animal :
Règne animal :
Règne animal retrace, du début à la fin du vingtième siècle, l’histoire d’une exploitation familiale vouée à devenir un élevage porcin. Dans cet environnement dominé par l’omniprésence des animaux, cinq générations traversent le cataclysme d’une guerre, les désastres économiques et le surgissement de la violence industrielle, reflet d’une violence ancestrale. Seuls territoires d’enchantement, l’enfance – celle d’Éléonore, la matriarche, celle de Jérôme, le dernier de la lignée – et l’incorruptible liberté des bêtes parviendront-elles à former un rempart contre la folie des hommes?
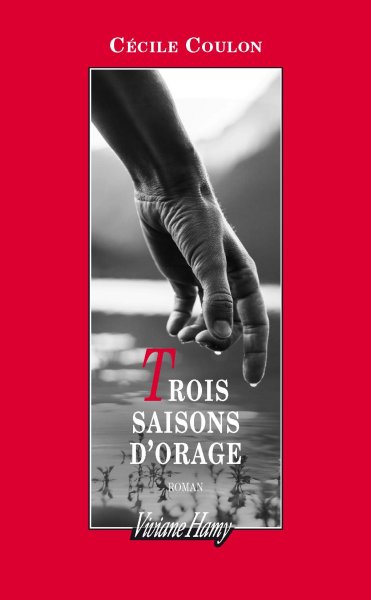
Trois saisons d’orage :
Les Fontaines. Une pierre cassée au milieu d’un pays qui s’en fiche. Un morceau du monde qui dérive, porté par les vents et les orages. Une île au milieu d’une terre abrupte. L’histoire d’André, de son fils Benedict, de sa petite-fille, Bérangère. Une famille de médecins. Celle de Maxime, de son fils Valère, et de ses vaches. Une famille de paysans. Et au milieu, une maison. Ou ce qu’il en reste. Les Trois-Gueules sont un espace où le temps est distordu, un lieu qui se resserre à mesure que le monde, autour, s’étend. Si elles happent, régulièrement, un enfant au bord de leurs pics, noient un vieillard dans leurs torrents, écrasent quelques ouvriers sous les chutes de leurs pierres, les villageois n’y peuvent rien ; mais ils l’acceptent, car le reste du temps, elles sont l’antichambre du paradis.
 L’Été des charognes :
L’Été des charognes :
Les bêtes sont partout, les enfants conduisent leurs parents ivres morts dans des voitures déglinguées et l’amitié reste la grande affaire. C’est un pays d’ogres et d’animaux errants, un monde organique fait de pluie et de graisse, de terre et d’os, où se répandent les fluides des corps vivants et ceux des bestioles mortes. Même le ramassage scolaire ressemble au passage des équarrisseurs. Ici, on vit retiré, un peu hors-la-loi, pas loin de la misère aussi.
C’est La Fourrière, un « village de nulle part », et c’est un enfant qui raconte : massacrer le chien de « la grosse conne de voisine », tuer le cochon avec les hommes du village, s’amuser au « jeu de l’arabe », rendre les coups et éviter ceux des parents. Mais bientôt certains disparaissent, les filles vous quittent et la forêt finit par s’éloigner. D’une bagarre l’autre, la petite musique de ce premier roman vous emmène jusqu’à l’adolescence, quand la douleur fait son entrée et que le regard change, dans les turbulences d’une langue outrancière au plus près du rythme de l’enfance : drôle et âpre, déchirante et fièvreuse, traversée de fulgurances.*
Entretien
Kerenn Elkaïm — Jean-Baptiste Del Amo, on a parfois l’impression que la France a deux visages : celui des villes et celui des villages. Est-ce que ce roman se veut, quelque part, un portrait d’une certaine France rurale que l’on n’a peut être pas tendance à montrer ou à raviver ?
Jean-Baptiste Del Amo — Ce qui est certain, c’est qu’il y a dans la littérature française une grande majorité de romans qui se passent en milieux citadins et en particulier à Paris. Je ne peux que me réjouir de voir une génération de jeunes auteurs qui réinvestissent ces territoires-là et qui les utilisent comme matière pour la littérature.
J’ai fait un portrait d’une France rurale, mais parmi des milliers d’autres existants. À aucun moment je n’ai cherché à dessiner un profil type sociologique. Mes personnages sont tous des cas particuliers et cette famille l’est aussi, et assez singulièrement en plus, puisqu’ils se sont carrément coupés du reste de monde. Ils vivent en pratiquement autarcie.
Je n’avais pas de désir d’opposer une sociologie de la ruralité à une sociologie de l’espace urbain.
K. E. — Quel est le pouvoir de la fiction pour raconter ces lieux-là par rapport à un travail de sociologue ou d’historien ?
J.-B. D. A. — Cette question peut s’appliquer à tous le roman. En tout cas, ce qui me semble être présent dans mon travail d’auteur : c’est la sensation. Laisser le travail historique, qui va être basé sur les faits, et être en partie dépourvu de sens. La sensation c’est ce qui nous engage dans une expérience physique de la lecture. C’est ce qui nous attrape par le col et nous tire vers l’émotion. C’est l’outil du romancier, ce qui le différencie de l’historien ou de l’essayiste, avec la liberté bien sûr. Ne pas être prisonnier d’une réalité. Ce qui nous importe à la limite, ça peut être, ou non, un souci de réalisme, mais de vérité ou de réalité, moi en tout cas je ne m’en embarrasse que très peu.
K. E. — Simon Johannin, votre roman est aussi une photographie d’une certaine France, où les gens vivent dans un petit village construit autour d’une ou deux usines qui sont pour la plupart fermées. Pourquoi aviez-vous envie de nous montrer cette photographie-là ?
Simon Johannin — C’est mon premier roman, donc j’ai eu le réflexe assez naturel de parler de ce que je connaissais le mieux et des espaces dans lesquels j’avais passé le plus de temps. Mais aussi parce qu’il me paraissait intéressant d’en parler. Après, dans le process du livre, une fois qu’on a quitté le hameau et les deux trois petites maisons dans lesquelles les enfants grandissent, il y a cette campagne qui n’en est plus vraiment une, qui est une campagne industrielle : dans laquelle ils rentrent pour ensuite atterrir dans la ville. Pour moi c’était une manière de jouer sur de nouvelles odeurs. Jean-Baptiste parlait de sensation : l’appel au sens d’une manière générale, que ce soit visuel ou auditif, ou olfactif, c’est quelque chose qui me tenait à cœur quand j’écrivais.
Le fait de placer les personnages dans des territoires qui puent, qui sont industriels, qui sont plus toxiques, ce ne sont plus seulement des odeurs fortes qu’on peut trouver dans un espace de ferme ou au contact d’une charogne — ce n’est pas pour rien que le livre s’appelle L’été des charognes, il en est rempli.
Un des jeux des enfants, dans le roman, est de fermer les yeux et de reconnaître les usines devant lesquelles ils passent à leurs odeurs. Aussi parce que ce sont des odeurs qui m’ont marqué. J’ai des souvenirs de vallées entières qui puent à cause d’une ou deux usines et qui, en même temps, font vivre les gens. Mais il y a quelque chose d’un peu étrange qui s’installe dans un village qui pue à cause d’une activité industrielle. Tout le monde est imprégné de l’odeur, c’est le moment où l’activité prend le dessus. À partir du moment où on a l’odeur de son activité, on passe un cap.
Je trouvais ça intéressant, pour ensuite finir dans un espace urbain avec des odeurs qui sont spécifiques à un autre territoire. C’est une espèce de voyage olfactif qui n’est pas très agréable, mais qui est intéressant.
K. E. — Cécile Coulon, dans le village que vous décrivez il y a aussi plusieurs mondes qui se côtoient, mais qui ne se rencontrent pas vraiment. Que vouliez-vous montrer à travers ces différentes classes sociales et à travers ce double mouvement ?
Cécile Coulon — Comme le disait Jean-Baptiste, il n’y a pas une ville qui représente toutes les villes et un village qui représente tous les villages : ce sont des cas particuliers. On ne peut pas dire « la campagne versus la ville » ou : toutes les villes sont mauvaises et insupportables et tous les villages sont mignons avec des jolis clochers et des restaurants sympathiques, c’est pas ça l’idée. Il faut essayer de jouer sur les détails, d’écrire avec une caméra dans la main et pouvoir changer de perspective quand on veut.
Lorsqu’on parle d’un village où il y a au départ 350 habitants et qu’il y en a 3 000 15 ans après, c’est extrêmement compliqué, voire un peu invraisemblable, de ne pas parler de certaines figures qui sont tellement importantes, encore aujourd’hui. Ce sont des figures qu’on appelle « clichés » aujourd’hui, mais le cliché vient forcément d’une vérité : le médecin de campagne, l’instituteur, le notaire, le curé, sont encore importants aujourd’hui, quoi qu’on en dise.
Et très souvent ces figures-là (est-ce une figure de statut social ou tout simplement ce que les villageoins transferent et fantasment sur eux ?) apportent du réconfort. Ne serait-ce que par leur présence. C’est quelque chose d’extrêmement intime, d’intérieur. Quand il y a un médecin de campagne dans un village, même les gens qui ne vont pas le voir se sentent mieux, car cela veut dire qu’on peut être soigné. Ça veut dire que si quelqu’un tombe malade ou si quelque chose de grave arrive, il y a quelqu’un sur place qui a les gestes, qui savoir faire.
Quand j’étais petite, dans beaucoup de villages par exemple, lorsque le vétérinaire venait soigner les animaux, il voyait aussi les gamins. Parce que les parents disaient : « De toute façon, autrement on ne peut pas. Vous êtes là, est-ce que vous pouvez vérifier si tout va bien ? » Ça arrivait, c’est tout à fait normal, ce n’était pas dingue. Mais parce qu’il n’y avait pas de médecin à moins de 25 ou 30 kilomètres à la ronde. Par contre y avait un vétérinaire. Ce n’est pas une question de statut social mais d’apport, envers les villageois. Ce qu’ils incarnent.
Par exemple, l’homme d’Église incarne celui à qui on peut tout dire, même si aujourd’hui ce sont plutôt les médecins vers qui l’on se tourne. L’ultime refuge, c’est l’Église : l’endroit où on ne peut pas frapper, où on ne peut pas être violent, l’endroit où on peut se réfugier et où on est accueilli quoi qu’il arrive, c’est l’église. Et l’instituteur c’est celui qui apporte le savoir et celui qui prend soin des enfants, tout simplement.
Il fallait qu’il y ait ce premier puzzle humain pour construire ce livre. Je ne pouvais pas faire l’économie de ces personnages-là.
K. E. — Jean-Baptise Del Amo, vos personnages dans la première partie sont confrontés au règne des saisons. Ils vont tenter de s’approprier cette nature notamment par l’industrialisation. Qu’est-ce qui vous intéressait dans cette évolution-là ?
J.-B. D. A. — Je souhaitais utiliser l’élevage traditionnel et intensif comme une métaphore de cette famille et de la façon dont elle va devenir peu à peu dysfonctionnelle à travers les générations. Finalement, l’élevage dans ce texte est une toile de fond, c’est un miroir tendu à ces personnages-là. Bien évidemment, au-delà de l’élevage, il y a les animaux de l’élevage, ce qu’en font les hommes et ce que nous dit leur relation avec les animaux : ce que cela nous dit de leur humanité et de leur sauvagerie.
Je n’ai jamais eu le désir de faire véritablement un texte sur l’élevage, mais c’est un des thèmes du roman qui a plus vocation à dévoiler les personnages humains qui peuplent ce récit.
K. E. — Simon Johannin, vos parents ont fait ce choix de devenir apiculteurs, quelles visions est-ce qu’ils vous ont donné, dès lors, de la nature et de ses ressources et est-ce qu’à travers ce livre vous voulez montrer qu’elles ne sont pas inépuisables ?
S. J. — Ils ne m’ont pas vraiment donné d’images, c’est l’univers dans lequel j’ai grandi. Les choses se passaient de manières naturelles, d’autant plus que je n’ai pas eu des parents qui ont eu la prétention de dire « ça c’est la vérité et ça c’est faux. » Ils ont plutôt tenté de faire en sorte que je puisse faire mes expériences et en tirer mes propres conclusions. Je n’ai pas eu de réflexions portées là-dessus ou de pensées théorisées. Dans le livre, je parle plus d’une initiation, d’un enfant qui va quitter son milieu naturel qui est un peu en vase clos, et sur lequel l’extérieur porte un jugement violent.
Comme pas mal de personnes qui ont grandi en milieu rural et qui vivent de l’exploitation de la nature de manière consciente, voire militante, il y a une délicatesse à avoir et qui se travaille dans le temps. Ne serait-ce que pour parler d’apiculture, effectivement.
À partir du moment où les abeilles ont commencé à mourir toutes seules sans qu’on comprenne pourquoi, des questions se sont posées. C’est le moment où l’activité humaine fait office de catastrophe naturelle.
Il y a un dérèglement face auquel on ne peut pas plus faire que face à une catastrophe naturelle : on est dans ces échelles-là.
K. E. — Ce que vous dites fait échos à votre roman, mais aussi à celui de Cécile Coulon, puisqu’il y a ces falaises sauvages qui vont devenir une source d’exploitation extraordinaire. Là aussi vous montrez cette force de la nature qui n’est pas inépuisable.
C. C. — C’est différent d’une exploitation animalière. Pour ceux qui exploitent la pierre, ils sont persuadés que la pierre ne vit pas, en tout cas, elle est moins humanisée qu’un animal. Ce qui n’est pas forcément vrai je crois, il faut faire attention à ce qu’il se passe parfois autour de soi. Le regard sur l’entreprise des frères Charrier, qui viennent ouvrir une carrière de pierre, n’était pas un regard méchant ou méprisant : ce n’est pas de dire « ce n’est pas bien. » Quand ils arrivent et qu’ils ouvrent cet endroit, ils repeuplent un village, ils le nourrissent et leur carrière de pierre devient connue dans toute la France. Voire à l’extérieur. Pour moi la vraie question qui se posait était : À quel moment une petite entreprise familiale, très paternaliste, prend tellement d’ampleur et d’importance qu’elle écrase le domaine sur lequel elle est installée ? Parce que s’ils continuent de cette façon-là, dans dix ans, il n’y a plus de montagne — en tout cas elle sera extrêmement abîmée ou modifiée, s’ils peuvent la modifier. Ou bien, au contraire, vont-ils avoir l’intelligence de ralentir ?
L’autre question face à ça, quand on a un projet — c’est un mot très à la mode « projet » —, quand on a une entreprise qui se met en place et qui prend de l’importance, qui est tellement reconnue, il y a une espèce d’orgueil à se dire : « J’ai fait quelque chose qui marche tellement bien, pourquoi est-ce que je ne continuerais pas à le faire ? » C’est tout simple, c’est très humain. Maintenant, là, c’est en train de marcher, ça fonctionne, tout le monde veut ma pierre, on la demande à l’extérieur : pourquoi j’arrêterais de la proposer à des gens et pourquoi je ne la proposerais pas à plus de gens ?
Alors évidemment, dit comme ça, ça peut paraître un peu bas de plafond, mais en même temps, toute personne qui a envie de créer quelque chose est confrontée à cette question-là à un moment donné.
K. E. — Jean-Baptiste Del Amo, votre arrière-grand-père était éleveur de porcs. Pourquoi avez-vous eu envie de mettre en avant cette maltraitance des animaux ? Il y a un terme intéressant et révélateur que vous apposez dessus dans le récit : c’est celui de boucherie. Et en même temps il peut s’appliquer à la guerre que vous décrivez.
J.-B. D. A. — Je ne l’ai su que bien plus tard que mon arrière-grand-père avait été éleveur de cochon, bien après avoir terminé l’écriture de Règne Animal. En discutant avec ma grand-mère au sujet de mon grand-père, qui avait entretenu des relations très difficiles avec son propre père (il n’en parlait quasiment jamais sinon pour dire que c’était un salaud), je lui ai demandé : « Au fait il faisait quoi dans la vie ? » Et il était éleveur de porcs. Et là je me suis quand même dit que j’étais sans doute habité par quelques réminiscences intergénérationnelles.
Pourquoi les cochons ? C’est difficile de répondre à cette question, elle nécessiterait que je m’allonge devant vous sur un divan et que je vous en parle longtemps. C’est un animal qui m’a toujours fasciné parce qu’il fait partie des animaux mal-aimés : de ceux qui provoquent le dégoût, le rejet. C’est le cas des serpents, des araignées, etc. Dans la bassecour, le cochon, c’est celui qu’on enferme dans les ténèbres d’une soue, qui effraie les enfants, qui a une odeur forte parce qu’il vit dans ses déjections. Mais le cochon est un animal extrêmement propre, si ses propriétaires ne le laissent pas mariner dans ses excréments, ce qui est souvent le cas dans les élevages intensifs.
Gamin j’ai toujours eu une empathie particulière pour ces animaux de l’ombre. Sans doute parce que je sentais avec eux une forme de parenté. En tout cas ils m’ont toujours touché. Et le cochon (comme le serpent d’ailleurs, on croise quelques couleuvres dans Règne Animal) a continué de m’accompagner dans ma vie. J’ai appris à le découvrir et j’ai réalisé à quel point c’était un animal proche de nous.
Aujourd’hui, on sait avec l’avancée de la science et de l’éthologie qu’on partage 95 % de notre ADN avec le cochon.
C’est un animal qui, en termes d’intelligence et de cognition, rivalise avec certaines espèces de primates, dont les chimpanzés et les bonobos. Aujourd’hui il nous semblerait tout à fait intolérable de concevoir des élevages intensifs de chimpanzés, de bonobos ou de dauphins.
Parce qu’on a admis le fait que ce sont des animaux dotés de sensibilités mais aussi d’intelligence, qu’ils constituent des groupes sociaux, et que ce serait un meurtre à grande échelle ces élevages-là. En revanche ce n’est pas le cas pour les cochons que nous élevons impunément et que nous abattons par millions chaque année. Et cette proximité avec le cochon, on a essayé de l’enfuir avec des tonnes de mensonges, d’histoire, pour justement le tenir à distance de nous.
Le cochon est en réalité un cousin, sinon un frère, de l’espèce humaine, comme le singe. Bien sûr, la manière dont on a asservi cet animal — l’élevage porcin est un des élevages les plus violents — nous dit quelque chose de notre propre humanité, de la façon dont nous ne cessons d’essayer de nous asservir, nous aussi, les uns les autres.
Eh oui, il y a un lien entre l’élevage intensif et un portrait de notre humanité. Comme il y a un lien entre la mise en scène de la Première Guerre mondiale, qui a été dans l’histoire de l’humanité l’une des premières étapes d’industrialisation de la violence à grande échelle et, des dizaines d’années plus tard, le système d’élevage intensif qui est aussi, bien évidemment, un système d’asservissement et de violences systématisé.
K. E. — Les animaux traversent aussi L’Été des charognes de Simon Johannin. Qu’est-ce qu’ils symbolisent pour vous et en quoi nous renvoient-ils à une part d’animalité que vous montrez dans ce texte ? Notre part animale, notre part sauvage.
S. J. — Je n’ai pas de spécialement mis de mot dessus. La symbolique des animaux est tellement développée et tellement riche qu’il n’y avait pas besoin de chercher très loin.
Vous parlez d’animalité : ce qui m’intéressait par rapport au personnage d’enfant, c’était ce rapport animal avec l’animal. Le livre s’ouvre sur une lapidation de chien, c’est une vengeance : qui est souvent décrite comme un meurtre gratuit. Mais ce sont des enfants qui vont tuer un animal qui leur a fait du mal, un être qui leur a fait du mal : ils le voient comme ça. Non pas comme un être inférieur, mais un danger qu’il faut éliminer : et je ne vous raconterai pas la fin du livre, mais elle se situe à l’exact opposé du début dans le texte ! (Rires)
Je voulais vraiment cette espèce de magie qu’entretiennent les enfants avec des animaux, dans le rapport qu’ils ont avec eux et dans le regard qu’ils portent sur eux. Je suis toujours fasciné de voir un bambin qui joue avec un chat ou avec un chien : surtout avec les chiens, le livre en est rempli. Avoir des rapports d’affections avec un animal qui nous dépasse en taille, qui nous dépasse en masse musculaire et qui représente un danger, et pourtant avec lequel on peut installer une relation de confiance, de complicité et de fidélité, c’est quelque chose qui me fascine.
Tout en long du livre il y a des morts d’animaux : soit par accidents, soit parce qu’ils ont été abattus pour diverses raisons. C’est donc comment ces animaux morts vont réhabiter le personnage principal et comment leur mort ne sera pas sans conséquence sur son cheminement psychologique, sans même qu’il s’en rende compte ou qu’il puisse mettre des mots dessus. Et au moment où il en est le plus loin, sous forme de spectre on peut le dire, l’animal va revenir. Pour moi il y avait cette idée de seuil. Au final, des seules choses qu’on sait des animaux, des rapports qu’on entretient avec eux, c’est qu’ils ont des yeux et qu’on a des yeux, on peut se regarder on peut se voir, on peut avoir conscience ensemble de partager un espace et d’êtres vivants dans cet espace, mais on ne peut pas aller plus loin dans la relation.
On ne peut pas savoir savoir ce qu’il y a dans la tête d’un animal, on ne peut pas partager un langage avec lui, mais on peut avoir conscience de nos présences mutuelles.
C’est aussi un livre qui en filigrane dit : « On est là aussi les gars… On existe. » C’est un simple rappel de ça…
K. E. — Cécile Coulon, il y a une autre nature qui est présente dans votre livre, c’est la nature humaine : qu’est-ce qui vous fascine en elle ?
C. C. — Je vais prendre toute la nuit pour répondre à cette question ! (Rires) Beaucoup de choses. Sans doute beaucoup trop de choses. La grande question pour ce livre-là, c’était la question du surgissement du désir. Puisque le désir, on sait qu’on le porte tous en nous, qu’il est parfois endormi, en veille, en charge, en stand-by. Disons ça comme on veut. Mais ce qui m’intéressait, c’était « qu’est-ce qui se passe quand il surgit… à un moment où on ne s’y attend pas ? » Évidemment. Sinon ce n’est pas drôle ! Comment fait-on en tant qu’être humain avec tout ce qu’on nous a appris, tout ce qu’on nous a inculqué, toutes les images, les fantasmes, tous les interdits qui ont été enfoncés en nous ? Comment fait-on quand ça arrive ? Et surtout quand ça arrive dans un endroit pareil, où il n’y a aucune possibilité de se cacher.
De manière assez contradictoire, on a des hectares et des hectares de terrains et de nature, mais comme il y a tellement peu de monde, tout se sait, se voit et se devine. Alors qu’en ville, il y a beaucoup de gens restreints dans un périmètre limité : on peut se cacher. Là non. Le gros point d’interrogation au-dessus de mon écriture au moment où j’étais en train de terminer le livre c’était de me dire : « Est-ce qu’on peut déjà parler du surgissement du désir autrement qu’en manière personnelle ? » Puisque c’est différent chez chaque individu. Est-ce que l’écriture n’échoue pas à essayer de décrire un moment qui est tellement physique, tellement intime et qui fait tellement mal aussi… si brutal parce qu’il est inattendu, parce qu’il est profond et parce qu’il fait exploser tout ce qu’on a pu apprendre en fait.
Ce qui m’intéressait le plus en écrivant le livre, c’était de trouver comment montrer que toutes les barrières qui ont été érigées pendant notre enfance, notre adolescence, peuvent être détruites en quelques secondes.
K. E. — C’est aussi le cas dans votre livre Jean-Baptiste. Il y a ce désir qui est extrêmement présent et qui traverse toutes les générations. On a parlé de la violence qui se perpétue : est-elle dans les gênes, dans l’éducation ? Pourquoi vouliez-vous aborder ces deux pôles-là ?
J.-B. D. A. — Sans doute parce qu’il me semble impossible de parler de l’humanité — qui est quand même notre base de travail à tous, j’imagine — sans parler du désir. Si j’avais dû répondre à la question que vous venez de poser à Cécile sur l’humanité : j’aurais répondu que ce qui me touche le plus c’est cette espère de disproportion, de gouffre, qui existe entre notre insignifiance — de savoir qu’à l’échelle de l’univers, ce n’est rien —, et notre aspiration. C’est notre désir de systématiquement essayer de transcender notre condition.
C’est bien sûr une aspiration à la liberté et à l’intensité. C’est aussi ce qui se retrouve dans un désir bien plus commun, le désir charnel et sexuel. En ayant le souhait de parler de ses êtres humains comme je le fais des animaux dans toute leur simplicité, leur évidence d’organisme vivant, je me devais de parler aussi de ce désir-là.
K. E. — Simon Johannin, il y a une violence, une colère et une agressivité qui animent les pages de votre livre. Qu’est-ce qui vous intéressait dans cette jeunesse sans repères et qui va se noyer dans tous ses travers, tout en ayant aussi l’éveil du désir qui est très présent ?
S. J. — C’est très lié pour moi. L’agressivité et le désir d’agressivité viennent souvent de la frustration, tout simplement. De l’impossibilité d’exprimer certains désirs qui sont en nous. C’est déjà un sujet en soit. Il y avait ensuite le plaisir du travail de la langue — puisque je parle d’une enfance puis d’une adolescence —, afin de trouver les mots justes sur les désirs adolescents, les agressivités adolescentes. Quels sont ces âges ? On a entre 12 et 16 ans et on ne va s’exprimer de cette manière-là que pendant ces années-là. Donc ce sera dans l’usage excessif de la vulgarité : je parle surtout pour moi, je ne tiens pas à faire de généralité. Qu’est-ce que ça dit de l’envie de vivre ? D’être ordurier avec tout son environnement et d’être agressif. Pour moi, l’agressivité des personnages tient plus du fait de vouloir voir vivre l’environnement. Comme mettre des secousses, des coups de taser on pourrait dire.
Il y a plein de mots qui sont très durs, très grossiers, que je trouve très beaux. Ils disent des belles choses, des grandes choses, ou bien expriment des vérités. C’est souvent un moyen quand on n’a pas le vocabulaire adéquat pour dire ce qu’on a à dire : ce sont des raccourcis qui sont souvent efficaces.
Ça me paraissait logique, d’autant plus dans la bouche de cet enfant qui, petit à petit, va quitter cette langue-là pour en trouver une autre, mais qui ne va pas nécessairement mieux lui aller.
K. E. — Jean-Baptiste, la famille est au cœur de votre livre. Plusieurs générations se succèdent dans Règne Animal. La famille devrait être un refuge, devient-elle une faille, ici ?
J.-B. D. A. — Oui, la famille peut sans doute être un refuge, mais je pense qu’elle ne l’est pas de manière systématique, bien loin de là. Généralement en s’intéressant à toutes les histoires de famille on s’aperçoit qu’elles sont aussi construites sur des non-dits, des blessures. C’est cette matière-là qui m’intéresse.
Savoir questionner cette transmission de génération en génération, qui fait qu’on se retrouve prisonnier de schémas affectifs et comportementaux, et savoir si à un moment donné on peut réussir à se libérer de ce fardeau. Est-ce qu’on peut véritablement en prendre conscience et s’en affranchir ou est-ce qu’on est voué à trainer indéfiniment une culture familiale qu’on a connue dans l’enfance ? Ce qui est sûr c’est que la famille, quel que soit sa composition, on en a tous eu au moins une à un moment donné : c’est un thème universel dans lequel on peut tous se transposer. C’est un pont immédiat avec le lecteur, quelle que soit la famille qu’on met en scène.
K. E. — Cécile Coulon, dans Trois saisons d’orage, qu’est-ce qui vous intéressait dans cette confrontation entre l’évolution d’une famille, de plusieurs époques, et l’évolution des sentiments ?
C. C. — Le concept de famille est très étrange pour moi. C’est très peu naturel en fait. L’idée, c’est quand même de dire à des gens : « Vous devez aimer, vous êtes obligés d’aimer d’autres personnes parce qu’elles ont le même sang que vous. » Alors que si ça se trouve, ces gens, si on les croisait dans la vie, on se dirait « Nan mais c’est pas possible… » Mais là on vous dit : « Vous allez passer dix, vingt, trente, quarante, cinquante ans avec et il faudra faire des repas de famille, il faudra faire des réunions, il faudra faire des trucs » avec des gens que peut être, dans une autre configuration de votre vie, vous ne pourriez pas encadrer.
Je trouve ça très étonnant qu’on en face le refuge numéro un. Le refuge, c’est une chose. Mais qu’on en face le support premier de notre vie ?
Quand on rencontre des gens, tout de suite : « et tes parents qu’est-ce qu’ils font ? » « Est-ce que t’as des frères et des sœurs ? » Les premières questions qui viennent sont sur la famille, comme si on n’existait pas individuellement en dehors de ce cercle-là. Alors bien sûr, on a été éduqué, on a été aidé, on a des parents : évidemment c’est présent.
Je trouve très anxiogène, quand on est adulte — même quand on a appris ce qu’on devait apprendre —, à quel point on est toujours !… toujours ramené à ça.
Comme si, même à des âges où on pourrait penser qu’on est libre de faire ce qu’on veut, on continue de vous demander : « Mais tes parents ils faisaient quoi ? » « Tes grands-parents ils faisaient quoi ? Ils habitaient où ? »
C’est quand même dingue, si on prend l’actualité, la politique par exemple, à quel point les gens se sont intéressés aux familles, aux descendances, aux trucs… Qu’est-ce qu’on s’en fou ? Est-ce qu’à un moment donné on ne peut pas essayer de connaitre quelqu’un sans forcément aller fouiller, mais fouiller vraiment profond, du côté du papa, de la maman, du frangin qu’a pas été gentil, de la petite sœur qui n’était pas présente, etc. Il y a des gens pour qui la famille n’est pas forcément très importante.
Et aujourd’hui je crois qu’il y a un grand tabou là-dessus.
Si quelqu’un ose dire : « Ben en fait, moi j’aime pas trop mon frangin » ou « Je ne m’entends pas très bien avec ma mère », c’est le cataclysme. Tout le monde va dire « Ah bon ? Ben faut soigner ça. » Ben non, mais c’est pas grave. Il m’arrive d’avoir un rhume, je laisse passer. Je le soigne pas forcément. Ce n’est pas grave.
Il y a une gravité qui s’est installée autour de ce thème. Et en même temps c’est une gravité qui nourrit la littérature, qui nourrit l’art, qui nourrit la psychanalyse, évidemment ! — Ben oui, parce que sinon il y aurait quand même vachement de mecs au chômage. (Rires) Vous imaginez demain si on commence à dire « C’est pas grave, la famille. » En littérature c’est un vivier incroyable et c’est fédérateur parce qu’on va tous, en tant que lecteur, se dire ça me rappelle ci, ça me rappelle ça… il y a un procédé d’identification qui est très fort, donc on n’en fait pas l’économie. Mais en réalité, ça prend une prégnance, une importance, un poids en littérature que je trouve un peu lourd à porter pour les gens de manière générale.
Ce qui m’intéressait dans le roman c’était justement de se dire qu’à un moment donné ce concept de famille, bien qu’il ait l’air très solide et très solidifié au fil des générations, à partir du moment où les sentiments intimes individuels, profonds et personnels, entrent en jeu, la famille devient assez secondaire. En tout cas elle devient plus une barrière qu’autre chose, qu’il faut réussir à dépasser et à mettre de côté. Peut-être que c’est comme ça aussi qu’on devient adulte, quand on arrive à dépasser sa propre famille.
K. E. — Pour rebondir sur les propos de Cécile, Simon Johannin, peut-on dire que votre roman pose aussi la question « de comment trouver sa place et devenir soit même » ?
S. J. — Oui, c’est un roman d’initiation donc effectivement il y a de ça. Pour rebondir sur ce que dit Cécile et pour aller un peu plus loin, ce qui me gêne c’est qu’on propose la famille comme étant la seule aventure collective à l’heure actuelle. Je ne trouve pas ça très bandant. Qu’on n’ait pas d’autres liens aussi forts que ceux des liens familiaux qui prennent le dessus. Mes personnages c’est via l’amitié et la camaraderie qu’ils vont dépasser ça : leur famille les aime bien et c’est comme ça que ça se passe, la question ne se pose pas vraiment. Mais c’est via le jeu, parfois cruel, et la camaraderie, qu’ils vont se singulariser, s’affirmer et grandir simplement.
Ça tient plus de l’amitié : ce sont des gens que l’on choisit en quelque sorte. On peut tester les liens amicaux en traversant certaines expériences avec eux et, à partir de ce moment, décréter qu’une amitié est indéboulonnable. La matière collective du livre via laquelle les personnages vont grandir et s’émanciper pour devenir pleinement eux-mêmes, c’est dans les relations d’amitié.
K. E. — Est-ce l’amitié et l’amour qui va donner une certaine lumière à cet univers très sombre ?
S. J. — Ce n’est pas tant l’amitié et l’amour que le désir d’amitié et d’amour du personnage, et sa quête de lumière. J’appelle ça une quête de lumière parce qu’il est assoiffé de ces choses-là, littéralement. Il ne cherche que ça. Il va passer son temps à essayer de trouver des phrases et des mots qui disent sa fureur et la grandeur et la beauté de certaines choses qu’il peut voir. Ce sont des prétextes pour qu’il puisse exprimer son intériorité. C’est au contact de certaines personnes qu’une alchimie se produit et que quelque chose jaillit de lui. Cette lumière, il est capable de la voir aussi parce que son environnement est sombre et il est capable de l’apprécier parce qu’il est là où il est et que c’est depuis cet endroit qu’il arrive à prendre conscience que certaines choses sont précieuses et qu’il faut en apprécier la beauté. Sans la violence subite ou sans la rudesse de l’enfance et de l’environnement, il n’aurait peut-être pas ce côté. Et pouvoir cerner ces choses-là, pleines de délicatesses, malgré son tempérament.
le 23 juin 2017
Espace Diversités Laïcité | Toulouse
*
Fin de la rencontre
Infos pratiques
Cécile Coulon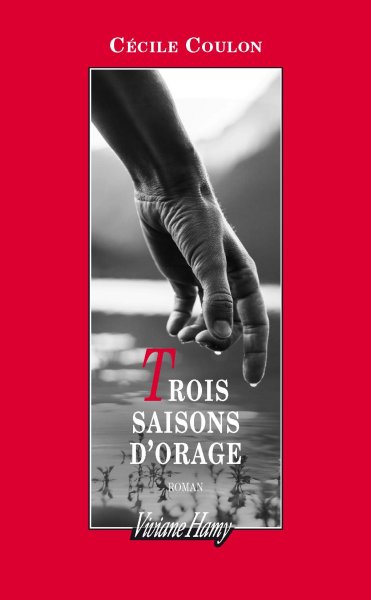
Trois saisons d’orage ~ Viviane Hamy
ISBN : 9782878583373
272 pages
Prix public 19 €
Parution le 5 janvier 2017
 Simon Johannin
Simon Johannin
L’Été des charognes ~ Allia
ISBN : 9-791030-405842
144 pages
Prix public 10 €
Parution : janvier 2017
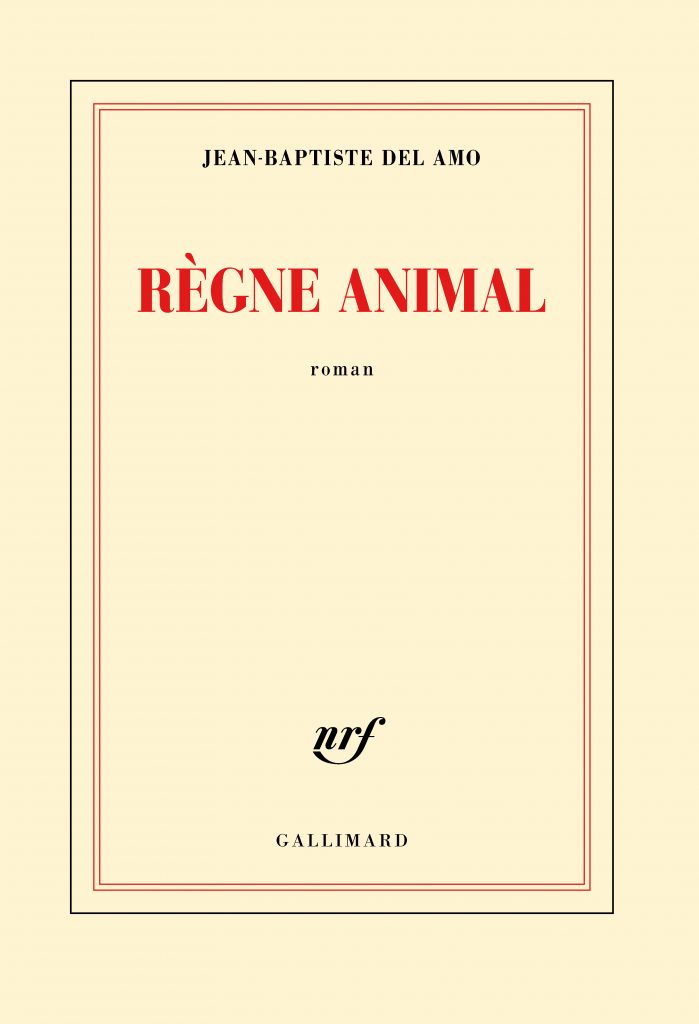 Jean-Baptiste Del Amo
Jean-Baptiste Del Amo
Règne animal ~ Gallimard
Collection Blanche
ISBN : 9782070179695
432 pages
Prix public 21 €
Epub 14,99 €
Parution : le 18 aout 2016






