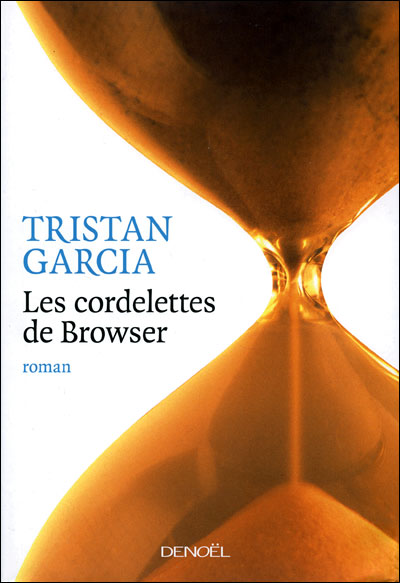 Deuxième partie
Deuxième partie
L’entretien avec Tristan Garcia par les étudiants du master création littéraire se poursuit — Natacha Devie, étudiante dans le master, et Jonathan Trampon, étudiant en philosophie, reviennent sur la question de la captation du temps dans le roman ainsi que sur la dotation de sens dans le récit.
.
Si vous souhaitez relire la 1re partie de la rencontre, il vous suffit de cliquer ici.
Il ne vous reste plus qu’à découvrir la suite de cette entrevue.
Conversation avec Tristan Garcia — 2e partie
Sommaire
Sur l’esprit du temps
1. la transcendance du roman
2. la croyance dans le récit
3. donner du sens
4. la mélancolie du vigile
Entretien
Jonathan Trampon — Si je reviens à l’esprit du temps (et il me semble que c’est lié à la surinterprétation du journaliste), dire qu’il y a un esprit du temps ne signifie-t-il pas qu’il y a encore quelque chose de commun et donc quelque chose qui est déjà partagé ? Jusqu’à quel point n’y a-t-il pas encore une forme de singularité éparse, de conglomérat, comme on peut le retrouver avec la première nouvelle de 7 ou la drogue fait le lien entre les personnages ? On ne peut pas vraiment dire qu’il y a quelque chose de l’ordre du lien social, à partir du moment où l’objet n’est plus là, l’élan se dénoue.
Dire qu’il y a un esprit du temps, cela ne veut-il pas dire qu’il a encore quelque chose qui peut être défendu ?
Tristan Garcia — C’est une vraie question. Assurément, pour moi, le roman est fondé sur l’espoir du fait qu’il y a encore quelque chose de commun. Il y a encore une forme transcendantale qu’on ne voit pas nécessairement mais dans laquelle on est tous pris, quelles que soient nos classes sociales et nos singularités. J’espère que nous sommes encore pris par quelque chose de commun qui soit suffisamment large pour qu’on ne le voie pas et que le roman pourrait trouver et dire. Ma croyance au roman vient de l’idée qu’il puisse être capable de détecter, de dire et de rendre visible quelque chose de commun. À mon avis la sociologie et la politique en sont incapables.
Mais je suis aussi attaché au fait que ce soit de l’ordre de la croyance. Je n’en suis pas certain. Ce n’est pas un savoir. C’est une forme de foi dans le fait qu’il est possible de produire des récits et que ces récits peuvent rendre compte de quelque chose comme un transcendantal, quelque chose sous condition de quoi nous sommes tous, et le faire assez finement pour ne pas être de l’ordre du jugement journalistique, sociologique, et ne pas le nommer, mais le raconter.
Je me suis aperçu que j’ai été éduqué, comme beaucoup de gens de ma génération, dans une sorte de croyance paradoxale, moderniste, de croyance dans le soupçon. Vous connaissez L’Ère du soupçon, de Natalie Sarraute, les maîtres du soupçon, Marx, Freud, Nietzche… Il y a un moment où je me suis aperçu que j’avais, dans le récit, une croyance naïve. J’avais une grande confiance anthropologique dans la forme du récit. C’est venu du fait qu’il m’a semblé que toutes les lectures dont j’avais héritées sur ce qu’est le roman étaient des lectures à courte vue.
C’est-à-dire l’histoire du roman qu’on s’est raconté, que les modernistes se sont racontée. Voyez la théorie de György Lukács, Kundera, etc. Ce sont en fait des histoires à très courte vue qui sont extrêmement centrées sur l’histoire du roman européen avec l’idée que le roman est amené avec le roman de chevalerie, l’amour courtois, et puis globalement avec l’émergence de la bourgeoisie européenne. Mais les grands théoriciens du roman européen ignorent complètement qu’il existe un roman chinois avant ça, ignorent les sagas nordiques, Gilgamesh, Sinouhé l’Égyptien, les grandes formes épiques à Oures, à Suz, à Babylone, qui ignorent les récits arméniens, etc.
J’ai découvert dans les années 2000, en lisant notamment ce qu’on appelle de l’histoire globale anglo-saxonne, l’histoire globale du roman, qu’en réalité, il y avait une histoire du récit beaucoup plus large et qu’elle est une forme anthropologique partagée dans toutes les cultures ; que la distinction entre épopée et roman à la Lukács ne valait pas (l’épopée, ce serait avec les Dieux, et le roman c’est l’épopée des hommes sans Dieux) ;
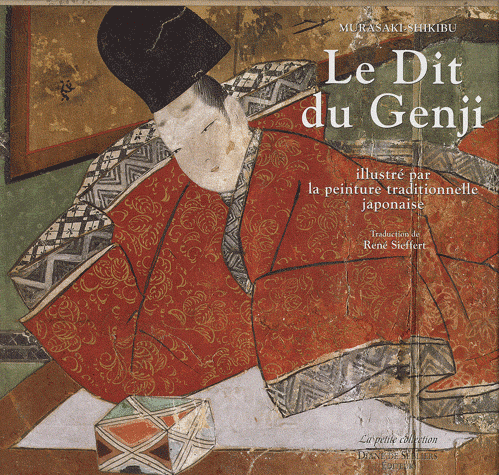
Le Dit du Genji, Murasaki Shikibu (Auteur), René Sieffert (Traduction), aux éditions Diane de Selliers.
dans Sinouhé l’Égyptien, il n’y a pas de Dieu, dans les épopées arméniennes il n’y a pas de Dieux, dans Le Dit dû Genji, ce grand texte japonais, il n’y a pas de Dieux non plus. Dans beaucoup de textes chinois aussi, dans Au bord de l’eau, il y a juste des Dieux au début puis ils n’y sont plus. Donc ça vient d’un moment où je me suis aperçu que je ne croyais plus à la méfiance dont j’avais hérité vis-à-vis des formes du récit. Cette espèce de méfiance méticuleuse, l’idée qu’il fallait avoir un rapport très réflexif, très précautionneux à la forme du roman, parce qu’on risquait d’être piégé. Tout cela naissant d’une lecture d’une petite parenthèse historique de ce qu’avait été le roman et d’une crise du roman, qui est en fait une crise du roman bourgeois européen.
En redécouvrant que le récit est une forme humaine partagée, très large, il m’a semblé assumer une sorte de foi, de croyance et en même temps de confiance dans le fait que le récit était une grande forme anthropologique partagée par les cultures qui ensuite prenait des genres et des aspects différents. Quand il m’a semblé pouvoir sortir du XXe siècle grâce à cette confiance et en renouant avec, de chercher à raconter des histoires en n’ayant plus sur les épaules le fardeau du surmoi moderniste de la méfiance et de la déconstruction, je me suis mis à penser qu’effectivement, le roman était une forme de confiance pour des gens qui comme moi n’avaient pas d’autre foi religieuse, et que cette foi était liée — quand à chaque fois dans les récits je cherche à dire ou raconter quelque chose comme le monde commun — à ce dans quoi nous sommes pris. C’est considérer le récit comme un outil humain pour essayer de saisir quelque chose qui dépasse la biographie, la vie propre. Le récit comme une grande forme anthropologique, qui passe par le mythe, l’épopée, etc., pour essayer de saisir notre condition et une condition commune.
J. T. — Si ce n’est lié à quelque chose de la croyance ou de la foi, c’est aussi une donation de sens. Effectivement, notamment avec le post-modernisme, le sens n’est plus là. Le roman a à sa charge de donner du sens.
Ça peut paraitre très naïf si je le dis comme ça, mais je crois qu’au fond le roman est la forme qui permet de croire à la possibilité de donner sens quand on n’a pas d’autres formes de croyance, quand on manque de religiosité. Ce qui est mon cas. Je crois qu’il existe profondément, humainement, une alternative entre une donation de sens religieuse, qui est un type de récit (les religions sont des récits) et un autre type de récit qui est la fiction.
La différence c’est que la religion est à chaque fois une fiction qui ne se présente pas comme fiction. L’avantage de la fiction lorsqu’on fait du roman, c’est que c’est une fiction qui se présente comme fiction. C’est la grande différence avec le religieux, évidemment. Ça permet probablement pour un type d’homme d’avoir une forme de croyance tout en gardant une forme de distance sceptique. Quand on fait de la fiction on a le plaisir et on investit de croyance la possibilité de raconter tout en le présentant comme un récit. Il y a la possibilité de penser qu’on est réaliste ou matérialiste. On ne ment pas sur son mensonge.
Dans le discours religieux il faut à un moment accepter d’être quelqu’un qui produit un récit qui décide de ne pas se présenter comme un récit fictionnel mais comme un récit fondationnel, comme une révélation. Profondément, mon rapport au roman est lié à ça. À la redécouverte, je crois qu’il y une sorte d’alternative anthropologique entre avoir l’esprit religion ou avoir l’esprit fictionnel.
J. T. — Ça nous a amenés à considérer une des portes d’entrée qui était effectivement l’affect. Il est vrai que dans tes livres il y a tout de même quelque chose de l’ordre de la dépression et de la mélancolie. Si on relit une certaine partie du 20e siècle, un des aspects qui a été travaillé par les philosophes où les écrivains, c’est l’angoisse : c’est-à-dire la question du sens. Il me semble que dans la dépression cette question du sens n’est pas à la même intensité que dans l’angoisse.
Je ne sais pas comment nommer cette espèce de teinte que, malgré moi, tous mes livres prennent. C’est très bizarre. Quand je conçois un livre j’ai l’impression d’être extrêmement optimiste, presque trop ! Très naïf. Et puis à la fin quand je lis mes livres je suis un peu effrayé par le caractère extrêmement mélancolique et abattu du résultat ! (Rires) Je n’ai pas l’impression que c’est mon tempérament, mais il se trouve que les livres sont comme ça. Parfois j’ai l’impression que c’est le roman qui est mélancolique, mais que ce n’est pas moi. Au fond, en écrivant des romans je me soumets à une forme et quand on raconte, surtout du roman un peu classique vers lequel je tends, on prend le point de vue de la fin quoi qu’on fasse. On raconte une histoire. On peut essayer de croire, mais on ne peut pas écrire ça comme un manifeste politique. On ne peut pas tout à fait ouvrir l’avenir. Ce n’est pas possible. On est obligé de se situer comme une sentinelle à la fin du récit. Donc on est obligé de voir les choses du point de vue du crépuscule. On ne peut pas tout à fait faire autrement.
Je ne sais pas jusqu’à quel point c’est un affect personnel, jusqu’à quel point je suis mélancolique, et jusqu’à quel point c’est dicté par une fidélité au roman. C’est un problème narratif. J’ai beau vouloir, sur Faber, sur Mémoires de la jungle, sur 7., essayer de produire des en avants romanesques je me retrouve bloqué narrativement par le fait que je suis obligé de prendre le point de vue du moment où les choses sont déjà finies. Et étant fini, il y a toujours cette teinte. Ce n’est pas de l’ordre de l’angoisse. C’est plus proche de la mélancolie ou de l’impression de toujours parler des espérances, des idéaux, des croyances du point de vue de leur fin, qui n’est pas nécessairement un échec ! Je ne sais pas jusqu’à quel point il est possible de faire du roman ouvert, sur l’avenir.
Natacha Devie — Il n’y a donc pas de liberté par rapport à cette fin ?
Ce n’est pas une absence de liberté, c’est une question de point de vue. C’est simplement l’impression qu’à un moment, en racontant, le point de vue du narrateur est nécessairement a posteriori, en fin de narration. Quand dans Faber j’essayais de raconter l’adolescence, il me semblait que je ne pouvais pas faire autrement que de le raconter du point de vue adulte. De la fin de cet âge-là. C’est peut-être lié à mon rapport à la narration, tout simplement.
Il se trouve qu’en racontant, je me retrouve à avoir cette mélancolie du vigile. De la sentinelle postée à la fin de l’histoire.
Par exemple, ce que j’ai toujours beaucoup aimé dans la science-fiction, qui est la littérature qui m’a le plus passionné adolescent, c’est qu’on peut la voir comme la littérature qui raconte demain. La littérature de l’avenir. Mais en réalité, quand on aime la science-fiction, on s’aperçoit que la plupart du temps, le point de vue science fictionnelle est le point de vue d’après-demain. Il faut être capable d’être posté après-demain pour pouvoir raconter demain. J’ai toujours aimé passionnément le mélange entre l’en-avant, la prospective, la croyance au futur et en même temps cette teinte mélancolique dans la plupart des œuvres de science-fiction que j’aime en tout cas. C’est le moment où même l’avenir peut être raconté comme un passé. Car même l’avenir passera.
La fin est déjà connue, on regarde rétrospectivement, et en même temps j’ai cru comprendre qu’il y a cet esprit du temps dont on est tous plus ou moins conscients et qui se révèle à travers les romans. Ce que je comprends, c’est que le romancier lui-même voit la chose se révéler au fur et à mesure qu’il écrit, donc que son propre roman lui échappe puisqu’en faisant partie de tout le monde il n’est pas conscient lui-même de cet esprit du temps jusqu’au moment où il l’écrit. Il y a un mélange de choses qui se révèlent à lui et dont il est ignorant lui-même. Et en même temps il y a ce regard ayant vécu la fin.
Tout cela est de l’ordre de la rationalisation après coup, ce n’est pas quelque chose qui est programmé. Je pense qu’aucun romancier n’a cette sensation au moment de raconter une histoire. C’est quelque chose qui se découvre une fois qu’on a raconté l’histoire et qu’on réfléchit à ce qu’y s’est passé, à ce qu’on a fait. Ce n’est pas un sentiment de nécessité. C’est le même sentiment qu’on a lorsqu’on regarde notre propre passé : quand on réfléchit à son enfance, à son adolescence. On est posté au bout de ce qu’on a raconté. C’est une question de point de vue. Dans ce que je fais, je ne sais pas le faire autrement, je fais apparaitre cette posture. Mais c’est souvent une révélation pour moi à la fin, je vous l’ai dit. En général je pars plutôt avec une idée optimiste, mais je suis toujours rattrapé à la fin par cette impression. C’est presque un tic, c’est quelque chose qui m’embête.
Je me retrouve souvent avec des fins réflexives. Il apparait que le narrateur est l’écrivain. Et je ne suis pas satisfait de ça, je me sens bloqué par l’impression que se révèle à la fin du récit ma position de conteur.
C’est un sentiment très différent de la théorie, puisque j’en écris aussi. Dans la théorie j’ai souvent l’impression, comme en philosophie, de chercher à produire du possible et au contraire d’aller au bout de certaines idées et de parvenir à ouvrir, d’arriver à produire des textes qui sont programmatiques, qui donnent quelque chose à faire, qui ouvrent un horizon. Je n’ai pas cette impression dans le roman. Je ne dis pas la littérature, juste le roman. Il y a des formes de prose qui y sont ouvertes au contraire.
J’imagine que chaque romancier affronte ce sentiment et que chacun à sa manière de le mettre en scène, ce n’est pas révolutionnaire de dire que la mélancolie est un affect romanesque… le roman Proustien est le prototype de ce type de sentiment, avec à la fin la révélation et la manière dont le narrateur rejoins l’écrivain à la fin du parcours et à la fin du Temps retrouvé. J’ai été très marqué par ce type de roman, comme le Le jardin des finzi contini de Giorgio Bassani. D’ailleurs ce sont souvent des romans de fin d’époque. Mais bon, là c’est de l’ordre du tempérament.
.
Fin de la deuxième partie.
*
Pour relire la 1re partie de la rencontre : Entrevue avec Tristan Garcia — 1re partie.
Pour lire la 3e partie de la rencontre : Entrevue avec Tristan Garcia — 3e partie.