Marathon des mots
13e festival international de littérature

24 Juin 2017
Autour de la table, Omar Benlaala, Emmanuelle Pagano et Martín Solares, ainsi que les étudiants du master création littéraire de Toulouse, pour une petite heure d’entretien avec les auteurs et le public.
Entre récits autobiographiques et éléments de vie mêlés à la fiction, ils bâtissent chacun à leur manière une œuvre à partir de la réalité : qu’ils parlent de l’intégration des jeunes musulmans français, ou de l’ennoyage d’une vallée dans l’Aveyron, jusqu’à la situation du Mexique.
Retour sur une rencontre avec les voix les plus singulières de la littérature française et mexicaine.
Rencontre avec Omar Benlaala, Emmanuelle Pagano et Martín Solares — 1re partie
Sommaire
1. Entre fiction et briques de réels
2. Combler le fossé avec les ancêtres
Conversation à bâton rompu avec et/menée par Martín Solares
3. La diversification obligatoire des auteurs
Entretien
Dimitri Thomas — Emmanuelle Pagano, Omar Benlaala : vous êtes tous les deux des auteurs qui jonglez avec le réel, ce qui a vraiment eu lieu et ce qui est inventé, la fiction pure. Omaar Benlaala, avec d’abord un récit autobiographique, puis une fiction dans laquelle on retrouve des éléments autobiographiques : la difficulté pour un jeune français d’origine kabyle de vivre en France ; Emmanuelle Pagano : pour ne parler que de la Trilogie des Rives, vous raconter dans Lignes et fils l’histoire d’une famille de mouliniers : ce n’est pas votre famille, mais vous incluez un récit biographique sur votre enfance au bord de la rivière de la Baume. Et dans Saufs Riverains, vous faites pratiquement l’inverse : vous racontez l’histoire vraie de votre famille des deux côtés du plateau du Larzac : mais ce que vous écrivez dans ce livre sur votre enfance ne correspond pas à ce qui s’est vraiment passé.
Comment choisissez-vous les faits que vous allez raconter ? Qu’est-ce qui fait que vous allez tantôt opter pour une approche autobiographique et tantôt pour une approche fictionnelle ?
Emmanuelle Pagano — C’est exactement, à un détail près, la répartition pour La Trilogie des Rives. À un détail près car les éléments qui ne sont pas autobiographiques ne sont pas pour autant fictionnels. Ce sont des éléments que j’ai pris dans d’autres histoires, d’autres réalités. C’est une histoire de terminologie il me semble. À partir du moment où je raconte, cela devient une fiction. Que ce soit ma vie ou celle des autres, quelque chose que j’ai pris à la radio, chez des voisins, chez des gens qui vivaient près de moi il y a très longtemps… ou le fait de réécrire l’histoire d’un personnage qui a réellement existé, mais dont je ne sais pas s’il a fait telle chose ou telle chose que je lui attribue. À partir du moment où je raconte et qu’il y a une narration : pour moi, c’est de la fiction. Autofiction ou pas.
Pour le choix, je n’ai pas réfléchi. Saufs Riverain, le deuxième tome, était évident car je partais d’un lieu très particulier que sont les vignes de mon grand-père noyées sous l’eau. Donc automatiquement, j’ai creusé la généalogie. Mais à la limite, il n’y a que la structure, les lieux et les dates de naissance qui sont autobiographiques. Après le reste, ce sont des digressions que vous appellerez peut-être fictives, moi je dirais narratives, puisque je les ai prises ailleurs.
Le choix se fait en fonction d’où je veux arriver, quand je le sais, et de comment je vais structurer le récit. C’est l’histoire que je veux raconter, que je ne connais pas forcément au début mais que je vais rencontrer, cette espère de cohérence que je vais donner qui fait que je vais choisir tels éléments ou d’autres.
Omar Benlaala — Pour ma part, dans le premier livre tout est vrai. C’est un récit de vie né d’un court texte que j’ai déposé sur internet. Il a été repéré par un monsieur qui s’appelle Pierre Rosanvallon, aux éditions du Seuil, qui m’a demandé si je me sentais capable de faire de ce texte un livre.
Ayant quitté très jeune l’école (j’ai arrêté officiellement en 3e) ça m’a toujours manqué d’apprendre, d’écrire des choses, d’en lire. Je n’ai plus eu l’occasion de le faire assez rapidement, vers 14-15 ans. Quand il m’a proposé de faire de ce court texte un livre j’ai accepté.
La première raison, c’était d’une certaine manière de retourner à l’école. À travers l’écriture d’un livre et la littérature. Ce court texte était complètement autobiographique. Et donc le livre répond aussi à cette exigence. Si vous avez un jour l’occasion d’y jeter un œil, vous verrez qu’il y a des passages assez drôles, même presque extraordinaires, qui se sont réellement passés, comme beaucoup de choses extraordinaires peuvent se passer entre 20 et 30 ans. Ça raconte un peu cette période-là.
Pour le second, il n’était pas beaucoup plus prévu que le premier puisqu’il réagit à un livre que j’ai lu : Histoire de la violence, d’Édouard-Louis, que vous connaissez peut-être. Le livre est paru en janvier 2016, nous étions en plein débat sur la déchéance de nationalité, après l’année 2015, terrible, entre les attentats de Charlie Hebdo, de l’Hyper Casher et du Bataclan. J’habite à deux rues du Bataclan, donc j’étais encore plus dans cette ambiance sinistre. Il se trouve que j’anime des ateliers de commentateurs sportifs avec des gamins dans des quartiers difficiles à Paris et en banlieue, et quand ce livre est sorti je leur en ait parlé. L’un des personnages de ce livre est un espèce de héros malfaisant. C’est un Franco-Maghrébin. Il s’appelle Reda. Il rencontre le héros du livre, Édouard, et il est armé le soir de Noël, place de la république. Il drague en fait Édouard, il lui ment, puis il l’invite chez lui et il le vole. Et après il essaie de le violer, donc c’est un menteur, un voleur, un violeur. Et finalement il essaie aussi de l’assassiner donc c’est aussi un assassin. Voilà un peu qui est ce personnage.
Je le leur dis et je leur demande : « Voilà, y a ce livre qui est sorti. Qu’est-ce que vous en pensez ? » On n’arrêtait pas de parler dans les médias sur ces enfants d’immigrés, surtout musulmans, et qui étaient soit des terroristes soit des délinquants ; c’était souvent assez binaire comme malheureusement parfois ça peut être le cas.
Et les gamins face à moi m’ont dit : « On va essayer de le retrouver, on va lui casser la figure, on va se venger. »
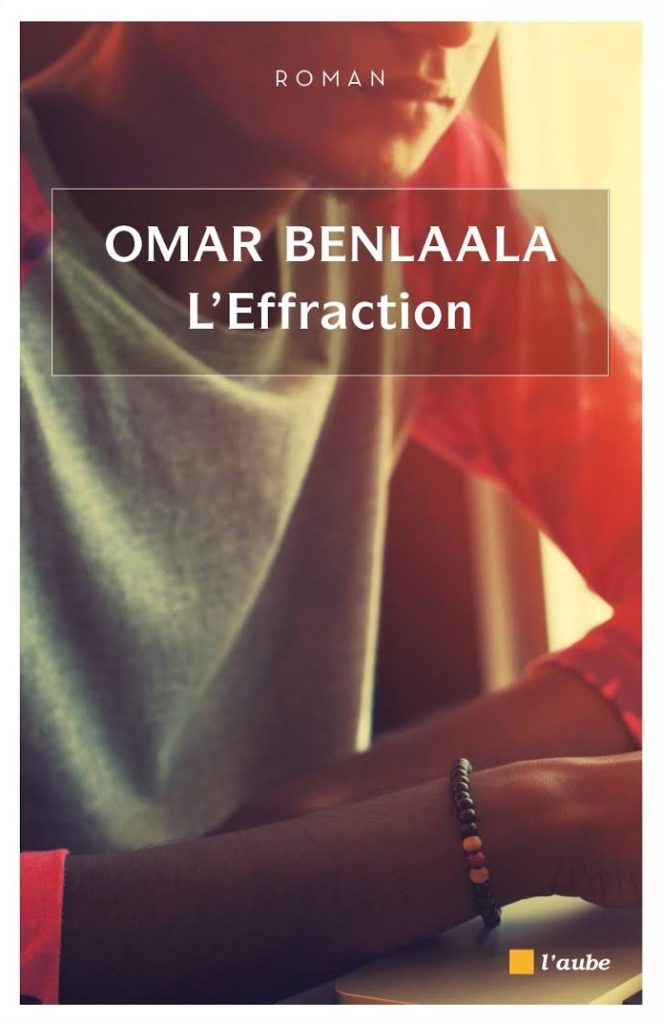 Attendez… y a peut-être un autre moyen de réagir à un livre qui ne vous a pas plus et qui vous a blessé, non ? « Ben comment est-ce qu’on fait ? » Peut-être en écrivant un autre livre ? Au début, je voulais réagir avec un texte sur une page Facebook : comme les gens font parfois.
Attendez… y a peut-être un autre moyen de réagir à un livre qui ne vous a pas plus et qui vous a blessé, non ? « Ben comment est-ce qu’on fait ? » Peut-être en écrivant un autre livre ? Au début, je voulais réagir avec un texte sur une page Facebook : comme les gens font parfois.
Et puis je me suis souvenu que j’étais écrivain, et que nous avions un terrain commun : la littérature. Ce que j’ai fait, pour répondre à votre question, c’est que j’ai pris des éléments de son livre à lui, lui-même dit que tout est vrai dans ses interviews, mais c’est un livre où sur la couverture il est écrit « roman »… Donc on ne sait pas ce qui est de l’ordre de la fiction et ce qui ne l’est pas.
J’ai fait la même chose : j’ai fait un roman. J’ai repris des éléments de son livre et j’ai interrogé des jeunes franco-maghrébins que je connais, des gamins de 20 ans, des gamins de 15 ans. J’ai interrogé ma mémoire, puisque j’ai aussi été dans cette situation et j’ai déplacé les personnages qu’Édouard Louis a mis en scène pour donner une autre voix, celle ceux d’un jeune Parisien d’origine kabyle. Je raconte sa difficulté à concilier ses deux cultures : celle de ses parents venus d’Algérie et la culture française qui est véritablement la sienne puisque c’est là qu’il est né et c’est là qu’il a grandi. Il y a un petit peu de réalité, un petit peu de fiction ; et ce qui est vraiment fictionnel, c’est le fil du récit : la rencontre entre Reda et Édouard, que je réimagine à ma sauce, les lieux, les dialogues.
Je me suis servi du personnage sociologue pour que ce soit autant que possible un discours : dans ce livre, il n’y a pratiquement que du dialogue. Tout simplement parce que dans le livre d’Édouard Louis, le Reda en question ne parle pas…
On ne l’entend pas.
Je me suis dis que ce serait bien qu’on entende un peu l’un de ces Franco-Maghrébins parler, parce qu’on parlait énormément d’eux, aux journaux, dans la presse, mais qu’on ne les entend jamais.
Voilà où se situe la frontière.
Dimitri Thomas — Martín Solares, hier, durant votre rencontre avec Antonio Ortuno, vous avez dit que vous preniez des briques de réalité pour les transformer et construire quelque chose de nouveau. Vous êtes un architecte en fait.
Martín Solares — Quand j’écris des romans, j’essaie de travailler un peu comme un maçon. Je m’habille comme un architecte, pour ainsi dire. Et tous les jours, au Mexique, je suis obligé de porter le costume d’architecte avant d’emmener mes filles à l’école.
De 5 heures à 7 heures du matin je travaille très fort, et après les avoir emmenées, je retourne travailler. Je regarde tout ce que j’ai écrit dans cette part de la nuit et je me dis : « Non non non. C’est qui les personnes qui ont tué cette personne ? Ce n’est pas bon, on va effacer et tout recommencer une deuxième fois. »
La deuxième fois, on est obligé de le faire beaucoup mieux.
J’essaie de prendre une brique de réalité et de faire quelque chose avec ce morceau, mais on ne peut pas le prendre comme ça, au Mexique : c’est très compliqué. Les journaux, les médias ont déjà fait ça, comme des miroirs : donc mon obligation comme écrivain, c’est de travailler avec mon imagination.
J’essaie de faire une sorte d’enquête avec ces mots et ces briques de réalité, je la ponce, je la met dans mon laboratoire et je prends seulement quelques mots de la réalité qui me donnent beaucoup plus que toute la réalité complète du Mexique. Une fois, Salman Rushdie a écrit qu’un écrivain sert uniquement et est obligé de chercher les mots cachés, j’espère avoir fait ça dans mes deux romans.
Quand j’ai commencé à écrire N’envoyez pas de fleurs, je me suis rendu compte que personne n’employait le mot « justice » au Mexique. Chaque fois qu’il y avait un sujet violent personne ne disait « on va faire justice ». Pourquoi ? Parce qu’ils ont tous peur des criminels.
Quand vous vivez dans une société où le mot justice disparait, tout change. Vous avez l’impression que vous marchez au-dessus d’une nuit qui a duré de nombreuses années déjà. J’essaie de parler de ça dans ce roman.
Robin Fillon — Emmanuel Pagano, dans Saufs Riverains, il est question du fossé qui vous sépare de vos ancêtres, creusé notamment par les différences de langages, de cultures et de modes de vie. Vous dites que vous ne parlez pas le même français que vos ancêtres, vous vous différenciez de leurs professions. Eux étaient agriculteurs et infirmiers. L’écriture est-elle un moyen de combler ce fossé ?
Emmanuel Pagano — Oui tout à fait. Les infirmiers, ce sont les collatéraux, les oncles et les cousins… Si je remonte ma généalogie, mes ancêtres sont tous agriculteurs. Et effectivement, ils parlaient occitan. Même pas un occitan pur, mais une espèce de patois que je ne comprenais pas, vraiment une langue différente du français (mais c’est une langue française tout de même !)
Mes grands-parents parlaient quand même le français, en tout cas ils l’écrivaient, mais ils ne faisaient pas toujours l’effort de le parler. En plus mon grand-père avait une trachéotomie, donc je ne comprenais rien à ce qu’il disait. À cela s’ajoutent des différences de culture et de préoccupations. Je me suis longtemps interrogée sur ce métier particulier de paysan, avant même de faire cette recherche. Je vis moi-même dans un endroit où on ne peut pas vivre si n’on est pas paysan, sauf peut être si on est écrivain. Un endroit très ingrat, très difficile, avec une météo particulièrement compliquée.
J’ai essayé de comprendre dans Saufs Riverains la relation de l’homme et de l’eau et je me suis interrogée sur les premières écritures. Et il me semblait que les premières écritures étaient écritures paysannes : que le premier écrit était le paysage. J’ai rapidement compris en étudiant l’eau et la nature qu’il n’existe plus de nature à l’état sauvage, mais que ce sont des paysages : c’est-à-dire une nature travaillée par l’homme. Et ce travail de l’homme sur le paysage relève pour moi vraiment du dessin ou de l’écriture.
Sur des espaces énormes, avec des chemins, des terrasses, des forêts, des champs, des délimitations de territoires sur des milliers d’années et des milliers d’années, on le date au moins du néolithique, et sur des espaces de centaines de milliers de kilomètres. Alors que moi j’ai un petit rectangle ! (Rires) C’est très modeste comparé à tout ça, finalement c’est peut être un peu la même chose : essayer de comprendre un territoire d’une façon ou d’une autre.
R. F. — Omar Benlaala, il est question aussi, dans vos deux romans de ce fossé. Vous ne parlez pas arabe, vous n’avez pas grandi en Kabylie et votre profession s’éloigne de celle de vos ancêtres.
Omar Benlaala — Effectivement, tout ce que je fais j’ai l’impression de le faire pour me rapprocher de mes parents. C’est intéressant comme question. Le premier, quand on m’a demandé si je voulais bien écrire, je me suis demandé à quoi ça pouvait servir et surtout à qui ? Et je me suis dis qu’au moyen il y aura le nom de mes parents, venus d’Algérie, analphabète, et qui ont fait tout ce trajet finalement pour que leurs enfants aillent à l’école. Ça pourrait déjà peut être un peu leur rendre hommage. C’était vraiment la première des raisons.
Si vous lisez le premier ou le deuxième livre, il y a souvent des allez-retours entre le personnage et les parents : et encore plus pour le troisième que je suis en train d’écrire, vu que j’essaie d’écrire leur histoire. C’est assez intéressant et je suis assez sensible à ce que dit ma voisine [de table, Emmanuel Pagano] : mes parents sont venus de Kabylie et mon père est arrivé en France en 63. Il est devenu maçon. Il a construit des murs. Mais je n’ai pas envie seulement de raconter leur histoire, et que c’était dur. C’est un peu facile. Je m’interroge sur une place dans mon quartier qui s’appelle la place Martin-Nadaud. Il se trouve que ça a été le premier maçon creusois à devenir député sous la 3e République. Il y a une biographie qui est extrêmement intéressante qui raconte son cheminement, son parcours, et il raconte un peu toute cette immigration de l’intérieure, donc des régions Françaises. Lui c’était la Creuse, mais il y en avait pas mal qui montaient à Paris pour construire la Capitale et qui vivaient les mêmes difficultés, par rapport à la langue par exemple : la mère de Martin Nadaud qui était de la Creuse, n’a jamais parlé le français académique, elle parlait le patois creusois. Et je me rends compte qu’il y a énormément de parallèles entre la vie de mes parents qui sont venus de Kabylie, qui étaient juste avant qu’ils n’arrivent, une région française finalement, puisque l’Algérie était encore colonisée par la France à ce moment-là. Il est arrivé en 63, donc juste avant. Et finalement en l’interrogeant, moi-même je continue d’apprendre : c’est ce que j’aime en écrivant. J’apprends encore un peu mieux de leur parcours.
C’est double effet bonus, pour ceux qui connaissent encore la pub. J’en apprends encore plus sur le pays qui m’a vu naître. Je suis français, né à Paris, je connais très très peu de ce pays. Vous savez nous les Parisiens souvent on reste à Paris et puis on ne va pas beaucoup ailleurs. Pas nous les Parisiens, il ne faut pas généraliser, mais en tout cas tous les gens que je connais et qui sont de mon quartier. Par la littérature je fais des rencontres, je viens à Toulouse, j’ai été dans des villes, des villages extraordinaires que je n’aurais moi-même jamais imaginés, j’ai rencontré des gens que je n’aurais jamais imaginé rencontrer : finalement la littérature me permet de revenir à ma double origine. Mon origine de naissance, ce pays qui est la France, le mien, et celui de mes parents à travers leur parcours lié aux maçons de la Creuse.
La littérature, je le vois vraiment comme un retour à l’école : je suis toujours surpris d’être invité avec des écrivains ! Je me dis que j’ai beaucoup de chance. Pour moi, là maintenant, je dois être en seconde ou en terminale. Et j’espère passer mon bac l’année prochaine avec le prochain livre.
(Tu n’habiteras jamais Paris, Flammarion, est paru le 19 septembre 2018.)
Conversation à bâton rompu avec et/menée par Martín Solares
Dimitri Thomas — Martín Solares, vous êtes un auteur assez discret : vous avez publié 2 romans, le deuxième huit ans après le premier, qui lui-même avait demandé 7 ans d’écriture. Quelle place tient votre activité d’écrivain dans votre vie exactement ?
Martín Solares — Ouf ! Hum… J’ai été toute ma vie très très hyperactif. Je fais plein de choses en même temps.
Au Mexique, afin de survivre, vous êtes vraiment obligé de vous diversifier. Pendant cinq ans j’ai travaillé comme scénariste, comme réalisateur, comme romancier pour moi-même. C’est la première chose j’ai faite : j’ai commencé le roman ou des nouvelles.
Je travaille uniquement à la main ou, si j’ai commencé à le retranscrire à l’ordinateur, je continue dessus. Mais je commence toujours à la main ce qui me passe par la tête.
Je trouve qu’on a une demi-heure de grâce quand on se réveille. Vos préoccupations et vos angoisses vont toujours se réveiller une demi heure après vous et quand vous avez écrit votre première page, ils sont en train de bâiller et de s’étirer !
Donc si j’arrive à écrire une page chaque matin, je suis très content et les problèmes de la journée qui arrivent après, je les supporte et je les supporte tous les jours si j’arrive à commencer cette première page… le reste du jour je peux vivre plusieurs catastrophes, ça n’aura pas d’importance.
Je travaille aussi comme éditeur, j’essaie de travailler sur mon portable tous les soirs.
Mais j’ai arrêté de travailler comme éditeur car l’an dernier je me suis rendu compte que j’avais vingt et une années en tant qu’éditeur littéraire et qu’il était temps de me concentrer sur les deux romans que j’ai en cours et dont je suis déjà à la moitié, histoire de les finir. Je me suis retrouvé à travailler les différentes formes romanesques qu’on peut trouver dans le monde. Et plusieurs petites nouvelles pour les enfants sont arrivées. J’ai tout arrêté et je me suis dit : « On va vivre comme Mahama Ghandi. »
Et j’ai commencé à vivre comme Mahama Ghandi : c’est à ce moment j’ai gagné un prix littéraire au Mexique.
Pendant deux mois je me suis dit que j’avais trop peu d’argent pour vivre, que j’allais crever, et quelqu’un m’a dit « pourquoi tu ne testes pas ce prix ? » Je n’ai jamais eu l’habitude de faire ça, mais je l’ai écouté : et heureusement j’ai gagné. J’ai eu une deuxième année de travail grâce à cela. Pour nous avoir un peu d’argent signifie avoir un peu de temps pour écrire. Et je suis très content de ça.
J’ai fini un scénario avant de venir ici au Marathon des Mots de Toulouse, ça va me donner quelques mois en plus. Dans deux mois je finis mon troisième roman et l’an prochain, si tout va bien, j’espère finir un petit roman très intense. Je suis sur le point de le finir. (Comment dessiner un roman, aux éditions Christian Bourgeois, est paru le 13 septembre 2018)
Afin de survivre on doit diversifier son écriture.
Emmanuel Pagano — (Rires) Martín, en France, c’est exactement la même chose !
Martín Solares — J’aimerai bien connaître les paysages que vous voyez chaque matin pendant que vous écrivez.
Emmanuel Pagano — Moi ? Je suis sur un plateau d’altitude. À 1 300 mètres, donc je vois des arbres, des cailloux, des vaches.
Martín Solares — Waow ! Vraiment génial ! Au Mexique nous sommes à 2 300 mètres d’altitude, on a beaucoup de zones : on essaie de regarder quelque chose le matin, mais c’est de la grisaille ! De la pollution. J’habite dans une petite maison de la Basse-Californie que j’ai trouvée.
Omar Benlaala — Moi j’habite au 5e étage sans ascenseur. (Rires)
Martín Solares — J’aimerais vous poser une autre question ! Si vos livres Lignes et Fils et La Barbe étaient des animaux, quels seraient-ils ?
Emmanuel Paganno — Oh moi c’est très facile, vu que c’est une histoire de moulinage, ce serait un ver à soie.
Omar Benlaala — Presque pareil, un papillon à la fin du livre. Une chrysalide avant. Et entre-temps, un papillon qui prend de l’acide. (Rires) Enfin une chrysalide qui prend de l’acide pour sortir plus vite !

Martín Solares, Omar Benlaala et Emmanuelle Pagano lors des petits-déjeuners littéraires du Marathon des mots 2017
Martín Solares — Pour moi, c’est une sorte d’insecte aussi. Deux de mes romans ont commencé à être écrits après avoir eu un cauchemar. J’écoutais une voix qui me disait : « Écoutes Martín, c’est vrai que dans la vie de tout homme, il y a cinq minutes noires. » Je me suis réveillé. J’ai écrit ça sur un papier et je me suis posé la question : quelles sont mes minutes noires ? Et la seule réponse que je suis arrivé à trouver, c’est un roman : je ne trouvais pas la réponse définitive.
Quand j’ai mis le point final au récit, j’ai compris ce que voulaient dire ces « minutes noires. » Elles voulaient dire : « tu es obligé d’écrire à propos de nous. »
C’est très énigmatique. J’adore les images et les sons que vous écoutez pendant un rêve ou un cauchemar. J’essaie de dialoguer avec cette sorte de moi, et chaque fois que j’arrive à me réveiller, je me disais : quels sont les mots qui vont t’accompagner dans le moment de ta mort. As-tu trouvé les paroles. Je me suis réveillé : et je me suis dit que j’avais un deuxième roman à écrire ! (Rires)
le 24 juin 2017,
La Terrasse | Musée du Vieux Toulouse
.
Fin de la première partie
Lire la seconde partie de la rencontre avec : Martín Solares, Omar Benlaala et Emmanuelle Pagano — 2de partie









