Écrivain et philosophe toulousain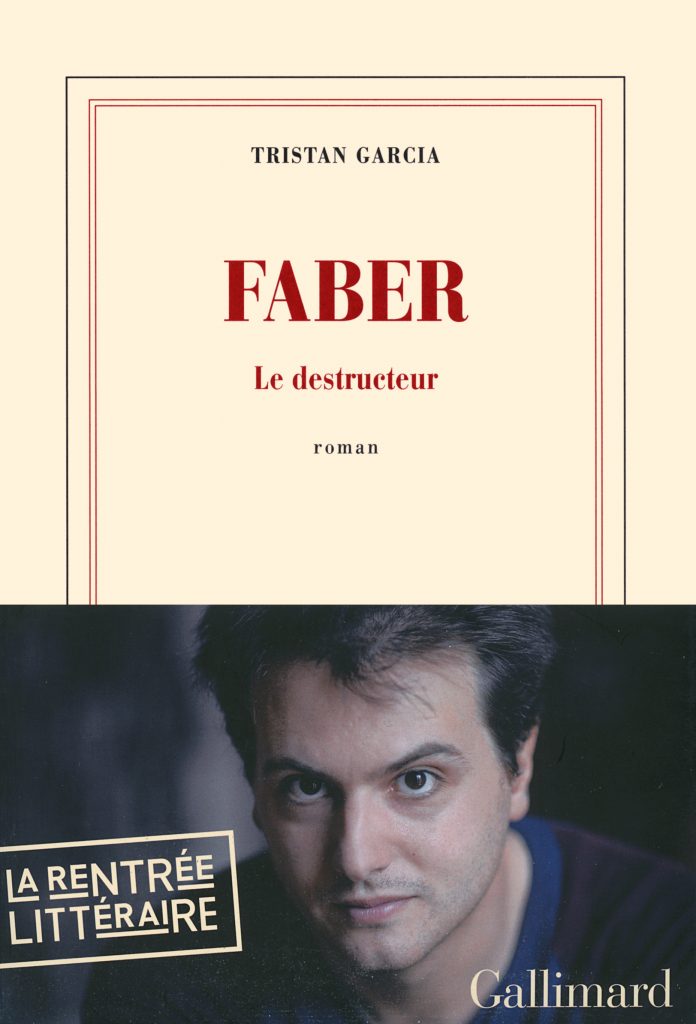
En avril 2016, les étudiants du master création littéraire de Toulouse ont pu à nouveau rencontrer Tristan Garcia dans l’enceinte de l’université, l’occasion pour eux d’approfondir les thèmes de l’auteur et d’examiner son œuvre, tant romanesque que philosophique.
La conversation étant dense, et documentée, 4 parties ne seront pas de trop pour rentrer dans la réflexion et le regard que porte l’auteur sur la littérature actuelle et sa fonction.
*
Louis-Alexandre Borrel, étudiant en création littéraire, anime la conversation pour cette première partie.
.
Mais avant tout, voici une petite présentation de l’auteur afin de mieux comprendre son parcours.
Parcours littéraire
Après avoir exploré la frontière supposée entre l’homme et l’animal dans son roman, Mémoires de la jungle (Gallimard, 2010), ainsi que dans son étude Nous, Animaux et Humains. Actualité de Jeremy Bentham (François Bourin Éd., 2011), Tristan Garcia s’intéresse aussi bien à la métaphysique dans Forme et Objet. Un traité des choses (PUF, 2011), qu’aux séries télés, avec Six Feet Under. Nos vies sans destin (PUF, 2012). La vie intense. Une obsession moderne (Autrement, 2016), est l’un de ses derniers livre de philosophie paru à cette date. Mais les suivants ne sauraient tarder.
Côté romans, l’auteur alterne romans réalistes, aventures et science-fiction, et a reçu le prix de Flore pour son premier roman La meilleure part des hommes (collection Blanche, Gallimard 2008), ainsi que le Prix du livre France Inter, avec son roman « 7 ».
Conversation avec Tristan Garcia — 1re partie
Sommaire
Sur l’esprit du temps
1. la littérature générationnelle
2. le roman pour saisir l’époque
3. la poésie, captation d’une époque
Sur la langue française
4. la fonction de la langue française
5. la création d’une langue
Entretien
Louis-Alexandre Borell — Nous sommes allés lire pas mal d’interviews et de critiques de tes ouvrages pour préparer cette rencontre et nous avons remarqué que l’une des idées qui revient souvent est celle d’un « roman générationnel » qu’il y aurait au sein de ton œuvre, mais que nous n’avons pas retrouvé. Nous ne l’avons pas ressentie ainsi.
Cela nous a laissé l’impression — et c’est une chose dont tu parles à la fin de La Conférence que tu as donnée à Lagrasse — d’une représentation de l’esprit du temps.
Comment peut-on saisir quelque chose qui pourrait s’appeler l’esprit du temps ? Comment peut-on arriver à saisir quelque chose qui peut être partageable ou être partagée ?
Tristan Garcia — D’abord, je suis content qu’on mette de côté l’idée de génération et de générationnelle, qui est un type journalistique qui est apparu récemment. Il serait intéressant de faire une généalogie de la manière dont c’est devenu un lieu commun. Cela commence peut-être avec la génération perdue dans la littérature américaine avec une sorte de publicité totalement fausse autour d’Hemingway, de Dos Passos, de Faulkner, comme si on établissait une génération commune.
C’est faux car aucun n’a été vraiment traumatisé par la guerre. Dès le départ l’idée de génération littéraire est un mensonge puisqu’à ma connaissance Hemingway ment sur sa participation à la guerre, faisant semblant de claudiquer alors qu’il n’a pas du tout été blessé, ou Fitzgerald qui ne fit pas la guerre…
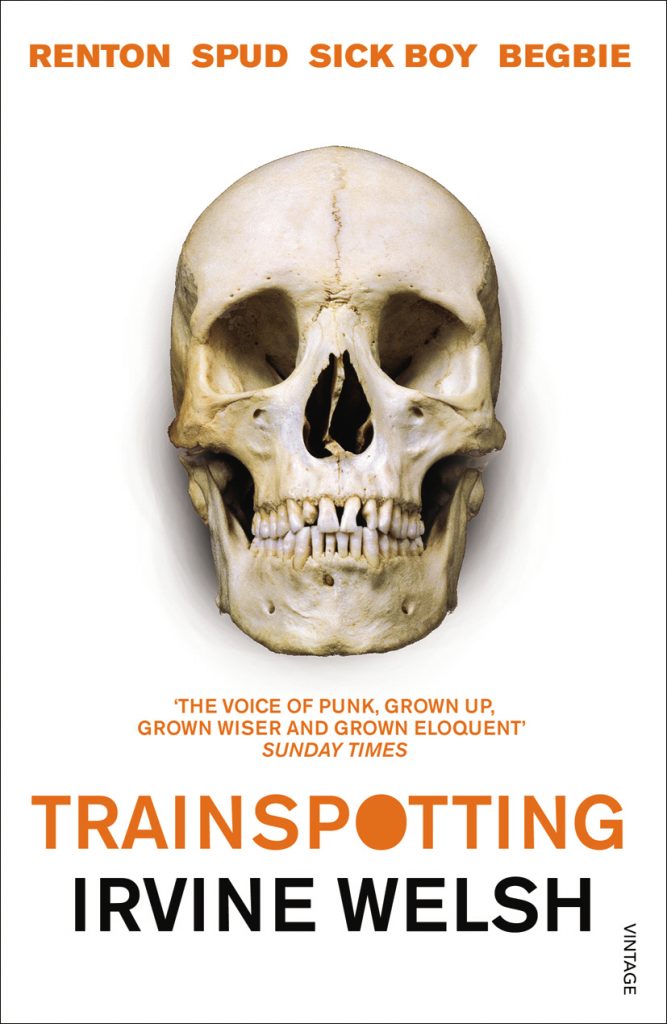
On pourrait aussi dresser une généalogie des malentendus journalistiques sur l’idée de génération en littérature qui aboutit sans doute à l’un des discours les plus pauvres que je connaisse : génération X et génération Y. Dans mon souvenir ça désignait les gens dans les années 90, tels que les protagonistes d’Irvin Welsh dans son livre Trainspotting (1997, Éditions du Seuil).
L’idée de génération est absurde. L’idée de roman générationnel aussi. À moins de tenir un discours très général qui est qu’effectivement on fait partie d’une génération au sens où l’on nait en même temps qu’un certain nombre de personne et qu’il y a des références culturelles communes quand on parle de l’enfance ou de l’adolescence avec cette impression d’avoir appartenu vaguement à un même monde culturel, mais ça ne vaut pas grand-chose.
Après il y a l’idée d’esprit du temps. Je suis beaucoup plus attaché à cette idée qui vient du romantisme allemand. M’étant divisé en deux (en faisant de la philosophie et du roman) il est possible que ma part philosophique ait investi la question des vérités éternelles et la question de l’accès possible. D’où mon intérêt pour ce qui ne bouge pas et ce qui ne change pas. Il y a cette belle idée qu’on trouve chez Descartes : l’idée du point d’Archimède. Comme disait Archimède : « Donnez-moi un point fixe et je soulèverais tout l’univers. »
Par contre, de façon évidente dans mon amour du roman, il y a toujours eu un amour inconditionnel contre les philosophes qui aiment les vérités éternelles, l’immobile et pour essayer de penser et d’accorder une véritable dignité, et une forme de vérité, à ce qui change. Ce qui change avec le temps, ce qui change avec la vie, ce qui change quand on est enfant, adolescent et ce qui fait l’époque.
Je pense que presque rien en dehors du roman n’est capable de saisir intelligemment ce qu’est une époque. Le journalisme la saisit mal puisqu’ils sont trop proches : le discours journalistique a tendance à surévaluer des formes de mutation du présent et n’est pas à la bonne distance pour voir ; les sciences sociales ou l’histoire quant à elles sont trop loin. Quand on est historien, on ramasse l’époque quand elle a déjà été constituée : c’est déjà fini. C’est comme la vieille expression hégélienne : la chouette de Minerve se lève au crépuscule, c’est-à-dire que la sagesse, la théorie, se lève une fois que les évènements sont finis, or il m’a toujours semblé que le roman, au contraire, était exactement la bonne distance pour savoir ce qu’est une époque : au sens très large.
Quel est le fil invisible qui relie la manière dont on parle, les tics de langages, la manière dont on pense, les vêtements qu’on porte, les couleurs ?
Pour prendre un exemple en négatif : j’ai toujours trouvé triste le fait que la littérature française rate en grande partie les années 70. La couleur des années 70, on la distingue dans le polar français, on le voit assez bien chez Manchette : ce lien secret entre la couleur des voitures et la manière dont les gens pensaient y est exprimé d’une certaine manière. Il y a un lien, bizarre, mais qui existe et qu’on trouve un peu dans les films, dans les bandes dessinées, mais le roman français à ce moment-là s’en est détourné : ce n’est pas quelque chose que vous allez trouver. Excepté peut-être chez Annie Ernaux, chez Modiano parfois. Mais sinon, le roman français des années 70 tourne le dos à l’idée d’époque pour plein de raisons, avec le nouveau roman, etc.
J’ai toujours aimé follement cela. L’idée que le roman est capable de donner une dignité, une forme de vérité et d’avoir la bonne distance pour saisir quelque chose comme l’époque. Une part de mes romans essaient de faire ça, mais c’est un essai. On est jamais sûr de réussir. Il y a des œuvres narratives qui sont mauvaises parce qu’elles n’arrivent pas à saisir leur époque, parce qu’elles sont trop saisies par l’époque. Il y a une différence entre être saisi par son époque (subir les modes, les tics de langages) et arriver à saisir l’époque (sans être en surplomb, sans être méprisant) : juste assez dégagé de l’époque pour la voir et donner à voir et à sentir ses liens secrets entre le langage, la pensée, la manière dont on aime, la manière dont on vie, qui font qu’on voit surgir quelque chose comme une époque. Je suis assez attaché à ça.
L.-A. B. — La poésie permet cela aussi, non ? Si je prends « notre héritage n’est précédé d’aucun testament » (de René Char), même si effectivement il y a peu de couleur et de descriptions de choses matérielles, il y a tout de même une « idée » qui, sans vouloir résumer complètement l’époque, appartient quand même à celle-ci et dit quelque chose de celle-ci.
Vous croyez que la poésie a continué à endosser ce rôle ? Je connais assez mal en fait ce qui s’est fait après les années 60 en poésie, ce n’est pas quelque chose que j’ai vraiment trouvé dans la poésie française… après je me trompe peut-être.
Quelqu’un comme Philippe Beck aujourd’hui ne me semble pas rechercher l’époque. Sa part mallarméenne fait qu’il me semble plutôt être du côté de ceux qui cherchent, au contraire, ce qui échappe au temps et ce qui va être de l’éternel, du marbre. Mais peut-être.
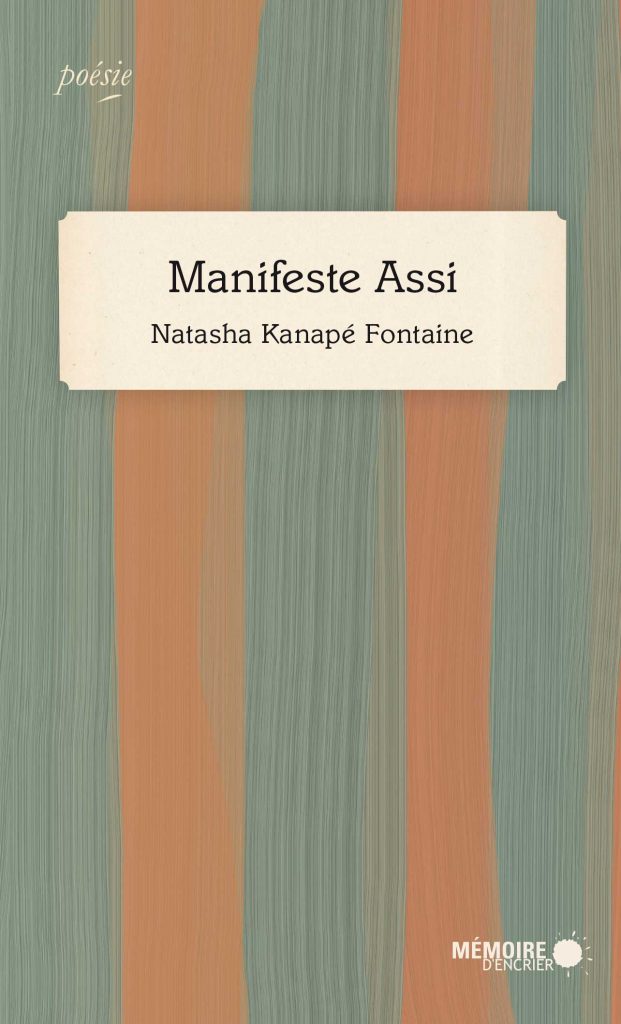
L.-A. B. — Sans parler forcément de langue française. Je pense par exemple à la poésie québécoise et au livre de Natasha Kanapé Fontaine, Manifeste Assi, qui signifie Terre en langue Innu. Il tente de décrire la relation avec la terre et la nature et semble ancrée dans cette l’extension du nous avec l’écologie sombre.
Là aussi je connais mal, il m’a semblé que dans la deuxième moitié du vingtième siècle la poésie arrivait à endosser ce rôle souvent dans les langues mineures. Quand il y avait quelque chose de la langue à défendre. C’était souvent lié, de ce fait, à des mouvements nationalistes ou régionalistes. Des petites choses que je connais, je sais par exemple qu’en Irlande il est resté une culture poétique très forte. Quand vous allez dans une librairie irlandaise, vous avez un rayon de poésie contemporaine très important qui est très militant. Est-ce que ce n’est pas lié ? Puisque vous parliez du Québec, la langue y a une fonction politique.
Mais on ne sait pas très bien quelle a été la fonction politique du français, qui n’a jamais su s’il était une langue dominante ou une langue dominée après la Seconde Guerre mondiale. La conscience qu’a le français de lui-même est étrange. Sur cette question de la francophonie il y a une étude qui m’a beaucoup troublée qui tend à montrer que vers 2070 le français devrait être la première langue parlée au monde.
Ce qui nous semble très bizarre puisque nous ressentons notre langue comme une langue minoritaire par rapport à l’anglais ou à l’espagnol (NDA Alors qu’il y a 274 millions de locuteurs estimés répartis sur les cinq continents, selon l’organisation internationale de la francophonie, source. Ces chiffres placent la langue française, selon les modèles statistiques utilisés, au neuvième ou douzième rang des langues les plus parlées au monde. Le français est, après l’anglais, la deuxième langue écrite dans le monde et la deuxième langue enseignée.) Elle dépasserait même le mandarin.
La question de la langue française, et notamment dans la poésie française, est de savoir quoi faire avec la langue : faut-il se retirer ? Réfléchir sur la langue elle-même ? Faut-il encore l’utiliser pour aller dire le monde ? Il y a une sorte d’indécision dans toute une part du vingtième siècle où beaucoup de poètes et d’écrivains français ne savent pas très bien quel est le statut politique du français. Est-ce qu’il faut par exemple défendre le français contre l’anglais avec le risque d’avoir une position réactionnaire ? Politiquement cela sonnait bizarrement. Un thème à abandonner à la droite ou aux réactionnaires, un thème identitaire.
Est-ce qu’il faut inventer autre chose ? Je pense à l’œuvre de Guyotat. Est-ce qu’il faut descendre, faire une sorte de catabase dans la langue française ? Et la manière dont Guyotat de manière folle dans les années 80, essaie non pas d’inventer une langue comme on le croit souvent, mais d’aller rechercher et de retrouver une sorte de puissance originelle du français libéré des contraintes de la domination du français comme langue colonial, comme langue de la domination, des femmes, des colonisés… (il étudie Rabelais, et se redirige vers l’ancien français.)
 Pour la poésie je ne sais pas, mais c’est une question que je me suis posée sur le seul livre que j’ai écrit où la langue était la question centrale, qui est les Mémoires de la Jungle. Pour le reste c’est peut-être un défaut, mais j’ai eu tendance à mettre cette question de côté.
Pour la poésie je ne sais pas, mais c’est une question que je me suis posée sur le seul livre que j’ai écrit où la langue était la question centrale, qui est les Mémoires de la Jungle. Pour le reste c’est peut-être un défaut, mais j’ai eu tendance à mettre cette question de côté.
C’est pourtant une question qui me hante, le rapport même à la langue française. En passant un an aux États-Unis, je me souviens d’un sentiment très troublant où il devenait très facile d’écrire de la philosophie. J’arrivais même à l’écrire en anglais avec un horizon de réception. Quand vous allez dans les pays anglo-saxons, il y a un horizon d’attente sur la pensée française, Alain Badiou, Jacques Rancière, sont très bien accueillis et très traduit. Il y a un a priori favorable, par contre vous sentez que la littérature française, passez Houellebecq, même les intellectuels New Yorkais ou d’Asie ne connaissent pas bien. Ils sont restés à une image ancienne. Houellebecq marche bien parce qu’il vient remplir l’horizon d’attente Balzacien, en un sens… la littérature française va être une sorte de reformulation du roman Balzacien.
J’étais troublé de ne pouvoir réussir à écrire de la fiction, en étant hors de France, avec l’impression que la langue ne comptait pas, que la théorie était possible, qu’il y avait un idéal de pensée française, mais que la fiction ne marchait pas. Alors la poésie… encore moins. Même pour des intellectuels américains, je ne suis pas sûr que Bonnefoy leur dise quelque chose.
C’est très étrange… les derniers qui sont passés en langue française pour les Américains, ce sont les auteurs coloniaux et postcoloniaux. Édouard Glissant, très nettement, par exemple. Toute la part de la langue française qui a été travaillée par la question coloniale et postcoloniale. Les Anglo-saxons reçoivent même quelqu’un comme Saint-John Perse comme un poète postcolonial ! (Rires)
La question politique de la langue française, puisqu’on parle de poésie, m’a hanté, notamment dans la relation avec la théorie. J’avais la sensation que c’était fluide, je pouvais écrire en anglais ou en français sans différence, mais la question du français sur le roman me revient régulièrement même si cela n’apparait pas dans les livres. Souvent je m’interroge. Pourquoi écrire de la fiction en français ?
Surtout que la majorité de mes références n’appartiennent pas nécessairement à l’histoire de la littérature française.
L.-A. B — Comparé à l’anglais, sur la notion poétique, la langue française a quand même moins de facilité à augmenter son vocabulaire et à créer des mots. Il y a cette dimension de l’indicible où l’on doit trouver des moyens de s’exprimer sans créer un nouveau vocabulaire, donc en passant par un détour. Il y a tout un intérêt à cela. Revenir sur chacun des mots pour les libérer, leur donner un sens actuel qui nous parle maintenant. Le français, il me semble, est intéressant pour ceci. Justement parce que notre vocabulaire est relativement faible.
Oui, sur la création des mots vous avez raison. C’est sans doute un acte beaucoup plus populaire dans d’autres langues, y compris en anglais. En français, dès qu’il y a ce type de travail, cela appartient très vite à la littérature expérimentale. Je citais Guyotat, mais c’est aussi présent chez Michault, et aujourd’hui chez Novarina par exemple. Adolescent, ma référence la plus marquante était Joyce. J’aimais Joyce, mais pas comme un postmoderne.

James Joyce
Le fait d’avoir été en Irlande m’a fait découvrir une espèce de miracle incroyable qui est que Joyce est poète populaire. Si vous êtes allé en Irlande, vous le savez sans doute. Le rapport aux chansons, aux comptines de Joyce font que presque n’importe qui dans la rue à Dublin peut vous citer de mémoire un de ses textes. J’aimais beaucoup cette idée, tandis que chez nous Joyce était tel quel, une lecture de Solerse, Dérida, la postmodernité, alors qu’en fait c’est un écrivain populaire ! C’est un écrivain national et nationaliste, qui disait la conscience irlandaise.
La création de la langue et le rapport ludique de la langue chez Joyce n’étaient pas du tout un rapport savant, mais un rapport très populaire. Joyce étant très marqué par la lutte pour l’indépendance de l’Irlande, il avait une conscience politique évidemment. En français, c’est plus compliqué. Le rapport à la langue est plus guindé. Il y a des gens qui ont trouvé un exutoire dans le hip-hop français avec l’impression que le jeu sur les mots permettait de renouer avec une langue populaire et en même temps d’être ludique, de jouer, d’inventer les mots. Je n’ai pas réussi à avoir de l’empathie pour le hip-hop français parce que j’aimais d’abord le hip hip américain, je n’ai pas réussi à aimer la langue. Je n’ai jamais réussi à aimer Booba comme créateur de langue… j’ai toujours trouvé ça trop faible, mais il y a surement des gens qui ont réussi ! Et que je ne connais pas. Tout comme il y a des écrivains qui ont trouvé une forme populaire de rapport réflexif et ludique à la langue française, mais ce n’était pas mon cas.
Voyez le livre Mémoires de la jungle, un de mes pires souvenirs de critique c’est d’être allé dans une émission, il me semble que c’était sur France Culture, et le journaliste avait immédiatement dit : « Mais ce livre, c’est un livre vraiment raciste. Vous parlez d’un singe mais votre singe, c’est un rappeur ! La manière dont il parle. » C’était très très dur d’arriver à expliquer qu’un singe était un singe et que non, le livre n’est pas raciste… et je n’arrivais pas à m’en dépêtrer car pour lui sa lecture était évidente ! « Jungle égale banlieue. Donc vous voulez parlez des jeunes de banlieue. » Le livre n’était pas du tout compris… c’est un livre, avec une jungle.
.
Fin de la première partie.
*
Pour lire la 2e partie de la rencontre : Entrevue avec Tristan Garcia — 2e partie.







