 Pour la troisième partie de cet entretien, les étudiants du master création littéraire se penchent plus en profondeur sur Faber : le destructeur et l’écriture de son auteur.
Pour la troisième partie de cet entretien, les étudiants du master création littéraire se penchent plus en profondeur sur Faber : le destructeur et l’écriture de son auteur.
Comme souvent chez Garcia, ce roman à idée (ou roman-concept) part d’un postulat sur lequel va se développer le récit. Procédé habituel pour cet écrivain qui aime lier philosophie et aventure. « Et si le temps s’arrêtait ? » : et vous obtenez Les cordelettes de Browser, où les hommes restant sont condamnés à l’éternel présent que l’ont peut manipuler en démêlant en quelques cordelettes.
Pour Faber, qu’en est-il de ce héros nihiliste quittant l’enfance ? Je vous laisse le découvrir…
*
*
Faber : le destructeur
«Nous étions des enfants de la classe moyenne d’un pays moyen d’Occident, deux générations après une guerre gagnée, une génération après une révolution ratée. Nous n’étions ni pauvres ni riches, nous ne regrettions pas l’aristocratie, nous ne rêvions d’aucune utopie et la démocratie nous était devenue égale. Nous avions été éduqués et formés par les livres, les films, les chansons – par la promesse de devenir des individus. Je crois que nous étions en droit d’attendre une vie différente. Mais pour gagner de quoi vivre comme tout le monde, une fois adultes, nous avons compris qu’il ne serait jamais question que de prendre la file et de travailler.»
Pierre Renier, Louis-Alexandre Borrel et Jonathan Trampon, étudiants en création littéraire et en philosophie, continuent d’animer l’entretien avec l’auteur.
Pour relire la 1re ou la 2e partie de la rencontre, il vous suffit de cliquer ici ou là.
Conversation avec Tristan Garcia — 3e partie
Sommaire
Sur l’esprit du temps
1. Faber : une parabole du personnage
2. les incartades de l’écriture
3. des ruses d’écrivain
4. romans-concept
5. le héros et le roman d’aventure
6. nécessité d’agir et inconscience
7. une conscience en négatif
Entretien
Pierre Renier — Il y a un passage dans le roman Faber qui parle de manière détournée du personnage qui porte ce nom. On se rend compte au fur et à mesure du roman que Faber, qui était d’abord adoré de tous durant sa scolarité, comme quelqu’un d’extrêmement juste et de bon, de très populaire, fini par s’enfuir et devenir une sorte de marginal démoniaque, de surhomme déchu, tels les démons dont il est question. D’autre part, ce passage peut-être lu de manière totalement détachée du reste du récit.
Ces petites histoires intégrées dans vos récits sont assez courantes et elles ont une ambiance et une réflexion à part.
J’en arrive finalement à la question qui est de l’ordre de la cuisine de l’écrivain. On sait finalement assez peu de chose sûr comment Tristan Garcia écrit. Quelle est là genèse de ce passage qui est très documenté ?
Tristan Garcia — Aussi loin que je m’en souvienne, ça vient d’une idée qui m’avait frappé chez Nerval et que j’aime beaucoup. Il est obsédé toute sa vie, jusqu’au moment de sa folie, par une idée que je trouvais très belle adolescent, selon laquelle le monothéisme est l’histoire d’une usurpation. Nerval a une sorte de moment, je crois que c’est à Naples, où il voit une apparition féminine qui lui semble être un mélange de sa mère et de la Déesse mère d’Isis… il y a toute cette idée chez lui qui est que l’histoire de l’humanité est maudite parce qu’on a préféré des Dieux masculins, qu’on a préféré le patriarcat, les Dieux du monothéisme aux Déesses féminines qu’il chérit.
Je trouvais qu’il y avait une intuition très belle qui m’a longtemps suivi et qui est déjà présente chez Nerval. C’est probablement une idée romantique, selon laquelle — et elle rejoint un problème que j’ai sur le roman — qui est : que deviennent les perdants de l’histoire ?
Chaque fois que j’ai lu, par curiosité, de la démonologie (et je n’ai jamais eut de fascination particulière pour Belzebuth ou pour Satan), il n’y a pas de démon qui n’ait d’abord été un Dieu. Systématiquement. Évidemment, s’incarne ensuite dans la figure romantique, notamment dans le Paradis perdu de Milton, l’idée selon laquelle le Diable était d’abord Lucifer, qui était d’abord l’ange préféré de Dieu. La figure romantique vient de l’esthétisation du Diable.
Comme souvent dans mes romans ces passages de philosophie, un peu dérisoires, sont mis entre parenthèses (ce sont souvent des passages racontés par la bouche d’un personnage assez peu crédible). Ce sont des parties qui me viennent de mon autre rapport à l’écriture. La majorité de mon temps, du fait de mon rapport à la philosophie, mais pas avec les portes de toilettes ou avec le type aviné au bar. Et pourtant au fond, il y a quelque chose en moi qui crois que c’est peut-être plus vrai. Dans le passage qui vous aviez lu à Lagrasse (lors des lectures finales de 2015), il y a cette idée qu’il doit y avoir une forme de vérité dans les graffitis qu’il y a dans les chiottes… parce que tout le monde les lits ! Alors que les livres, tout le monde ne les lits pas. Il y a une forme d’universalité. C’est une vieille idée. Je me souviens lire un livre adolescent : c’était un livre de photos. Quelqu’un de la deuxième génération du surréalisme, qui allait chercher les graffitis dans les rues. C’était cette croyance qu’il y avait peut-être une vérité dans les messages écrits comme ça, sur les murs de Paris, à partir des affiches décollées.
J’y suis très attaché car ça me semble indéfendable. Mais j’y crois profondément sur le mode de la fiction insérée dans le roman. Comme une sorte de philosophie spontanée. Le fait d’écouter des gens qui développent des théories, la manière dont une forme de vérité peut surgir dans le raisonnement à partir du faux. J’adore cette idée ! Avec les prémisses les plus folles comme dans 7 et ce passage dans la nouvelle qui s’appelle L’existence des extra-terrestres. C’est quelque chose de l’humanité que j’aime énormément. La capacité à raisonner de manière rigoureuse à partir de prémisses délirantes. C’est très beau ! (Rires) L’esprit humain qui échafaude des constructions rationnelles à partir du dérisoire, du faux et du délire.
Sur ce passage en particulier de Faber, vous avez raison, et peut-être même de façon trop marquée, c’est une parabole du destin du personnage. Je crois à une forme de correspondance, dans toute l’histoire de l’humanité, le destin des démons qui sont des dieux déchus, au niveau strictement individuel, le rapport qu’on a tous à des croyances de jeunesse ou à des idoles de jeunesses, dont Faber est l’archétype. C’est celui en qui on a cru dans la cour de récréation. On répète dans la vie ce que l’humanité fait en général : elle humilie ses croyances de jeunesse. Qui n’a pas dans sa vie humiliée celui en qui il a cru follement ? C’est à la foi nécessaire mais je trouve cela profondément injuste.
J’aime bien aussi l’idée que le roman est une forme qui vienne recueillir les déchus et les perdants de l’histoire. Les démons — mais pas les démons grandioses. Ceux qui sont dérisoires, à l’échelle individuelle.
Sur l’écriture elle-même, je ne sais pas exactement comment j’écris…
P. R. — C’était un texte prévu dans le plan du roman, dès le début ou est-ce venu spontanément ?
C’est par curiosité mal maîtrisée. J’adore l’idée que le roman est aussi un outil de connaissance. J’adore apprendre des choses en écrivant un roman ! Parfois je me laisse embarquer par ça, et c’est un défaut. Je suis à peu près sûr pour se passage que je devais être à la bibliothèque avec un plan en train d’écrire et que d’un seul coup, tombé sur un volume de démonologie qui m’a fasciné, j’ai pris des notes et vu mon texte gonfler. Jusqu’à avoir 4 pages de digression et devoir couper un peu… J’aime follement ça ! Il y a une forme de connaissance totalement libre. Je ne connais pas grand-chose en chimie, mais regardez la première nouvelle de 7. Il y a une part de chimie dedans qui est liée à un moment de passion : j’ai dû passer une semaine à me passionner complètement pour des chimistes américains un peu fous qui essaient de produire des formules pour des psychotropes qui n’existent pas encore ! (Rires)
C’est aussi pour moi une manière de lutter contre la division du travail dans la connaissance. L’idée selon laquelle il faut choisir sa discipline. Le roman a cette force incroyable et géniale qui est qu’il reste un outil de connaissance du monde où vous êtes parfaitement libre de vouloir apprendre quelque chose, connaître quelque chose, grâce à votre roman : n’importe quoi ! De la physique quantique à la plongée dans la pornographie du darknet. Le roman permet de tenir une connaissance universelle non systématique et erratique. On est juste liés à la curiosité du moment.
L.-A. B. — Tu te laisses donc prendre par ce livre sur lequel tu tombes, par un personnage, quelque chose qui n’était pas prévu et qui t’amène vers autre chose.
Oui, ce qui est un problème. Évidemment, ça crée une tension entre le projet et l’espoir de structurer ce qu’on écrit avec la logique du coq-à-l’âne et de la découverte. Il faut lutter un peu contre ça. Dans Mémoires de la jungle il y avait un moment qui était aussi un prétexte. Ça me passionnait de lire des articles scientifiques américains sur la cognition des chimpanzés.
Voyez, pour prendre un exemple, ce livre a semblé à beaucoup de gens très fantaisiste, dans la langue, dans le contexte. Pourtant, chacun des choix stylistiques était lié à un article scientifique que j’avais lu. Le personnage de Doogie, le personnage principal, a un problème de rapport au temps. Quand il en parle, il des choses comme : « Quand tant de jours sont tombés du calendrier » ou « tant d’heures sont tombées du sablier », cela vient de ma fascination pour un article hyper technique sur la cognition des chimpanzés et leur rapport au temps. Des expériences ont montré qu’ils avaient une conscience très très faible du passage du temps, mais qu’on arrivait à leur faire transformer le temps en espace. Si on arrive à trouver des ruses pour le figurer en espace, alors ils y parviennent ! Un scientifique a passé dix ans avec trois générations de chimpanzé et un sablier à les étudier ! C’est devenu un tour stylistique, puisque c’est que quelque chose qui revient dans le livre.
Un deuxième exemple absurde, je pense que personne ne l’a vu dans le roman : en un sens, ça n’en a pas. Mais ça m’a passionné à l’époque ! Un article parlait de la différence de vocalisation entre le chimpanzé et les bonobos, ils sont très proches, et physiologiquement il est très dur de les reconnaître. On peut les différencier par leurs mœurs sexuelles, leurs mœurs politiques et part une forme de vocalisation. Les bonobos ont tendance à plutôt vocaliser en « e » et en « i » alors que les chimpanzés vont plutôt vocaliser en « a » et en « o ». Et dans le passage où Doogie rencontre des bonobos, je me souviens passer un temps infini à essayer de choisir mes voyelles ! Pour faire en sorte que les dix pages chez les bonobos soient vocalisées très majoritairement en « e » et en « i » ! Ça n’a aucun sens ! (Rires) C’est une construction… mais le roman est aussi le lieu où on met ses névroses.
Je crois que quand on écrit, on invente des ruses pour essayer de transformer la contingence en nécessité. Le problème c’est que lorsqu’on écrit, on est confronté à la contingence, à la possibilité de raconter ça ou ça. Il faut toujours affronter le « ça pourrait être autrement ». À chaque ligne. Le but c’est de s’inventer des ruses pour lui donner une apparence de nécessité. Pour soi-même, rendre nécessaire ce qu’on écrit. Ce sont des ruses névrotiques.
L.-A. B. — En lisant tes romans, j’ai l’impression que tu pars en général d’une idée : dans Faber j’y ai perçu une figure d’un héros nihiliste.
En effet, beaucoup des romans que j’ai écrits peuvent apparaître comme des romans d’idées. Mais au départ, ce que j’ai c’est une image. La difficulté vient que j’ai une image instantanée, comme un tableau, qui est parfaitement claire. C’est très agréable. C’est un moment d’intuition, un peu mégalomane, où on a l’impression de tout avoir. Le problème, c’est qu’elle est instantanée… la difficulté est évidemment de le transformer en quelque chose de discursif. Il y a toujours un sentiment de perte ou de deuil de l’image qui m’a marqué et qui m’a fait faire le livre. C’est une sorte de chute dans le temps. Je voyais quelque chose qui me semblait très clair sous une forme intuitive. Mais ensuite il faut le raconter et j’ai toujours l’impression de perdre l’évidence de l’image. À partir du moment où l’on raconte, il faut plonger dans le temps. Il y a une déchéance de l’image dans le récit.
Intimement, mes romans sont d’abord une image.
J’aurais du mal à la décrire, mais ça se présente ainsi. D’ailleurs avant d’écrire, je dessine souvent : je fais des croquis pour chacun des textes. À la fois des dessins, des cartes, des plans. C’est de l’ordre du visuel.
L.-A. B. — En parallèle, il y a de plus en plus de héros et de films tournés sur des héros. Que pourrait-on dire, maintenant, du héros et de l’antihéros ? Si on a envie de faire passer des idées de l’esprit du temps, est-ce qu’une figure d’importance comme celle-ci peut permettre cela ?
J’ai une sorte de méfiance instinctive vers le long moment de complaisance qu’on a vécu à l’égard des antihéros, que ce soit en littérature ou dans toutes les formes de récit : le cinéma, les séries télévisées, etc. Je continue à penser qu’il y a une forme de facilité dans l’antihéros. C’est un moyen de conserver la fonction du héros et en même temps de dire qu’on y touche sans y toucher. Il y a quelque chose qui ne me plait pas. J’aimerais aller vers l’idéal, me débarrasser du soupçon, même si je ne suis pas sûr d’y arriver. J’aimerais affronter la question du héros de manière frontale et naïve en enlevant ses arrières pensés, mais ces arrières pensés, je les ai aussi… Mes héros ne sont souvent pas franchement des héros. C’est un problème. Le personnage qui se rapproche le plus d’un héros dans mes romans, c’est le singe : c’est Doogie. C’est celui auquel je me suis le plus identifié. Pour plein de raisons. Je vais encore faire un léger détour…
Mémoires de la jungle vient d’un désir enfantin qui est mon amour fou pour le roman d’aventure. Or, le roman d’aventure je l’aimais enfant. Et puis, en grandissant, pour des raisons politiques — j’ai lu des critiques du roman d’aventures et notamment des critiques postcoloniales— j’ai appris à le nuancer. J’ai fini par comprendre que ces romans que j’aimais, Conrad, etc., c’était quand même un imaginaire colonial. Le problème de l’aventure c’est que si vous avez un héros d’aventure et que votre imaginaire, à la Jules Vernes, Stevenson, Walter Scott, London (c’est un peu à part), le héros en général reste un homme blanc qui arrive sur un territoire qui apparaît comme vierge, qui le découvre, éventuellement lie des liens d’amitiés avec les indigènes, mais ont fait comme si ceux qui étaient déjà là, n’étaient pas là ! Le problème de l’aventure c’est que c’est la découverte de territoires où il y a déjà des hommes. Sur le long du Mékong, il y a déjà des hommes qui y vivent.
Si on a une sorte de conscience moderne, on se rend compte qu’il y a quand même quelque chose d’un peu bizarre dans le fait d’identifier le héros au mâle blanc qui découvre un univers. Même dans la science-fiction, quand il s’agit de découvrir la Lune, de Mars, et de planter un drapeau. Cet héroïsme, j’y ai senti une contradiction entre mon désir d’enfant, mon désir d’aventure, et une impasse : à chaque fois, le héros était indéfendable politiquement. J’avais du mal à voir encore de l’héroïsme. Il y a plein de gens qui ont fait des relectures postcoloniales de Conrad, on sait bien que chez lui, que chez Melville, il y a un imaginaire en grande partie raciste, c’est très compliqué. Comment être fidèle à votre désir d’enfant d’envoyer un héros dans la jungle et de découvrir un territoire vierge tout en ayant votre conscience d’adulte éveillée au fait que celui qui découvre la forêt, c’est l’avant-garde de celui qui va aller massacrer tous les indigènes pour y établir une colonie…?
Dans Mémoires de la jungle, de manière inconsciente, je pense que j’ai essayé de retrouver un moyen de conserver l’imaginaire de l’aventure et d’avoir un héros qui ne pouvait pas être suspecté d’être un colonisateur. Ce n’est même pas un être humain ! C’était vraiment la victime absolue, c’est le singe lui-même. C’est ce que j’ai fait, j’ai donné une forme de conscience au singe pour qu’il puisse encore être un héros.
Tout ce que je fais est une manière de négocier, tant bien que mal, entre des désirs enfantins d’aventures, de récits, de merveilleux, et une conscience adulte de la domination, du temps. Ce n’est pas si simple. Il faut louvoyer.
Ces deux aspects sont aussi présent dans Faber. Il pourrait être un héros, comme dans ce que j’aimais follement dans la littérature jeunesse. Celui qui marche devant, qui mène une investigation, un trio d’enquêteur adolescent, mais il y a la conscience adulte qui fait que je n’arrive pas à y croire tout à fait. Souvent le roman est pour moi est une sorte un champ de bataille autour du héros. J’aurai le désir de produire un héros franc et absolu, mais une forme de conscience m’en empêche. Des choses très bêtes par exemple, j’ai l’impression de souvent rater mes personnages féminins. Le héros finalement est à chaque fois un homme, pourquoi est-ce que je reproduis-je ça ? Ma conscience critique qui vient ronger mon désir de récit pur et naïf.
Le héros est le personnage où se négocie se débat là. J’ai une volonté de croire à l’héroïsme tout de même.
J. T. — Il y a aussi l’idée du sacrifice. On peut avoir un sacrifice sans héroïsme et un héros sans sacrifice.
Souvent il y a l’idée qu’il peut y avoir un héros, mais qu’il y a un prix à payer. Y compris pour le singe d’ailleurs. Ça donne souvent une forme tragique au livre.
L.-A. B. — Tes personnages sont quand même assez souvent désabusés il me semble… Dans les toutes premières pages de Mémoires de la jungle, Doogie dit qu’il y a déjà une défaite dans le fait d’être confronté au langage humain. Liz, dans La meilleure part des hommes, l’est aussi… J’ai l’impression qu’ils vivent par défaut.
En général, les voix romanesques se retrouvent être le lieu de conflit entre une ultra lucidité qui va vert l’abattement, la défaite, ou en tout cas l’incapacité à agir. Je parlais de Conrad, il se trouve que j’ai été très marqué par son roman Victoire. Il y a un personnage d’origine suédoise, Axel Heyst, un des grands héros Conradien un peu comme Lord Jim, qui m’a fait forte impression. Il a été éduqué par un père qui était fasciné par la philosophie de Schopenhauer et qui lui a dit : « Plus tu seras intelligent, plus tu seras conscient et plus tu comprendras que faire un acte, c’est ajouter du mal dans le monde. » Il a enseigné à son fils une sagesse d’impuissance. Axel Heyst d’ailleurs se retrouve à un moment dans le roman coincé sur une île d’Indonésie où il est tout seul et il essaie, presque littéralement, de ne pas bouger, de ne pas agir. Il a conscience que le moindre geste produit une avalanche de mal. À un moment passe à proximité de l’île une sorte de cirque itinérant qui va introduire une très belle histoire d’amour. Il y a une jeune danseuse qui est visiblement exploitée et il n’arrive pas à se retenir et décide de la sauver. Et le fait de la sauver produit un enchainement de catastrophes affreuses.
Il y a souvent chez Conrad une sorte de combat entre une forme supérieure de conscience et de lucidité, mais qui produit une impuissance complète, et l’action qui est source de désastre. C’est un dilemme tragique ! Je suppose qu’un peu malgré moi, dans mes voies romanesques, il y a de ça. Mes personnages sont pris entre une forme de lucidité et de conscience, qui est souvent leur statut de narrateur, où ils racontent les choses sans trop y participer, telle Lyz, mais qui les condamne à être des demi-acteurs, comme Basil dans Faber, ayant juste un pied dans le monde de l’action. Ceux qui agissent, eux, sont inconscients. Le personnage de Doogie est aussi prit dedans. Il a sa conscience entre sa nature même d’animal et la nécessité d’agir, qui produit quelque chose de bête, d’animal.
L.-A. B. — C’est l’exemple de ce personnage dans la partie « Hémisphère » de 7, qui sauve cette jeune fille. On sent qu’il y a déjà des conséquences des actions : est-ce qu’il fallait le sauver ? Est-ce qu’il fallait le sortir ? C’est un personnage Conradien.
C’est un peu la forme Conradienne, c’est vrai. C’est un dilemme qui revient souvent pour moi. Est-il possible de sauver quelqu’un contre son gré ? Il y a cette phrase chez Rousseau où il dit dans Le second discours : « Et s’ils ne veulent pas on les forcera d’être libres. » C’est une question qui me hante : c’est une question politique. Peut-on forcer quelqu’un à être libre ? Les questions qui tournent autour du voile aujourd’hui portent là-dessus. Dans quelles mesures vous pouvez décider que quelqu’un n’est pas libre et dans quelles mesures vous pouvez ensuite agir en prétendant agir au nom de la liberté de quelqu’un contre ce quelqu’un et sa volonté ? Agir contre la volonté de quelqu’un… Ça revient souvent chez mes personnages.
Le romanesque est souvent un lieu où peuvent se négocier ses dilemmes. Je n’ai pas de solution, ça s’incarne dans des personnages ou des situations romanesques. Probablement qu’il y a une part du dilemme, souvent sombre ou tragique, dans ce que je fais, et qu’au fond le prix à payer pour la conscience, c’est l’impuissance. Les personnages conscients, comme le dealer au début d’Hémisphère, sont toujours les narrateurs qui ont renoncé à agir. Il a raison, il sait, il est conscient et lucide. Mais la lucidité produit une forme d’impuissance. Et le récit ne commence que si quelqu’un agit. Il faut que quelqu’un sorte de la conscience ou de la lucidité et fasse quelque chose. Tout acte est fait contre la conscience ou la lucidité.
J. T. — Est-ce qu’il n’y a pas une forme d’héroïsme dans cette reconnaissance du statuquo et de son impuissance ? Je ne vais pas forcément faire le lien avec ce que tu appelles la rémission, même si on pourrait en parler, mais cela fait penser à ce qu’il y a en ce moment dans le mouvement Nuit Debout. « Nous ne revendiquons rien » ou de même, pour le Comité Invisible : « Ils veulent nous forcer à gouverner, nous ne céderons pas à la tentation. »
Acceptons le statuquo : je suis et je ne fais rien. Mais le fait de ne rien faire c’est ce qui permet que quelque chose se passe.
En effet, c’est une tentation de la conscience de résister par le négatif. Au fond, il m’a semblé que dès que j’ai commencé à écrire des romans, j’ai écrits contre ça justement. J’ai écrit avec l’impression qu’à un moment il valait mieux écrire et produire une forme d’action qui était naïve que de vieillir avec cette espèce de conscience négative qui me hantait et dont Faber est une sorte de démon.
J’ai préféré essayer d’avoir tort et de me tromper, de faire quelque chose d’imparfait et de naïf.
La meilleure part des hommes, le premier roman que j’ai publié, je l’ai fait en ayant conscience de l’extrême imperfection du livre. De quelque chose qui ne me satisfaisait pas. Mais si je ne le faisais pas à ce moment-là, j’allais vieillir avec un sentiment d’avoir une sorte de conscience tragique, dégagée du monde, ayant toujours raison, mais d’une impuissance totale.
Je ne pourrais pas vieillir et grandir avec l’impression d’une disjonction où la conscience d’avoir raison grandit démesurément à mesure du néant que l’on produit ! L’immensité et l’infini de votre conscience et le négligeable de ce que vous faites est à un moment éthiquement intenable. À moins de devenir très amer ou d’abandonner, de faire toute autre chose. Mais je crois qu’il y a un moment dans une vie où ce n’est pas tenable. J’ai peur de ça, vraiment. L’écriture est un moyen d’en sortir, mais pas la philosophie car elle reste une sorte de conscience. Alors que dans l’écriture il y a le risque de faire quelque chose et d’affronter le positif.
.
Fin de la troisième partie.
*
Lire la dernière partie de la rencontre : Entrevue avec Tristan Garcia — 4e partie.
Pour relire les premières parties :
Entrevue avec Tristan Garcia — 1re partie.
Entrevue avec Tristan Garcia — 2e partie.
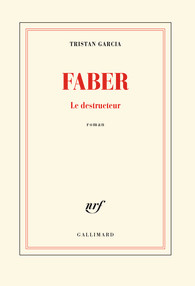
Tristan Garcia
Faber : le destructeur ~ Gallimard/Série Blanche
ISBN 9782070141531
480 pages
Prix Folio 8,20 euros
Prix public 21,50 euros
Date de parution : 22 aout 2013