Dans le cadre du 7e Festival International des Littératures Policières, organisé par l’association Toulouse Polar du Sud, qui s’est déroulé les 9, 10 et 11 octobre derniers, de nombreuses animations, des débats et des rencontres avec des auteurs étaient organisés.
Le Festival ne s’est pas seulement contenté de sa place sous le chapiteau, installé pour l’occasion à Basso-Cambo à la librairie de la Renaissance, il en a profité pour s’inviter hors les murs, dans divers lieux culturels de la ville.
Et c’est la librairie Ombres Blanches qui a inauguré le festival en accueillant Yves Ravey dans sa grande salle de conférence, le samedi 3 octobre, afin de présenter son nouveau roman : « Sans états d’âme », publié aux Éditions de Minuit.
La rencontre a été animée par Jean-Paul Vormus, président de Toulouse Polars du Sud, dans le cadre du festival.
Après quoi Yves Ravey a répondu aux questions du public.

Chapiteau Basso-Cambo
.
Mais d’abord, un petit résumé de l’éditeur :
Sans états d’âme :
John Lloyd disparaît une nuit sans laisser de trace. Stéphanie, son amie, va charger Gustave Leroy de mener l’enquête. C’est sans compter sur son dépit amoureux. Ni sur l’arrivée de Mike Lloyd qui entend bien retrouver son frère.
Si le roman vous intéresse, sachez juste que les 17 premières pages sont dévoilées dans la conversation qui suit, il y est question de l’intrigue du roman qui est divulguée sans états d’âme…
Mais celle-ci se révèle rapidement à la lecture et ne porte aucun préjudice au suspens du récit.
*
Conversation avec Yves Ravey
Sommaire
*
Entretien
Jean-Paul Vormus — Merci à vous, Yves Ravey, d’être avec nous ce soir. Je vais simplement préciser pour l’audience qui ne vous connaîtrait pas que vous avez écrit une vingtaine de romans, pratiquement tous édités aux Éditions de Minuits, et six pièces de théâtre. Aujourd’hui, nous allons parler de votre dernier livre : « Sans état d’âme », lui aussi édité aux Éditions de Minuit.
Je vais juste dire deux mots de l’intrigue sans en dévoiler trop, puisqu’il y a un fort suspens dans le livre. Le thème du roman, c’est Gustave, dit Gu’, qui est chauffeur routier et amoureux depuis sa plus tendre enfance de Stéphanie, elle-même amoureuse de Lloyd, un américain qui s’est perdu par là, dans le Doubs.
Problème : Lloyd a disparu et Stéphanie demande à Gu de partir à sa recherche. Je ne vous en dis pas plus, ce sont les quinze premières pages du récit qui ne dévoilent pas grand-chose de l’histoire.
Gu, le narrateur du récit, est un personnage comme on en trouve plusieurs dans vos romans précédents. Son père est mort, sa mère a sans doute Alzheimer et vit dans une maison de retraite, et il va être expulsé de son domicile puisque sa voisine, la mère de Stéphanie, a un grand projet immobilier en tête. Stéphanie, quant à elle, est amoureuse d’un autre homme.
Il a finalement beaucoup de problèmes ce Gu. C’est un peu un « perdant » comme un certain nombre de vos personnages. C’est le cas du cousin Freddy, par exemple, dans Un notaire peu ordinaire. Qu’est-ce qui vous attire dans ces personnages ?
Yves Ravey — Je pourrais dire de Gu que c’est un perdant. Dans ma tête, nous sommes tous des perdants. Avoir perdu son père, avoir sa mère qui est hospitalisée et être exproprié de sa maison, ce n’est pas quelque chose de rare. Ce n’est pas un cas exceptionnel. J’ai le sentiment que ce personnage puise dans une sorte de réalité, on va dire sociale mais ce n’est pas suffisant. C’est aussi une réalité affective, psychologique.
Comme vous venez de le dire, Gu est un chauffeur routier, mais il a une autre spécificité professionnelle. Il est chauffeur routier à l’international, comme on pourrait le dire d’un docteur ès lettres ou ès sciences. Il y a l’établissement d’une certaine hiérarchie.
Si on fouille, si on regarde dans le détail on observe qu’il y a plusieurs catégories de chauffeurs, entre le chauffeur-livreur, les chauffeurs grande distance ou courte distance… Ce n’est pas non plus n’importe quel chauffeur : j’entends par-là que lorsque les éléments de l’histoire se développent, c’est aussi un personnage qui a certaines qualités.
On ne devient pas n’importe comment chauffeur routier à l’international, surtout qu’il couvre en particulier les pays de l’Est. L’attirance pour le personnage est entre autres ici. Mais ce que je veux dire avant tout, c’est qu’il ne se finit pas parce qu’il serait dépossédé de ses moyens, bien qu’il le soit.
La plupart de vos personnages sont des gens qui, sans être pauvres, sont très loin d’être riches. Les personnes qui vous intéressent sont finalement des personnes dont on parle relativement peu dans les romans. Ils apparaissent souvent en opposition avec des classes sociales plus élevées. C’est le cas du notaire ou de la mère de Stéphanie qui a un grand projet immobilier. Est-ce un choix délibéré ?
Je ne me sentirais pas incapable de décrire des gens qui seraient peut-être fortunés, tout dépend de comment j’aborde les personnages et les situations. On ne peut pas affirmer comme ça que je sois attiré, mais ce sont des personnages qui à mon sens ont leur importance, du fait aussi de leurs conditions. Je ne me dis pas dès le départ que je vais aller vers eux.
Quand je commence à écrire un texte, il faut que je saisisse le personnage et je ne sais pas obligatoirement dans quelles conditions je vais le trouver au moment où je vais le croiser pour le retenir. C’est-à-dire à quel moment je vais savoir son identité de manière un peu plus poussée.

Yves Ravey et Jean-Paul Vormus à Ombres Blanches
Si je parle de tous les personnages que j’ai écrits, je crains qu’on puisse généraliser.
Si je prends uniquement celui-là, je pourrais dire que quand il est apparu, j’avais déjà écrit pendant cinq-six mois avec lui sans rien en tirer. Ça ne venait pas de lui, ça venait de moi. Il n’avait pas cette identité que je lui ai donnée. Je ne sais pas pourquoi. Et puis un jour, je l’ai senti dans un coin de mon esprit, tapis dans l’ombre et il s’est dégagé. Dès que je l’ai saisi, j’ai senti que je pouvais démarrer et qu’il fallait aller très vite.
Et donc, de manière radicale, chauffeur routier évoquait aussi ce camion. Son véhicule. Le véhicule, c’est un ailleurs, un au-delà. Quand je démarre, je ne sais pas ce que je vais faire, si je vais le suivre sur les routes (ce qui ne me désintéresserait pas, il part en direction de l’est. Ça ne me ferait rien d’aller en Hongrie, en Pologne, en République tchèque, et d’y croiser tout ce contexte-là), mais il s’est trouvé que je l’ai sédentarisé. C’est quand il était sédentaire que je l’ai senti. Il fallait qu’il se fixe, c’était une forme d’orgueil pour lui de montrer son permis. Voilà.
Comment vous y êtes-vous pris pour la construction du roman ? À la lecture du récit, on découvre une mécanique précise. S’est-elle bâtie toute seule en suivant le personnage ou bien s’est-elle construite différemment ?
Comme ça fait longtemps que j’ai le personnage en tête et que je n’ai rien écrit, ou plutôt que ce que j’ai écrit ne vaut rien, j’ai quand même des choses qui se sont agencées. Au moment où je développe le personnage, au moment où il va agir puisque c’est par lui que les choses se passent, je décide de mettre le récit à la première personne et d’utiliser le « je ». C’est le narrateur qui raconte l’histoire, qui fait l’histoire, et je me contente d’être dans sa peau.
J’ai compris que si je voulais le garder avec moi, il fallait que je m’introduise dans sa personne.
Ensuite, je le construis au jour le jour. Au départ, ce qui me convient à ce moment précis de l’histoire, c’est qu’il dit que la dernière fois qu’il a vu son père, il lui a présenté son permis de conduire. Les choses vont pouvoir se développer autour. Mais je ne sais pas encore comment. Je sais juste qu’il y a un américain qui doit arriver, je ne l’ai juste pas encore écrit. Je sais aussi que je suis intéressé dans le fait que Gu soit amoureux. C’est une ouverture dans le personnage, on dit parfois de lui dans les rencontres ou dans les critiques que c’est un amoureux transi.
Donc je sais que je peux partir de là et qu’il a une voisine. Pour la première fois, je considère que je peux construire ce personnage en relation avec son enfance, et avec la fille de la voisine. J’ai Stéphanie en perspective, la structure commence à prendre forme. J’écris au jour le jour, donc si je finis le lundi soir une première version, une heure/une heure et demie d’écriture, je ne travaille pas plus, je sais exactement ou reprendre le lendemain et ce qu’il va se produire. Je prends quelques notes entre les deux, sachant qu’il y a une nuit pour y penser.
 C’est très concret. Pourtant face à cette mécanique précise, avec chaque fois un détail qui joue son rôle et crée le suspens ou l’angoisse, on se représenterait presque votre travail à l’inverse, s’imaginant que l’intrigue a d’abord été créée puis que les personnages sont venus se poser dessus.
C’est très concret. Pourtant face à cette mécanique précise, avec chaque fois un détail qui joue son rôle et crée le suspens ou l’angoisse, on se représenterait presque votre travail à l’inverse, s’imaginant que l’intrigue a d’abord été créée puis que les personnages sont venus se poser dessus.
Non pas du tout. Et même, au bout de quinze, vingt, trente pages… je ne sais pas ce que je vais garder. Je n’ai aucun complexe par rapport à ça, j’évacue. Étant donné que je vais assez vite là-dessus, ça ne me gêne pas. Le principe c’est que lorsque j’accède à la fin éventuelle de l’histoire, les choses se sont agencées et j’ai pu trouver un évènement qui sera la fin, que je modifierais peut-être plus tard, mais que je considère comme le dénouement. J’ai devant moi une masse compacte de texte, comme je travaille à l’ordinateur les mots ne sont même pas séparés, il n’y a pas de ponctuation, rien. C’est un truc illisible. Illisible. C’est très difficile après de recommencer dessus, de le déchiffrer.
Personne d’autre ne peut le faire donc.
Non, il n’y a que moi. Ou alors un spécialiste de hiéroglyphes… En tout cas, voilà comment je travaille.
À propos de Gu amoureux transi, est-ce que finalement le livre ne serait pas un roman d’amour déguisé en polar ?
Alors, il y a « roman d’amour » et puis il y a le polar… Je sais que c’est dans le cadre du festival de Polar que je suis invité et je n’ai absolument pas refusé, car souvent, on me dit : « Alors, ça ne vous fait rien d’écrire comme si c’était des polars ? »
Moi, les bras m’en tombent ! En quoi est-ce un problème ? S’il y a une chose que je ne risque pas, c’est qu’on me dise « vous écrivez des bluettes ! » De belles histoires romantiques. Ça jamais personne ne me l’a dit. Mais le roman d’amour n’est pas exclu dans l’écriture et s’il y avait un festival des romans d’amours, j’irais.
Ça ne veut pas dire non plus que je vais partout où il y a un thème qui correspond, s’il y avait un festival des camions par exemple… Bon ! (Rires) Mais oui, cette relation amoureuse est présente. Après, comment elle se cultive, comment on l’exprime, comment on la raconte, c’est une difficulté.
Concernant l’aspect policier de vos récits, on remarque que vous utilisez beaucoup les codes du polar. Est-ce qu’il y a des auteurs qui vous ont influencé ?
Au moment où je travaille, je suis pris par tout ce que je rencontre. Je suis comme une éponge, je prends tout. Je peux faire évoluer mon intrigue en fonction d’une personne rencontrée dans la rue, d’une situation vécue mais aussi de ce que je lis, de ce que vois au cinéma ou à la télé. Je n’ai aucune hiérarchie là-dessus, je n’ai jamais eu la prétention de dire attention tu flirtes avec un mauvais genre, où ce genre de choses. Il y a des éléments où je sais que je ne veux pas aller, ça c’est clair. Mais je crois que j’absorbe tout et il y a effectivement la lecture, présente et passée, le cinéma – très important –, et puis les téléfilms, les séries, toutes ces choses-là.
Quand j’ai vu que ce n’était pas la peine que je parle de Chateaubriand et que je fasse référence à des textes académiques, quand j’ai compris cela, c’est vraiment très vite venu. J’avais besoin de littérature américaine. Ça m’a fait du bien. Quand j’ai démarré mon travail d’écriture j’étais chez Gallimard (La table des singes, Gallimard, 1989), et c’est vrai que la référence reste quand même une forme de littérature qui a avoir avec le classicisme, et j’avais besoin d’en sortir.
Même si Gu est le narrateur, il n’y a jamais de description de ses états d’âme. Ses actions sont décrites, ses paroles, mais on ne sait absolument jamais ce qu’il pense.  C’est le cas de tous vos personnages.
C’est le cas de tous vos personnages.
Il y a une école du roman policier, le béhaviorisme, mondialement reconnue pour s’être désintéressée de la psychologie de ses personnages.
En France, Jean Patrick Manchette, grand auteur de polar, s’est illustré dans ce domaine et en était le grand représentant. On trouve justement une proximité à ce niveau-là.
Oui… Cette histoire de comportement et des descriptions des actes, c’est tout un travail qui est lié à la façon dont on perçoit la réalité. Si j’ai une séquence avec deux ou trois personnages qui sont en relations, il se passe des choses entre eux. Je me demande : « Comment est-ce que je pourrais exprimer cela ? » C’est une question, j’ai envie de dire, de focale.
Je n’ai pas besoin de présenter la situation de manière classique et traditionnelle. Si par exemple on fait irruption dans un bar et puis qu’on se me met au comptoir et que l’on se tourne, automatiquement c’est parti. Il y a trois personnes qui sont là, elles connotent quelque chose. On essaie de comprendre, on devine, on pressent.
Je crois que c’est là où on a une saisie plus forte et plus immédiate de la réalité, de ce qui se produit autour de nous, plutôt que de chercher midi à quatorze heures. Ça me parait plus simple. Et puis quand je lis ça, dans une séquence ou dans un chapitre, je peux réduire la focale, me rapprocher d’eux.
Par exemple, quelqu’un qui discute et qui sort ses clefs de voiture pour jouer avec, elles ne sont peut-être pas de n’importe quelle marque et cela traduit une psychologie du personnage. Je n’ai pas besoin d’en rajouter. Voilà, je ne rajoute rien.
L’intérêt de vos livres, c’est que chaque détail a une signification. Et comme vos romans sont courts, on les remarque petit à petit, ils apportent encore une fois, une pierre au suspens.
Vous parliez de Manchette, personnellement je l’ai lu après qu’il soit devenu une référence. Mais je suis tombé dessus et c’est vrai que c’était impressionnant à lire. J’ai parfois tendance à faire référence aux films des années 40-50, plutôt américains, avec les imperméables et leurs codes, mais je veille. Je fais toujours attention à ne pas tomber dans le lieu commun ou dans la grosse référence. Je ne cherche pas à m’en éloigner, je crois aussi que c’est bien de ne pas se faire enfermer dans une catégorie.
Puisqu’on parle de cinéma, vos romans où les dialogues et les actions sont décrits de l’extérieur devraient intéresser les cinéastes. C’est quand même très visuel.
Oui, c’est vrai. Hier après-midi j’étais avec un cinéaste justement, qui me disait : « Tu traduis une atmosphère ». Au départ, il n’y a pas d’atmosphère. Il y a de l’écriture qui produit une forme d’atmosphère que chacun recueille comme il veut. Si je suis pas à pas mon personnage, bien entendu, il va s’en dégager une atmosphère. Si je dis que son activité c’est d’aller dans un bar, je stipule simplement que c’est un bar de nuit mais je ne vais pas plus loin. Je ne veux pas tomber dans l’excès. Je n’en fais pas une boite de strip-tease. Pourtant, pour en revenir au roman, Stéphanie travaille dans ce bar de nuit. Il y a une phrase que j’ai ôtée où je disais « quand elle a eu fini son numéro… » Mais ça n’allait plus, comme j’avais choisi de dire bar de nuit, j’étais sur la brèche. Je ne voulais pas en dire plus.
Effectivement, il y a une atmosphère qui s’en dégage. Mais ce n’est pas l’atmosphère d’un château du XIIIe visité par des spécialistes de l’histoire de l’art. Au cinéma, les productions sont extrêmement longues, lourdes, les critères à un moment donné dépassent le contenu du roman. C’est toute une affaire de production, d’argent, ce n’est pas si simple de porter des livres à l’écran. Mais il y a des gens qui s’y attèlent.
Vos romans se situent en général à la périphérie des villes ou dans des zones d’entre-deux, qui sont entre la grande ville et la campagne, comme des hôtels dans des zones industrielles ou des stations-service… Est-ce un choix de parler d’endroits qu’on trouve finalement assez peu dans les romans ?
Oui c’est un exercice qui me plait. Je n’ai pas le sentiment qu’on les trouve peu, mais ce n’est pas faux pour autant. Le fait est que je vais plutôt choisir une bourgade, une petite ville. Quand je cherche un lieu, je vais sur Google Earth et je cherche un trajet que je peux m’imaginer.
Dans mon roman précédent, il m’avait paru intéressant d’y mettre Montceau-les-Mines en Saône-et-Loire, j’ai même eu une journaliste de la ville qui m’a appelé pour me demander comment j’avais visité la ville… je n’ai pas osé lui dire que je n’y étais jamais allé !
Je me suffis du nom. Et j’aime mieux certains noms. Mais il y a aussi des quartiers de Los Angeles qui peuvent être très riche en contenu, je n’ai pas encore pu concevoir une intrigue qui s’y déroulerait, par exemple à Downtown, mais ce n’est pas impossible.
Tout part du nom. Je l’ai là, et je le transpose dans une sorte de no man’s land,
de bourgade en l’occurrence, où il y a un champ de maïs parce que j’ai voulu le mettre ici pour certaines raisons.
Je crois que c’est ce que j’ai appelé dans une précédente rencontre des marqueurs : c’est-à-dire qu’il y a dans toute ville, plutôt à la périphérie désormais, une station-service par exemple. Et cette station implique plein de choses : l’essence, les couleurs, les néons, les pompes, l’argent, ce qui y est vendu, etc. Tout ça, c’est important. C’est les fastfoods et toutes ces choses-là, et c’est vrai que ça m’intéresse. Mais c’est aussi parce que c’est en même temps plus simple d’écrire comme ça. J’essaie d’écrire des choses simples.
Le cimetière américain dans Sans état d’âme existe vraiment, lui.
Alors oui. Il y a un cimetière américain. Mon personnage central, que j’habite, est entraîné, destiné à commettre l’irréparable. Il le dit page 17, on ne va pas le cacher. Le problème après, entre la page 17 et la fin, c’est de savoir comment il va faire. C’est ça l’objet du livre. On n’est pas obligé de cacher son acte.
Je suis dans le cours de l’écriture et il se trouve qu’au moment où il assassine l’américain, puisque c’est l’américain qui prend, ça arrive… en général ils n’apprécient pas ! (Rires) Et donc, au moment où il assassine l’américain, il y a la carte bancaire qui tombe. Le personnage va la prendre, le passeport avec. Ça aussi je peux le dire, ça n’ôte rien à l’histoire.
Et puis il commence à trafiquer avec la carte bancaire et j’y mets une forme de réalisme : aux États-Unis il n’y a pas de code pin, de code personnel. Il peut éventuellement s’en servir, mais il faut être un peu stupide pour s’imaginer que l’on peut aller avec la carte et le passeport retirer de l’argent dans une banque. Enfin bon… sauf que, il a quand même observé l’attitude de l’américain.
Une fois que j’ai raconté cette histoire-là, que je travaille toujours jour après jour, et bien j’ai un peu terminé, je n’ai plus rien devant moi. Il l’a tué, il n’a pas résolu son affaire avec Stéphanie, alors qu’il est chargé lui-même de l’enquête pour retrouver cet américain disparu et comme personne ne sait d’où il vient, on peut dire qu’il est parti. Et j’ai fini : ça y est, c’est tout. À ce moment-là je me prépare. Il faut que j’arrête le livre, que je recommence. Encore un coup raté.
Puis un jour, tandis que je roulais vers Besançon, je passe par une route entre Nancy et Épinal, dans des régions qui ont été traversées par les Américains durant la Seconde Guerre mondiale, des allers, des retours, parfois plus d’aller que de retour. Et je roule. À cette étape du roman, je suis dans l’écœurement, dans l’angoisse parce que je suis en train de rater quelque chose. Et d’un coup, je vois cette grande pancarte sur le bord de la route et qui indique : « Cimetière américain. » J’ai eu un flash et j’ai su que je pouvais reprendre l’histoire.
Finalement, cet américain, on ne sait rien de lui. Étant donné qu’on ne sait rien de lui, moi je peux savoir une chose : il a un frère. Et ce frère va débarquer. Il est spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, c’est un universitaire, et il va aller au cimetière. Donc j’introduis quelqu’un qui a une certaine qualité intellectuelle.
À ce moment-là, ça prend d’autres proportions et je peux reprendre l’histoire. Mon personnage assassin est conduit, il est obligé d’aller le voir et il le rencontre dans le cimetière. Je quitte le domaine du fastfood, de l’usine, du camion, du moteur… Je n’y suis pas allé dans ce cimetière américain, mais on est tous allés dans un cimetière, et il a toujours ce carré, le monument aux morts, etc. Là, c’est uniquement un monument au mort, américain : ça implique qu’il n’y a pas de stèles, ce sont des croix plantées à même la pelouse. Par contre il y a un grand mur avec les noms des victimes.
Je suis dans un autre lieu, dans celui de l’inscription. Les inscriptions dans les monuments classiques sont en lettres latines, le « u » et le « v » confondus, etc. C’est doré, il y a la bannière. Pour moi je suis dans l’antiquité à ce moment, c’est énorme et je vais donner à mon personnage une sorte de présence matérielle. Cet universitaire se retrouve ainsi devant le nom de son grand-père qui est tombé dans la région, et je ramène ça à l’histoire personnelle et familiale autour de la résistance. Je me rends compte que dans les tragédies grecques, il y a les rois, mais il a beaucoup de gens simples. On ne changera jamais.
Les noms des personnages
Et le fait que le grand-père s’appelle Harold Lloyd, qu’en est-il de cette référence à ce célèbre acteur ?

J’ai pas fait exprès… Je le jure !
Mais je pense que l’inconscient a joué. Le problème c’est que j’ai appelé le grand-père Harold, mais je ne l’ai jamais associé avec son nom. Je n’ai jamais eu Harold Lloyd en tête. C’est le petit fils qui parle et il dit : « Mon grand-père s’appelle Harold ». Le petit fils se nommant Lloyd, bon… mais je n’ai pas fait le lien. C’est une négligence. Ce serait trop gros.
Et Gustave Leroy, est-ce pareil ? C’était le nom d’un chansonnier.
Non mais alors là vraiment… c’est un critique qui a fait la remarque. Je ne savais pas du tout qu’il y avait un Gustave Leroy, c’est une coïncidence. Par contre il y a un Gu ! On ne m’a jamais fait la remarque. On ne m’a jamais dit d’où venait ce prénom : Gu. C’est un livre que j’ai lu plusieurs fois, qui a été adapté deux fois au cinéma et personne n’a fait le lien. Il s’agit du livre Le deuxième souffle, de José Giovanni, dont le personnage s’appelle Gu. J’ai toujours trouvé ce prénom fascinant et je me suis dit que je m’en servirais un jour. Après je me suis dit que je ne pouvais pas dire Gu si je ne justifiais pas un peu son origine, d’où Gustave Leroy. Mais dans le livre de José Giovanni, c’est simplement Gu. C’est Lino Ventura qui joue dans la première version.
Puisque l’on parle des critiques, un certain nombre d’entre elles cherche à vous rapprocher de Simenon, par les descriptions que vous faites des gens simples, de l’immédiateté. Est-ce un rapprochement qui vous parait pertinent ou bien est-ce que vous en avez marre qu’on vous fasse la remarque ?
Des fois j’en ai un peu marre, oui. En même temps, si on a besoin de référence pour entrer dans un texte et le connaître un petit peu, pourquoi pas. J’ai lu Simenon. Je suis loin d’avoir tout lu, certains m’ont intéressé mais pas ses Maigret. Plutôt ses romans noirs. D’un autre côté, je suis fasciné par son destin, son existence. D’ailleurs un roman vient de sortir qui s’appelle L’autre Simenon (de Patrick Roegiers, aux éditions Grassets), et John Simenon a fait une demi-page dessus dans un quotidien où il nie ce qui est dit dans ce livre. Simenon y est taxé de collaborateur, on y découvre un frère légionnaire qu’il a trahi… enfin c’est un truc atroce, parait-il !
Pour en revenir au livre, c’est à moi de continuer d’écrire des textes. Il est normal que les critiques et les lecteurs aient des références, moi-même je suis lecteur. Je n’ai rien à dire, ça ne change rien à mon texte.

Discussion avec le public
Public — En lisant vos romans on a l’impression que les personnages s’embourbent, marchent dans un marais et s’enfoncent progressivement, que quelque chose d’inéluctable qui va arriver. On a aussi l’impression que tous vos héros sont des hommes, je ne sais pas si c’est vrai.
Oui, il y a une fatalité qui pèse. J’en viendrais presque, sans aller chercher dans les vapeurs intellectuelles, au fatum, le terme latin qui fait qu’on est condamné à quelque chose. Je m’en sens un peu imprégné, j’ai le sentiment qu’on est prédéterminé. J’avais une image après qui m’est venue mais je prends bien garde dans mes textes à ne jamais faire de citations, c’est volontaire. Je pense que ce n’est pas ce qu’on attend d’un roman. Mon 9 personnage qui s’appelle Gu est en fait conduit parce que Stéphanie lui a demandé de retrouver son amant, et il dit oui. Autrement il n’y a pas d’histoire. Mais il ne sait pas dans quoi il se lance, ce que je veux dire c’est qu’il est conduit à identifier quelqu’un et en se faisant à se dénoncer, il d’écriture, est conduit contre lui-même en définitive. C’est ça qui m’intéressait. Être à l’embranchement des routes, comme dans une tragédie de Sophocle. Bien sûr, cela me parait être quelque chose qui pèse sur l’être humain, mais cela me semble plutôt vrai.
N’est-ce pas en même temps l’objet de vos romans : de décrire à travers ces personnages ce contexte social dans lequel ils sont prisonniers de quelque chose ?
Après c’est sur un autre registre. Gu se perd, oui. Mais certains ne se perdent pas dans mes romans. J’ai ce sentiment qu’il y a de vraies injustices et que certains s’en tirent, d’autres en prennent plein la figure, et ce n’est jamais ceux qui s’en tirent qui le méritent. Voilà, j’ai ce sentiment d’injustice permanente, de frustration que je vis peut-être aussi à mon niveau.
Qu’on puisse me dire qu’il n’y ait pas de personnage féminin dans mes romans, par contre, ça me trouble énormément. Il faut que j’y arrive. J’en ai un en ce moment que je suis en train de construire. Il y a des personnages féminins quand même, et auxquels je suis attaché, mais de la même manière, c’est très dur d’entrer dans un personnage sans le caricaturer. Par exemple pour l’américain, au départ je l’ai mis au Texas et ses parents dirigeaient une usine, c’était caricatural. À la place je l’ai installé dans le Minnesota, qui est un autre état où il se passe autre chose, il y a de la neige par exemple. Mais c’est le cas pour tous les personnages. Pour la mère, je dis qu’elle est atteinte de déficience mentale, par rapport à la mémoire, elle a perdu ses facultés, mais je n’ai pas dit qu’elle avait Alzheimer. Si j’ai un personnage féminin, je l’aborde avec beaucoup de circonspection, de délicatesse, pour ne pas le réduire à un état caricatural ou à un objet sexuel.
Dans La fille de mon meilleur ami, l’un des personnages principaux, la fille en question, est une femme et elle m’intéressait, dans sa folie, à tel point que je ne me suis pas protégé en la décrivant. J’aurais même voulu aller plus loin. Il y a des endroits dans le roman où elle se livre. Il se trouve qu’elle est aussi cleptomane, ce qui crée des situations difficiles. Cleptomane et folle. Il faut vivre avec. Mais elle me fascine. Je n’ai pas pu aller plus loin, mais c’est vrai que j’aurais bien voulu.
Sylvie Vignes, professeure de littérature française et directrice du master métiers de l’écriture à l’université de Toulouse II — Il a quand même de beaux personnages féminins, comme dans Bambi Bar par exemple. Ce sont plutôt les narrateurs qui sont masculins et comme vous dites que vous vous faufilez dans leur peau on comprend davantage évidemment ce dont vous avez besoin. Pour revenir sur le fatum dont vous parliez tout à l’heure, dans L’Épave il y a quelque chose qui est très proche de Sans état d’âme avec ce personnage qui donne l’impression de vouloir se faire pincer, on a l’impression qu’il en fait vraiment beaucoup trop. Il y a vraiment cette espèce de fatalité interne, le personnage a l’air d’aller vers sa perte.
Par ailleurs, je voulais savoir si vous aviez un roman préféré parmi les vôtres.
Yves Ravey — Je ne me suis jamais posé la question. C’est toujours celui sur lequel je travaille qui me plait en général. En ce moment j’ai un récit en tête, je l’ai écrit, maintenant j’ai un an de travail, un an ou deux, on verra… Lorsque j’ai terminé Sans état d’âme au mois d’avril dernier, les bras m’en tombaient. Je me disais que je n’avais pas raconté grand-chose. Mais en personnages, c’est certainement celui-là que je préfère. En général, c’est simplement celui que j’ai dans la tête.

Yves Ravey en pleine dédicace
S.V. — Indépendamment de certains personnages, on a l’impression que les décors ont un côté américain, même si l’action ne se passe pas du tout aux États-Unis. Évidemment il y a des champs de maïs en France aussi. Mais j’ai l’impression que vous avez importé une atmosphère américaine dans ce dernier roman qui est particulièrement saisissante.
Je n’ai pas envie d’écrire dans un lieu précis, donc résous mes problèmes de paysage et de lieux simplement, je ne donne même pas de nom à la ville où à la bourgade. Quand je dis Dammartin-les-Templiers, c’est un village du Doubs, c’est vrai mais bon… c’est parce la sonorité raisonne dans ma tête avant tout : il y a le mot templier.
Il y a un critique qui a mis Dammartin-les-Peupliers, bon… ça lèse un peu. Mais dans la première phrase du roman je marque qu’il y a une ligne de peupliers au loin, c’est peut-être pour ça. Et puis, la ligne de peuplier ce n’est peut-être pas très méditerranéen. Après, je n’ai plus que des éléments qui peuvent être américains mais c’est là-dedans que je me retrouve, dans les stations-service, et tous ces lieux-là.
J’ai peut-être un peu de culpabilité parce que je suis allé aux États-Unis, il y a deux ans, au ministère des Affaires étrangères, et que je n’ai pas fait de livre dessus. Mais c’est vrai que ça m’intéresse.
Public — Il y a beaucoup de voitures dans vos romans, même dans les titres, L’Épave par exemple. Elles sont toujours présentes, montrées, fracassées. Vous pourriez nous dire deux mots ?
La voiture, c’est l’un des éléments de notre quotidien. Pour se rendre d’un endroit à l’autre, on n’y va pas obligatoirement à cheval. Elle a aussi cette caractéristique de marquer une époque, d’être une référence esthétique au sens plastique du terme, en fonction des courants. On m’en parle parce que je les mets plus ou moins en avant dans mes récits, mais je ne sais pas comment… je les fais intervenir, simplement. Dans L’Épave, je traitais un peu ce dont je parle dans Sans état d’âme, puisqu’il y a un rapport à la mémoire et à la résistance, tandis que dans L’Épave, je traitais, à mon sens, la chasse aux nazis. Avec des références précises.
Pour les voitures, je ne sais pas trop quoi dire. J’essaie de m’en éloigner le plus possible maintenant, de ne plus trop donner de marque comme j’ai pu le faire très longtemps.
Vous avez déjà évoqué l’importance de la recherche des lieux pour la construction de vos romans, pourriez vous revenir rapidement sur la question de la mémoire et des lieux de mémoires ? Pouvez nous expliquer quel est le rapport à l’histoire dans vos romans ?
Le cimetière américain a retenu mon attention pour cette question de mémoire qu’il y a derrière, sans quoi je serais passé à côté. Je passe souvent à côté de lieux sans m’en préoccuper. La mémoire, la notion d’histoire je la porte en moi, dans Sans état d’âme l’universitaire qui vient est spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, je mets le paquet !
Il double son a discours, sa motivation, puisqu’il recherche aussi des informations sur son grand-père qui est mort dans ce secteur. Il cherche à circonscrire le terrain, et finalement Gu lui dit : « Là où vous avez circonscrit, il y a ma maison. »
Il y a donc une double intrigue. Le grand père de Gu était résistant. Les choses s’imbriquent les unes dans les autres. Je ne crois pas qu’on puisse écrire séparé de l’histoire. Partiellement, bien entendu. Ça me parait un des éléments des plus importants, d’un poids fondamental. J’essaie de ne pas m’y enfermer.
Jean-Paul Vormus — Merci à vous, Yves Ravey, pour cette rencontre. Lisez Sans état d’âme et ceux d’avant, je ne peux que vous les conseiller.
Le 03.10.2015, à la librairie Ombres Blanches.
.
~ Galerie ~
Les photos de la rencontre sont de Christelle Guillaumot.
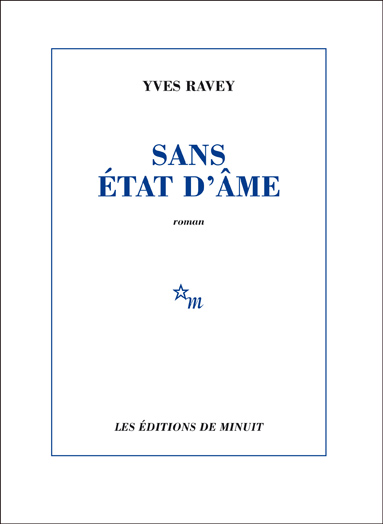
Yves Ravey
Sans états d’âme ~ Les Éditions de Minuit
ISBN 9782707329073
128 pages
Prix public 12,50 euros
*
